Stevenson a écrit un court texte qui s’intitule Les porteurs de lanterne dans lequel il raconte comment des enfants se rassemblent « chaque automne du côté d’un village de pêcheurs de la côte est, où ils s’enivraient de la splendeur de l’existence. Vers la fin de septembre, quand approchait la fin des classes et que les nuits se faisaient noires, nous sortions de nos maisons respectives, équipés chacun d’une lanterne sourde. La béatitude suprême était de se promener, simplement, tout seul dans la nuit noire : le volet fermé, le pardessus boutonné, pas un rayon ne devait s’échapper, que ce fût pour éclairer le chemin ou pour proclamer votre gloire – de n’être qu’un simple pilier de ténèbres dans l’obscurité, et à tout instant de savoir, dans l’intimité de son cœur de nigaud, que l’on avait une lanterne sourde à la ceinture, et d’exulter et de chanter de le savoir. » Dans son premier roman intitulé Les envolés qui parait aux éditions Gallimard, Etienne Kern est pareil à ce porteur de lanterne qui éclaire la vie de Franz Reichelt, mort en 1912 alors qu’il saute de la Tour Eiffel en parachute. Il signe un roman lumineux sur les disparus qui nous habitent, faisant dialoguer la disparition de Franz Reichelt avec celle de ses propres disparus, et par écho les nôtres. Etienne Kern se fait pareil à un photographe en captant avec grâce et finesse ces instants qui basculent. Les envolés est un roman qui saisit par une écriture en noir et blanc les zones grises de nos vies pour mieux leur redonner tout leur éclat.

1.Vous avez consacré un certain nombre d’essais littéraires rédigés à quatre mains avec votre compagne. Vous y abordiez aussi bien les haines d’écrivains que les histoires des parents d’écrivains. Vous enseignez par ailleurs la littérature à Lyon. Dans Le bruissement de la langue, Roland Barthes associait étroitement lecture et écriture : « Une pure lecture qui n’appelle pas une autre écriture est pour moi quelque chose d’incompréhensible…La lecture de Proust, de Kafka, de Blanchot, d’Artaud ne m’a pas donné envie d’écrire sur ces auteurs ( ni même , j’ajoute, comme eux ), mais d’écrire ». Ce désir de ne plus seulement écrire sur des auteurs mais d’écrire, au sens d’écrire de la fiction et sur des évènements plus personnels, était-il arrivé à maturité, sachant que vous aviez entrouvert la porte avec Les derniers des fidèles, et que votre compagne Anne Boquel à qui le livre est dédié, a publié un roman en mars dernier intitulé Le berger ?
Effectivement, nos premiers romans respectifs ont été précédés, depuis 2009, par plusieurs essais littéraires (à l’exception des Derniers des fidèles qui relèvent peu ou prou de la narrative non fiction). Le désir de fiction était bel et bien là depuis des années, mais il s’est heurté durablement à un procès en illégitimité que nous nous faisions à nous-mêmes – et en réalité nous nous ne le faisons encore, comme, j’imagine, beaucoup de romanciers ou primo-romanciers qui enseignent par ailleurs la littérature. Comment prétendre écrire après toutes ces œuvres merveilleuses que nous sommes amenés à faire lire à nos étudiants ? Voilà pourquoi nous avons si longtemps écrit « sur les auteurs », pour reprendre la formule de Barthes que vous citez : nous trouvions dans cette pratique en quelque sorte autorisée de l’écriture un prolongement de l’activité enseignante (non moins qu’une passion, bien sûr).
Tout auteur se trouve face à des modèles ou contre-modèles qui lui offrent un cadre à partir duquel essayer de mettre en forme et en mots un projet ou une émotion qui, sans ce cadre, ne sauraient parvenir à l’expression.
Etienne Kern
Mais au fond, je crois qu’un romancier ne cesse jamais d’écrire « sur » les livres des autres, si l’on rend à la préposition son sens premier, c’est-à-dire son sens spatial : nos mots ne viennent qu’en surcharge, surimprimés sur ceux des œuvres plus anciennes. Consciemment ou non, tout auteur se trouve face à des modèles ou contre-modèles qui lui offrent un cadre à partir duquel essayer de mettre en forme et en mots un projet ou une émotion qui, sans ce cadre, ne sauraient parvenir à l’expression.
2. Le roman se situe deux ans avant la Première Guerre mondiale. Vous évoquez un climat et un état d’esprit propre à cette époque. Comment s’est articulé le travail entre le geste romanesque et celui des sources historiques ?
Je ne considère pas Les envolés comme un roman historique – il n’en a ni l’intention didactique, ni l’attention scrupuleuse aux realia, ni tout simplement la longueur –, mais il a bien sûr nécessité un travail de documentation. Je dois beaucoup à la belle monographie de David Darriulat sur mon personnage principal, Franz Reichelt (Un tailleur pour dames au temps des aéroplanes), mais aussi et surtout aux très nombreux articles de presse consacrés à sa mort en 1912, consultables aujourd’hui sur le site Gallica. J’ai passé de longues heures à lire ces articles et les pages qui les entourent dans les journaux : on y saisit mieux qu’ailleurs l’état d’esprit de l’époque. On a l’impression d’une candeur, d’une confiance, d’un aveuglement qui, avec le recul, ne manquent pas d’étonner quand on sait que la Grande Guerre va bientôt tout bouleverser, mais qui témoignent aussi d’un rapport au monde et au progrès très différents du nôtre : quand les journaux d’alors parlent d’avions (ou plutôt d’« aéroplanes »), c’est avec l’enthousiasme naïf des commencements, alors que nous, après le Onze Septembre, après tant de crashs et à l’heure du bilan carbone, nous aurions plutôt tendance à voir en eux le signe d’un désastre imminent.
Il est probable que j’aie cherché à échapper à ce pouvoir de fascination qu’a l’image.
Etienne Kern
Mais ce qui me fascine dans cette histoire, et peut-être plus généralement dans l’année 1912 (année du Titanic, tout un symbole !), c’est que le désastre imminent est justement ce qui attend les hommes de cette époque. Franz Reichelt est presque le symbole de cette situation : avec son parachute qui ne peut pas fonctionner, il court vers une mort certaine mais il adresse un grand sourire à la caméra…
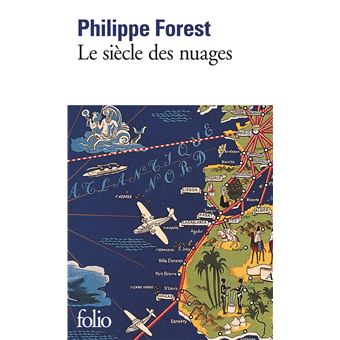
3. Dans son roman Le siècle des nuages, Philippe Forest rappelait la force du romanesque : « Il n’y a pas lieu de s’étonner de ce que toute vie ait l’air d’un roman puisque raconter sa vie, ou bien celle d’un autre, revient très exactement à lui donner cette allure de roman qui la fait seule exister. » En quoi écrire la vie d’un autre, d’une personne ayant existé, se rapproche du geste romanesque ?
Il est certain que le geste biographique (ou autobiographique), dans la mesure où il s’accompagne d’un récit, emprunte ses moyens et surtout ses effets à la logique romanesque. C’est déjà ce qu’explique Sartre dans La Nausée, avec ce personnage de biographe qui se rend compte que raconter une vie, c’est l’ordonner, la rendre cohérente et surtout la remodeler en fonction d’une fin. Et cette fin, alors qu’elle n’est dans la vie qu’un instant parmi d’autres, non moins absurde peut-être et surtout très aléatoire, devient dans le récit ce qui invite à relire toute l’histoire, ce qui lui donne un sens – bref, ce qui fait de la vie un destin. À cet égard, la plus rigoureuse et la moins littéraire des biographies de Franz Reichelt s’apparenterait encore à un roman : mourir en sautant de la tour Eiffel, voilà une fin !
Si les mots d’un roman ou d’un poème permettent tout de même de nous « relier » aux morts, c’est au même titre que les mots du quotidien : par la mémoire, comme quand nous parlons entre nous de nos disparus.
Etienne Kern
Mais pour revenir à la très belle formule de Philippe Forest – tirée d’un roman magnifique, centré sur l’aviation –, je ne suis pas absolument certain qu’une vie ait besoin d’être romancée pour « exister ». Pour être lisible, oui. Mais « exister », je ne sais pas. En tout cas il me semble que Reichelt a moins d’existence dans mon texte que dans les photographies qui ont été prises de lui : l’image lui conserve son altérité d’homme réel, irréductible aux autres. Le texte ne fait de lui qu’une ombre, une personne possible parmi une infinité d’autres. En quelque sorte, il le vide de sa substance.
4. Dans votre roman, le narrateur décrit un certain nombre de photographies de Franz Reichelt sans que les photos soient reproduites. Dans La chambre claire, Roland Barthes interrogeait le sens du geste photographique : « La Photographie ne dit pas (forcément) ce qui n’est plus, mais seulement et à coup sûr, ce qui a été. Cette subtilité est décisive. Devant une photo, la conscience ne prend pas nécessairement la voie nostalgique du souvenir, mais pour toute photo existant au monde, la voie de la certitude : l’essence de la Photographie est de ratifier ce qu’elle représente ». Est-ce que le fait de ne pas montrer les photos résulte d’une volonté ou d’une tentative d’échapper à cette ratification du voir, comme une façon d’échapper à cette fascination qui nous ravit face à la photo ?
Je suis très sensible à cette notion de ratification, à tel point que j’en ai fait le cœur des tout derniers mots du livre : « ils ont été », variation sur le « ça a été » de Barthes. Et il est probable, oui, que j’aie cherché à échapper à ce pouvoir de fascination qu’a l’image : insérer les photographies réduirait peu ou prou le texte à un simple commentaire de l’image.
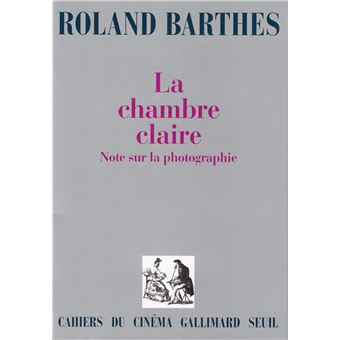
Mais si j’ai préféré ne pas les reproduire, c’est, me semble-t-il, pour une autre raison : quand on les regarde, ces photographies où l’on voit Reichelt revêtu d’un costume invraisemblable et tout sourire alors qu’il va mourir quelques minutes plus tard, pour le dire un peu familièrement, on n’en croit pas ses yeux ; en conséquence, leur pouvoir de ratification m’a paru trop fragile, encore plus précaire, au fond, que celui des mots. Du reste, j’aime assez l’idée de laisser les coudées franches aux lecteurs : à eux de dessiner le visage de Reichelt…
5. Roland Barthes évoque aussi dans La chambre claire le lien singulier qui nous unit aux photos : « La photo de l’être disparu vient me toucher comme les rayons différés d’une étoile. Une sorte de lien ombilical relie le corps de la chose photographiée à mon regard : la lumière quoique impalpable est bien ici un milieu charnel, une peau que je partage avec celui ou celle qui a été photographié. » Lorsque le narrateur décrit les photographies, la lumière est souvent présente. Les mots sont-ils pour vous cette autre lumière qui permet de relier les morts et les vivants ?
Je n’avais pas conscience, pour être franc, d’avoir convoqué si souvent ce motif de la lumière dans les descriptions de photographies, mais je dois admettre que vous avez parfaitement raison ! Il prend probablement sa source dans mon admiration pour Les Années, où les photos jouent évidemment un rôle fondamental et où Ernaux entreprend justement, comme elle l’écrit à la fin de l’œuvre, de « saisir la lumière qui baigne des visages désormais invisibles ». Quant à savoir si cette lumière peut les ramener, ces visages, c’est-à-dire si les mots permettent, comme vous dites, de relier les vivants et les morts, je crois que c’est là une conception trop optimiste, ou trop fière, de la littérature. Si cette dernière a bien évidemment un pouvoir – politique, didactique, émotif –, ce pouvoir n’a rien de sacré ou de surnaturel.
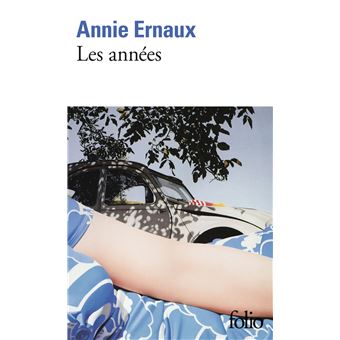
Et si les mots d’un roman ou d’un poème permettent tout de même de nous « relier » aux morts, c’est au même titre que les mots du quotidien : par la mémoire, comme quand nous parlons entre nous de nos disparus. Cela dit, il est bien possible que, par rapport aux mots du quotidien, la langue littéraire donne à ces disparus une présence un peu plus forte, parce qu’elle est plus concentrée et surtout plus exclusivement nourrie de cette pensée de la mort dans laquelle Jaccottet voyait « l’aliment de la lumière inépuisable ». Et je crois aussi qu’un auteur a besoin de se dire qu’il peut au moins essayer de ramener quelque chose d’entre les morts, même si c’est voué à l’échec. Cette illusion nécessaire peut être féconde. Écrire, c’est peut-être s’abandonner à l’illusion d’être capable de sauver quelque chose de la mort.

6. Le narrateur s’engage dans une enquête pour évoquer le personnage de Franz Reichelt qui va trouver un écho tout personnel. A quel moment de l’écriture du roman l’enquête de cette figure disparue s’est transformée en quête de ses propres disparus ? Était-ce présent dès l’origine ?
C’était présent dès l’origine, avant même l’idée d’écrire ce livre en réalité. Quand j’ai vu pour la première fois la vidéo qui saisit le saut et la mort de Franz Reichelt, j’ai d’emblée eu conscience que ces images ne me bouleversaient pas seulement pour elles-mêmes, ou pour leur intérêt documentaire (le studium, comme dirait Barthes), mais aussi et surtout parce qu’elles avaient pour moi une résonance très intime (le punctum, en quelque sorte) : mon grand-père maternel s’est tué en tombant d’un balcon et le scénario traumatisant de la chute est profondément ancré en moi. Ensuite, Reichelt a pris pour moi un nouveau visage, celui d’une amie qui, en 2016, s’est défenestrée. La quête des disparus s’est alors muée en écriture. Mais dans les premières versions du texte, je ne disais rien de mon grand-père ni de cette amie. Par pudeur, mais aussi par mauvaise conscience : avais-je le droit de mettre des mots sur leur vie ? Quand le texte a pris sa forme définitive, je l’ai soumis à ma mère et aux parents de mon amie ; il était très important pour moi d’avoir leur accord.
7. Dans Le Promontoire du rêve, Victor Hugo avait ce vers admirable : « Tout rêve est une lutte ». Au début du roman, vous montrez combien le geste de Franz Reichelt est fort de sens : « Tu es le rêve, la foi, le désir, le vertige ». En quoi le geste de cet homme relève-t-il de la lutte pour ses rêves ?
Oui, il y a de la lutte dans l’histoire de Franz Reichelt : il a consacré deux ans de sa vie à son projet, il a essayé de convaincre des savants, il a multiplié les essais (y compris en jetant des mannequins par les fenêtres de son immeuble), il s’est démené pour déposer un brevet, alors même qu’il s’exprimait manifestement difficilement en français. Et ce qui est sidérant, c’est qu’il a mis toute cette énergie au service d’un projet dont tout le monde lui a dit qu’il ne pouvait pas aboutir : son parachute était inadapté, trop petit, avec un centre de gravité trop haut, et très peu maniable.
Comme lecteur, j’aime particulièrement les textes qui nous laissent de « grandes marges blanches », comme disait Éluard.
Etienne Kern
Reichelt pousse l’aveuglement jusqu’au sublime. Ce type de personnages nous intéresse beaucoup, Anne et moi : Les Derniers des fidèles racontaient l’histoire vraie et navrante d’une centaine de losers partis fonder une colonie bonapartiste au Texas en 1818 dans le but de lancer une expédition vers Sainte-Hélène pour libérer Napoléon…

8. Le roman est marqué par une épure stylistique. Vous avez une manière toute particulière de terminer vos paragraphes, par une simple phrase, comme une manière de suggérer plutôt que de proposer un discours explicatif. Le geste même de l’écriture, épuré, clair, minimal, répond-il au sujet même du roman qui est cette volonté de s’envoler à travers le ciel ?
Je ne saurais vous dire si cette épure, que j’ai essayé de cultiver, en effet, a été appelée par le sujet du roman ou si elle correspond à une tendance générale chez moi. Comme lecteur, j’aime particulièrement les textes qui nous laissent de « grandes marges blanches », comme disait Éluard. Éluard songe ici à la poésie, mais le récit en prose a ses marges, lui aussi. J’ai souvenir d’une analyse magistrale d’un récit d’Hérodote dans l’étude de Walter Benjamin sur « Le conteur » : quand un récit n’explique pas tout, il a un « pouvoir germinatif » plus fort.
9. On connait la figure de Franz Reichelt par une vidéo sur internet. Or, la tâche du romancier, c’est d’aller découvrir et entendre les éclats lumineux d’une vie. Pierre Michon exprimait ce que peut le geste de l’écriture et de la parole littéraire dans Vies minuscules, afin de faire atterrir de manière la plus juste possible le destin des hommes : « « Qu’un style juste ait ralenti leur chute, et la mienne peut-être en sera plus lente ; que ma main leur ait donné licence d’épouser dans l’air une forme combien fugace par ma seule tension suscitée ; que me terrassant aient vécu, plus haut et plus clair que nous ne vivons, ceux qui furent à peine et qui redeviennent si peu. Et que peut-être ils soient apparus, étonnamment. » L’écriture permet-elle pour vous de rendre visible et audible le destin de ces êtres oubliés et disparus et de les transformer en figures majuscules, en leur redonnant vie ?
Redonner vie aux disparus, je n’y crois pas : tout au plus peut-on attirer l’attention sur eux, préserver ou raviver quelque chose de leur mémoire. Enfin, il me semble qu’être disparu ou oublié ou inconnu n’implique pas qu’on soit minuscule.
10. Le personnage de Franz Reichelt s’apparente à certains idéalistes ou rêveurs de la littérature. Représente-t-il pour vous une métaphore de la littérature ?
Si métaphore il y a, je vous avouerai que je n’en avais pas conscience au moment de l’écriture. Mais oui, on peut considérer que ce saut dans le vide, ce désir d’invention, cette offrande dont personne n’a vraiment ni désir ni besoin, cet échec même, comme conscience que l’objet créé n’a pas de prise sur le réel, tout cela dit quelque chose de la création littéraire ou artistique…
11. Roland Barthes dans Le bruissement de la langue proposait cette définition de la lecture : « Ne vous est-il jamais arrivé, lisant un livre, de vous arrêter sans cesse dans votre lecture, non par désintérêt, mais au contraire par afflux d’idées, d’excitations, d’associations ? En un mot, ne vous est-il pas arrivé de lire en levant la tête ? » Votre roman articule par son sujet le lien entre la terre et le ciel. Peut-on voir dans ce titre même des Envolés une métaphore de la lecture, au sens où lire, c’est être porté par un désir d’ailleurs et d’inconnu ?
Oui, bien sûr, même si l’envol des lecteurs est un envol heureux, sans chute ni désastre !
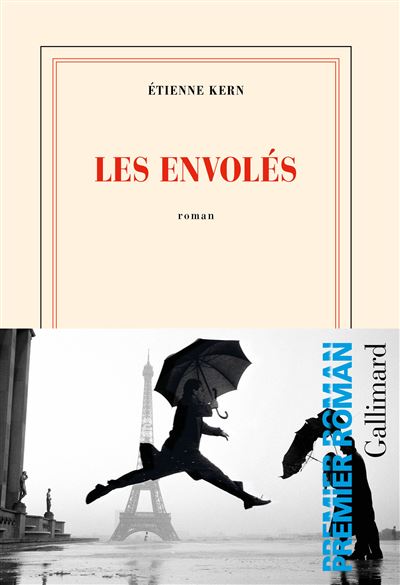


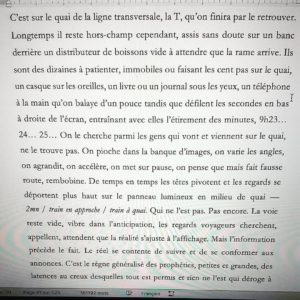

Ping : « Les Envolés » d’Étienne Kern : un petit bijou délicat de la rentrée littéraire – Plaisirs de lire inattendus, sauvages, alternatifs