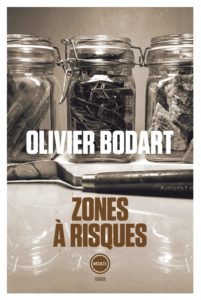Il est des lectures qui tombent comme ça, comme un éclair, pour nous faire ressaisir le réel, enfin le voir, comme une tangente fantasmatique et fantomatique, pourtant bien là.
Il est des moments révélateurs et éclairants où tout s’entrechoque, alors on tisse des fils paradoxaux pour raconter et comprendre, vivre avec tout ce qu’on ne dit pas mais qu’on sent.
L’alligator albinos est un texte difficile à classer et à enfermer derrière un mot pour en résumer le style, et c’est une libération que de l’ouvrir sans savoir où va nous emmener.
Sensible et réceptif à ce qui l’entoure, Xavier Person agrémente son récit observateur de questions globales voire universelles, matinées d’urgence et d’intensité imbriquées.
Il assemble les pensées disparates, dénoue les ambivalences, désenferme ce qui peut encore faire sens, même sans, et tisse ce faisant un récit intime, intense, subtil et émouvant, d’une intelligence rare.
On entre dans les souvenirs, les associations de savoirs dédogmatisés, en ondes fulgurantes entre récit profondément personnel, savoirs éthologiques et naturels, instinctifs, transmissibles, innés, astronomiques et mélancoliques. Avec en toile de fond personnelle ET universelle : le dérèglement climatique et la « défaite des pères ».
Et on se prend au fil de la lecture à encore espérer, nous aussi nourris de tous ces mots, des deuils, à se sentir encore capables d’affronter et de chercher un nouvel élan.
L’envol d’une nuée d’oiseaux, puis l’apparition d’un homme sous la pluie, un point de départ
On commence avec un moment qui en appellera d’autres, une promenade, une pensée, une observation, un lieu et un être particuliers, un arbre séculaire, trop rapidement trouvé et embrassé, et un envol.
« Nous prenions le chemin du retour, des bruits se firent entendre vers la lisière. On aurait dit des clochettes, on percevait leurs clairs, tumultueux tintements. Des clochettes ? N’étaient-ce pas plutôt des pépiements ? Nous n’avions pas tardé à apercevoir les oiseaux, ils s’envolaient de partout, rejoignaient leur groupe virevoltant sous le couvert des arbres. C’était très beau et très inquiétant. Ils surgissaient de dessous les feuilles mortes, se multipliaient sous l’effet de nos pas, s’élevaient en spirales. Quel était leur nom ? Qu’aurions-nous su nommer autour de nous ? Nous trouvâmes au sol de fines graines — expliquaient-elles l’ivresse des oiseaux ? J’en pris une dans ma main, ouverte en deux, son centre évidé. »
Un vortex poétique et émotionnel, philosophique et personnel
Des pages encore pleines de vie, de vie telle qu’elle n’est plus, de savoirs qu’on ne relie pas ainsi d’ordinaire, mais qui sont pourtant là, palpables jusqu’au vertige.
Un monde qui n’est plus ce qu’on croyait, imprévisible mais au fond, au fond, quand on laisse venir les mots, ce qu’on trouve… Des ondes, du sens, des sciences, du vivant.
Regarder loin, large, élargir les points de vue et ouvrir les portes de la perception sensorielle, sensible, littéraire, purement et éthologiquement, car l’animalité est une voie à ressaisir, elle aussi.
Comme une longue philoso-poésie, alternant les observations et les fulgurances, une alternance de voix intimes et de récits poétiques, analytiques et scientifiques, pour faire face à l’angoisse du réel qui n’est plus comme avant, ne sera peut-être plus, puisque le réchauffement climatique mais surtout la finitude de la vie à accepter, réellement, enfin.
« On ne recule plus ? Comment, sur une planète rendue invivable par une température dépassant les +3,5°C, entretenir l’illusion d’un repli sur son territoire ? »
Des fulgurances qui font sens alternatif et essentiel, de fait
Xavier Person ajuste et associe les savoirs sans avoir à montrer le moindre effort de conviction, puisque la logique est lumière et la poésie sans carcan.
Par association de pensées disparates mais liées par une logique intérieure, on suit la voix du narrateur sans avoir besoin de fil rouge.
Et l’on ressent ce vertige nous aussi quand on lit ce récit, comme si nous aussi on observait tout ça, ces choses naturelles qui ne sont plus, ne font plus comme ce qu’on connaissait, les arbres qui changent de fonctionnement, l’air qui fluctue différemment, tout comme les insectes, les oiseaux et les hommes…
« On vit avec des fantômes » et ces spectres prennent parfois de la place, étant pourtant là, encore, comme devant nous, comme tous les silences douloureux et déniants, mais à dénouer, pourtant.
Un monde disparu ou en train de, celui du passé de l’auteur, le présent évanescent ou l’à venir à interroger sans tergiverser, pour affronter ?
Une tangente vue, vécue, lue, dite et qu’il faut réassembler, comme une nuée par ailleurs lettrée
On chemine de pensées repensées en lectures elles aussi revisitées. On assiste à la construction, reconstruction d’une pensée autour de l’absence, passée et éventuellement à venir, c’est lettré, Levinas, Valéry, Mallarmé, Benjamin, Montaigne, Kafka, Paul Valéry, Freud, Goethe, Hölderlin, Sloterdijk, Jorge Semprún, Dostoïevski, Warburg, Amery, K.Dick, Paul Célan entre autres, tant d’autres qu’on laisse porter la pensée intime, très, lettrée et scientifique, très, aussi.
Une inspiration, des respirations, des mots, de l’air dans les phrases, une grammaire inattendue de nos rêves et espérances déchus.
« L’intervalle de l’espace donné par la lumière est instantanément absorbé par la lumière. » J’ai un temps collectionné des phrases sur la lumière, qui au moins contenaient le mot. Je rêvais d’un livre fait d’une suite de citations. Un livre que je n’aurais pas écrit. Que j’aurais écrit sans l’écrire. Autant que celle d’Emmanuel Levinas, j’aimais celle de Montaigne. Il revient à lui après une chute de cheval : « Quand je commençai à y voir, ce fut d’une vue si trouble, si faible et si morte que je ne discernais encore rien que la lumière. » Cela aurait creusé dans la reprise du mot un éblouissement. Franz Kafka le dit mieux que moi : « Rien de cela, des restes de lumière arrivent en traversant les mots. » Ou bien : « La lumière la plus forte suffit à dissoudre le monde. » Les Cahiers de Paul Valéry m’apportaient de quoi enrichir ma collection :
« Il se cache dans sa lumière. Je suis enfermé dans une sphère d’illumination. » J’aurais emprunté son titre à Paul Celan, Contrainte de lumière, j’y trouvais de quoi recopier :
« FAIS SAUTER les / cales de lumière : / la parole flottante / est au crépuscule. »
Tout est magistralement revu et réagencé dans une volonté urgente, oui, de (re)créer un dire, un faire et un vivre plus ajustés
On croise des fulgurations, des fulgurés, des auteurs confrontés aux vicissitudes de l’Histoire, on relit leurs mots et histoires personnelles on recroise maintes fois, une évidence, Walter Benjamin « Des éclairs ressemblent de plus en plus à des idées », on chemine avec foule d’auteurs fondateurs de l’être qui écrit, mais aussi avec Syd Barett qui voit naître sur la scène de l’Alexandra Palace une clarté qui l’éclaire, lui, ou encore l’atavisme bourgeois de Paul Valéry, qui lui fait faire des choix discutables, un essaim de pensées, de vies et de poèmes, entre autres, comme ligne de fuite.
Tous ces éclairs de lucidité font un effet magistralement revigorant quand on les lit, d’autant qu’ils se mêlent à des moments de rêves, forcément intimes.
« On pourra aussi se demander ce qui fera retour dans nos rêves quand il n’y aura plus de temps, et que ne pourrons plus rêver d’éviter le pire. »
Le récit est ainsi une pelote de vérités entrelacées, instinctives ou révélées, chacune étant une clarté sur celle d’à côté. Une logique tangentale qui ouvre différemment les sensations de toucher du doigt quelque chose.
Une histoire familiale et personnelle complexe voire traumatique
L’auteur arpente aussi son passif familial, l’aristocratie poitevine, entre autres, empli d’oxymores et de paradoxes qu’il affronte, confronte et accepte devant nous.
Il est question « du deuil qu’on a à faire du monde d’avant », et du deuil tout court, dont celui d’un père, décédé récemment, mais accompagné jusqu’au dernier souffle, jusqu’à lui dire une dernière fois des mots, ne plus se taire.
« Il respire. Je respire avec lui. Nous respirons ensemble. Que faire d’autre ? Je serre son épaule. M’approche. M’entendrait-il si je lui parlais ? Je finis par lui dire ce que j’ai attendu tout ce temps pour lui dire, même s’il est trop tard, même si je ne suis pas sûr de ressentir ce que je lui dis. »
Dans ce récit, Xavier Person entremêle différentes périodes, différents lieux, différents horizons (l’Algérie, Berlin, les Etats-Unis, la France), et délie tout ce qui a été mais qu’on ne dit pas, qui n’est pourtant pas caché, avec un instinct inquiet et scrutateur face aux finitudes, dans sa mémoire et autour de lui, jusqu’au vertige.
Il réenquête sur sa vie, sur les récits familiaux, la sienne mais aussi la famille de sa femme d’origine algérienne, les personnes disparues, la rupture et la séparation d’avec le milieu qui l’a construit, un voyage en Algérie en pleine canicule, ce pays en prise avec la violence du changement climatique, la visite d’une château familial, un ancêtre qui pourrait avoir tué les derniers loups du Poitou, un autre ancêtre aurait pris part à une éducation des Iroquois dans le nouveau monde, le commerce triangulaire, le colonisation, les rapprochements avec l’extrême droite.
Ces souvenirs qui remontent, non dénués de périodes noires de l’Histoire dont la lecture émeut profondément et fait réanalyser sa propre histoire en la regardant enfin en face.
Un travail fou sur soi-même, une mise à nu pour avancer, enfin, sans rien cacher ni oublier.
Et c’est une liste en spirale et escalier d’évènements marquants par leur finitude annoncée que nous découvrons en parallèle, pris nous aussi d’un vertige qui nous pousse à tourner la page.
Car ce livre avance à contre-courant, sans fil précis, nous faisant nous aussi avancer avec lui, chargés de matières, d’ondes, de souvenirs, d’hêtres et d’êtres, de personnages historiques, de savoirs révélateurs comme en essaim éclairé, suivant une voix inexplicablement prenante, fine, émouvante par sa justesse et son intelligence sans dogmes ni temps imparti.
Tant de souvenirs personnels, généalogiques, mêlés à des luttes actuelles mentionnées, des moments de vie réarpentés, Mare Nostrum, les migrants dans la Méditerranée, Aquarius, Génération Identitaire, Bruno Latour, les cyclones, les canicules…
On relit et relie le réel en associant nous aussi ce qu’on sait, ce qui doit. Et on ne peut s’empêcher d’ajouter nos propres pensées. Un dialogue s’instaure. Les fulgurés se parlent entre eux. Avec nous.
Ainsi, se tisse devant nous un récit qui tresse le burlesque avec le tragique, la généalogie avec les manques, l’ornithologie avec l’anthropologie, l’entomologie avec l’étymologie, les fulgurances avec les peurs, le masculin avec le féminin, les astres avec les ondes, l’histoire avec les lieux, le scientifique avec le philosophique, l’intime avec l’Humain trop humain emporté à l’aveugle par le cours de l’Histoire et les temps qui courent (droit dans le mur).
De fulgurances en fulgurances, une révélation nous sera-t-elle offerte ?
Y’en a-t-il seulement une ? Et face à ce réel alarmant et désastreux, pas seulement écologiquement, et grandement menacé de disparaître qui nous est décrit, y a-t-il une porte de sortie vers un écosystème équilibré à reconstruire, sociétalement et collectivement ?
« Dans l’air suffocant d’un wagon du métro, tôt le matin, une très jeune mère assise en face de moi tenait sur son ventre, attaché par des sangles, un nourrisson au visage tourné dans ma direction, ses traits tendus, serrés, comme précocement vieillis, tristes, disgracieux et tristes. Je m’apprêtais à sourire à l’enfant quand mon regard et celui de la femme se croisèrent. Sa jeunesse me frappa, que contredisaient sa fatigue et un air de résignation. Quelle était sa vie ? Le savait-elle, le climat changeait plus vite que prévu. La trajectoire actuelle nous propulsait vers un réchauffement qui, si nous ne faisions rien maintenant, répétaient les scientifiques, allait s’emballer — mais que faisions-nous, qu’allions-nous faire, nous qui n’avions rien fait quand il était encore temps ? Des réactions en chaîne sont déjà enclenchées, dont nous pressentons à peine les effets, qui sur une plus large échelle du temps déjà fulgurent. Je regardais l’enfant, sa mère ne le regardait pas. Que voyait-elle devant elle ? Ceux qui viennent après nous, que pourront-ils espérer si le temps se précipite à l’envers, à partir de ce qui a eu lieu avant eux ? »
Qui est cet alligator albinos aveuglé ?
Car il donne son titre au livre, mais de quoi est-il la clé ? Sommes-nous, comme lui, pris dans le piège d’une perpétuelle cécité ?
Et si face au réel actuel, la littérature, la phrase belle à scander et la poésie alliant tous les vrais étaient vraiment d’une beauté à faire basculer les choses, ralentir le cours du temps et nous faire encore espérer ?
Les images, les espérances, les traumatismes, le passé et le présent , le climat délétère et les souvenirs s’entrechoquent, les peurs impensables semblent pourtant réelles dans un monde en train de devenir fantomatique et pour sentir le temps, la pensée se kaléidoscopise.
Un texte qui touche, intimement et sociétalement, puisqu’il relie le passé au présent, les douleurs à la vie, la littérature aux sciences, animales et humaines, l’intime au collectif, comme un montreur de vérités inattendues le ferait.
« Comment écrire aujourd’hui encore avec ce qui se passe au-dehors ? Il faudrait réinventer une manière de dire… »
Ce que ce récit nous offre, en dialogue militant et nuée d’éclairs de justesse lucide pour nous amener, nous aussi, à espérer pouvoir encore changer le cours des choses ! Alors, ne regardons plus ailleurs et … LISONS !
« L’Alligator albinos », de Xavier Person, Verticales (editions-verticales.com), 21 €.