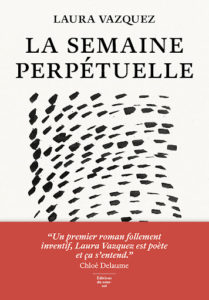Un roman, une enquête, un pays et des habitants à faire raconter : décidément, cette rentrée littéraire nous propose de réinterroger les murmures et les lieux.
Un roman, parmi d’autres, nous propose de partir au Japon pour interroger, enquêter sur les séquelles laissées dans la mémoire par des attentats marquants. Treize mille blessés, cinq mille morts.
« Tokyo, 1995. Des attentats au gaz sarin. Vingt-cinq ans plus tard, une enquête. Des témoins. Des scolopendres. Des veuves noires. Des oublis. Des murmures. Des non-dits. La narratrice peine à déchiffrer les signes équivoques qui lui parviennent. De rencontre en rencontre, elle se laisse traverser par ce que le pays cache et révèle.
« Un singe à ma fenêtre », Olivia Rosenthal, quatrième de couverture
Un apprentissage de l’abandon et du lâcher-prise. »
Dans ce roman, donc, on accompagne l’auteure, chercheuse, qui part au Japon, pour décortiquer ces attentats au gaz sarin, pour voir si ces événements ont laissé aussi des traces dans l’oubli.
Ce ne sont pas des coupables qu’elle cherche, mais à arpenter la mémoire des événements traumatiques : elle veut savoir si qui se souvient de ces faits et elle sait que derrière l’histoire collective se dessinent les souffrances personnelles et individuelles.
Et derrière ces échanges, entretiens, il y a découverte du regard de l’autre, quand il livre ce qu’il a vécu à l’enquêtrice venue vers lui. Il y a une oreille qui s’adapte, qui comprend, qui nuances, saisit autre chose que ce qu’elle était venue chercher.
Explorer, enquêter, chercher, méandrer, se perdre…
Olivia Rosenthal sait parfaitement être désarçonnée, on sent qu’elle aime choisir une route puis la quitter, faire valser les idées reçues rencontrer les témoins d’une catastrophe en acceptant qu’ils évoquent autre chose.
On la voit présenter et défendre son projet : écrire sur les conséquences, les répercussions, vingt-cinq ans plus tard, d’actes terroristes qui eurent lieu dans le métro de Tokyo : Cinq attentats au gaz sarin perpétrés en même temps par des membres de la secte Aum. On la voit obtenir la bourse, arriver au Japon, s’installer dans un studio et commencer son enquête.
Elle arrive au Japon, dans un lieu souvent fréquenté par les écrivains français et présent dans leurs romans, car il y a à Kyoto la Villa Kujoyama, qui propose des résidences à des auteurs soumettant un projet.
La narratrice va mener des entretiens, poser des questions en observant, aussi, ce qu’elle écoute autour d’elle, pour mener une enquête à sa manière, impossible et étrange, ambiguë, peut-être. On sent qu’elle le sait.
Ce livre nous montre un défilé des personnes qu’elle rencontre dans ce cadre : victime, membre de la secte, étudiant en français, gens nés pendant la guerre, homme ayant perdu quelqu’un, fille de militaire, amie d’un terroriste…
On la voit déroutée, aussi. Croiser autre chose que ce à quoi elle s’attendait. Autre chose que ce que le titre annonçait, aussi, car Un singe à ma fenêtre parle de rencontres de scolopendres, d’araignées (des veuves noires), et la fenêtre est celle qu’ouvre ce qui est raconté : la mémoire collective et les révélations que ces entretiens apporteront à certains.
Un portrait nuancé et interrogatif du Japon d’aujourd’hui ?
Un singe à ma fenêtre n’est pas une carte postale, ce n’est pas un récit de voyage, non, mais un apprentissage, une leçon naturelle d’interculturel, de flânerie anthropoétique dans les esprits, les gestes, les postures mais aussi les silences.
Un choix est donné à ceux avec lesquels elle s’entretient : que convient-il de laisser filer pour avancer ? L’oubli est-il une carapace ou une arme ? Un abandon ? Quelle différence avec le lâcher-prise ? Quel prix donner à la vie qui continue malgré tout ? La survie, le déni, la beauté, la transcendance sublimée ?
Il y a dans la voix de l’enquêtrice partie au pays du soleil levant un décalage perpétuel, parlant, qui, au final, pourrait nous laisser une image mélancolique d’un monde finissant, vieillissant, vidé mais encore en deuil, ne tournant pas la page de ce qui s’est passé et n’a pas été digéré, laissant des brèches et des failles partout, ouvrant la porte du domaine des possibles,, pourtant.
Bien sûr, on ouvre ce livre en se demandant si, à la fin, on saura ce qu’il en est du gaz sarin, des raisons de cet attentat, de ce qui l’a motivé, de la punitions encourues….
Alors on parcourt, détaille, prend le temps de chercher ce qui est peut être révélé entre les lignes, dans ces entretiens.
Et on se laisse emporter nous aussi. Par ce qui est dit, par le lieu, la méloire et ce que ça déclence. À la fin de chaque chapitre, la narratrice pose une série de questions, simples, motivées par le « tu » qui nous fait l’accompagner sans ses interrogations, comme face à un miroir. Toutes les questions qu’elle se pose la concernent elle, donc nous.
Un livre sur l’oubli et la difficulté à dire
Les entretiens menés ne seront pas aussi révélateurs qu’escompté, ce livre n’est pas une enquête sur les attentats et les raisons qui les ont provoqués. Au final, on n’apprendra pas tout sur le pourquoi et le comment de ces gaz et de leurs effets. Ces entretiens nous laissent, comme la romancière, infiniment interrogatifs. Au final, quelque chose a-t-il vraiment eu lieu ?
La narratrice recueille tous les récits dans des lieux divers. La relation des témoins avec leur pays natal va étonnamment rarement de soi. Découverte, contournement d’idée reçue, de lieu commun. Les mots choisis vont eux-mêmes rarement de soi dans ces entretiens.
Et on se rend compte qu’il s’agit surtout de partir à la rencontre d’une société figée, fermée, inconnue, insaisissable, tendue et de comprendre, par ce biais, qui on est, soi aussi, au milieu de tout ça.
Et puis, on avance et on comprend aussi qu’il s’agit d’un livre sur la langue : les dialogues se font en anglais ou en français, les personnes rencontrées disent de choses qu’ils n’auraient pas pu dire dans leur langue maternelle.
L’objet du voyage : les rencontres et la saisie de l’autre, donc de soi
Peut-on faire une enquête sur des attentats au Japon quand on ne parle pas Japonais ? On apprend, au passage, que la langue japonaise se doit de respecter une harmonie, qu’il y a des registres particuliers selon le lien et la hiérarchie des personnes, et qu’il y a, de fait, un renoncement nécessaire à toute individualité, puisque c’est le dialogue qui fait la langue choisie.
« C’est pourquoi il est si fatigant, même pour un Japonais, de parler sa propre langue. »
« Un singe à ma fenêtre », d’Olivia Rosenthal
Un singe à ma fenêtre ne rassemble guère de récits sur les attentats à proprement parler. D’ailleurs, le mot attentat est peu employé, on préfère parler d’« incident » ou d’ « accident ». La « fameuse » délicatesse viscéralement polie des Japonais…
Tout ce qu’entend la narratrice est éclairant, émouvant, voire, bouleversant pour différentes raisons, écouteuses, observatrices, nuancées.
Certains entretiens seront éminemment touchants et éclairants… Yaouyo, Nao… Sachiro et son image du pays natal, la violence qu’elle évoque quand elle parle des singes de Mandchourie… Keiko et son récit « troué de silences, poudre d’or délicatement appliquée sur les brisures et morceaux épars qu’elle avait décidé pour elle et pour nous d’assembler. » Certains évoquent leur angoisse diffuse de la fin du Japon pour d’autres, l’attentat a servi de révélateur… Un défilé de témoignages à décrypter pour comprendre le réel, japonais mais aussi personnel.
Les autres êtres qui peuplent le livre sont tout à fait silencieux. Ce sont des animaux. Des scolopendres, des araignées – et des singes. Amusant anagramme, singes et signes ! car les animaux sont des signaux plus que des signes. On le voit et on sent ce qui va se passer, pas de ce qui a eu lieu. Ils tirent parfois le signal d’alarme avant même qu’on sente, nous, quoique ce soit.

Un roman qui déchiffre l’équivoque
Une très belle leçon de littérature contournant la mélancolie – qui ne sert réellement et factuellement à rien pour comprendre – pour lui préférer le jeu avec le réel, pas double, mais facétieux, art dont Olivia Rosenthal sait quoi faire pour faire (sou)rire, au moins, pour comprendre, ensuite.
Et puis, mener des entretiens, au Japon, essayer de comprendre une société traumatisée, nuancer la mémoire collective et individuelle, mais aussi l’oubli et les mensonges, la déformation de la réalité, c’est aussi rencontrer l’autre, accepter qu’ils nous disent de nous, digresser sur l’effet inattendu et comprendre, par ce qu’il dit sur lui, ce qu’il dit sur nous, profondément enfoui, aussi.
« À force de fouiller en vain le passé des autres, j’ai fini par admettre que je ne m’étais pas appliqué à moi-même ce travail d’anamnèse, que j’étais moi aussi floue, vague, que les principales étapes de mon existence s’étaient dissoutes dans le vide et le non-dit. »
« Un singe à ma fenêtre », d’Olivia Rosenthal
Ils lui parlent d’eux, elle leur parle pour se saisir elle-même et nous parle de tout ça en se disant « tu », donc nous parle de nous, aussi en nous parlant d’eux. Oui, il s’agit bien de révélation de l’autre, de soi, universelle….
« Sais-tu précisément ce que tu caches ? Ce que tu dois cacher ? Ce que tu ne dois montrer sous aucun prétexte ? Ne risques-tu pas, en le montrant, de découvrir que ton secret n’est pas aussi extraordinaire et terrible que tu le pensais ? Est-ce pour qu’il reste toujours aussi encombrant et douloureux que tu continues à le cacher ? »
« Un singe à ma fenêtre », d’Olivia Rosenthal
Ce qu’il en sortira, on ne sait pas, on verra, et avec ça, on réorganisera peut-être le réel arpenté, dans nos têtes.
Olivia Rosenthal, Un singe à ma fenêtre. Verticales, 176 p., 17 €