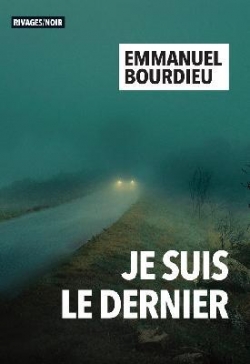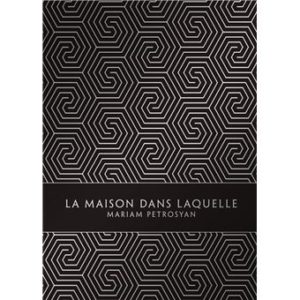Il est indéniable que le continent postmoderne est celui qui s’impose avec le plus de nouvelles questions. Les figures de Deleuze et Foucault continuent encore aujourd’hui d’accompagner la scène philosophique actuelle et d’enrichir nombre de réflexions. Il y a donc là une manière très stimulante de distribuer les cartes de la philosophie, manière qui ne cesse d’être critiquée par nombres de détracteurs. Alors Faut-il brûler les postmodernes ? Le philosophe Jean-Clet Martin s’empare de cette question dans un essai publié chez Kimé, portant ainsi secours à ce continent merveilleux.
Auteur d’essais passionnants sur Borges, Deleuze, Derrida, Philip K Dick, Van Gogh, Hegel et Ridley Scott, Jean-Clet Martin est un philosophe prolifique aux références abondantes nous menant aux marges de la philosophie, devant des objets étranges et troublants. Il vient de publier Faut-il brûler les postmodernes ? L’occasion de définir un peu mieux la postmodernité et de revenir sur son travail impressionnant à travers un entretien avec Jean-Philippe Cazier. Il était évident qu’à Cultures Sauvages nous nous devions d’en parler.

Vous sortez un livre d’entretien avec Jean-Philippe Cazier, chez Kimé Faut-il brûler les postmodernes ? Cette forme interroge le statut de la question aussi bien en philosophie que dans le cadre d’un entretien. Et on se souvient de Claire Parnet qui dans l’Abécédaire interrogeait Deleuze sur la différence entre une question en philosophie et une question dans les médias. Selon vous, qu’est-ce qu’une bonne question ?
Les questions présupposent généralement leur réponse. Y a-t-il de l’islamo-gauchisme à l’Université ? Une telle question est évidemment une question fausse puisqu’elle ne nous demande jamais d’interroger ce concept qui, au demeurant, n’a aucun sens. On dirait que le sens est ici acquis par l’autorité que semble se conférer la question elle-même. La question est réglée d’avance par l’attente d’une réponse immédiate qui consisterait simplement à dénoncer ce qui se passe à l’Université. Cette question ne tolère pour seule réponse que l’acquiescement à des présupposés implicites. Paradoxalement, les médias sont dans l’immédiat et l’implicite. Toutes les questions qui tournent autour de l’indignation morale sont de cet ordre. La réponse est plus forte que l’interrogation du sens, interrogation que véhicule toute question véritable. En tant que question qui accuse, elle n’est justement pas remise en question. Elle se pose naturellement comme légitime, impose de répondre à une demande qui domine l’actualité.
Il n’y a en philosophie de question qu’en raison d’un problème, un problème qu’il faut dégager et qui n’attend pas de réponse unanime.
Jean-Clet Martin
En philosophie, c’est tout l’inverse. Il n’y a en philosophie de question qu’en raison d’un problème, un problème qu’il faut dégager et qui n’attend pas de réponse unanime. Donc oui, avec Jean-Philippe, nous avons cherché à tracer la ligne d’un problème qui tourne autour du postmoderne : un concept qui n’est souvent invoqué que de façon très négative par des comités qui rêvent de le détruire, s’indignant devant l’insulte d’une pensée qui ne collerait pas aux présupposés implicites réclamés par un temps, une pensée qui ne se conformerait pas à la politique du slogan. Les slogans dominent en tout cas la scène : tout le monde s’identifiait un moment à Charlie, ce qu’on peut bien sûr comprendre dans l’horreur de l’événement, mais de là à soupçonner d’autres façons d’aborder la question, il y a tout de même un monde… Donc si vous voulez, il s’agissait de donner de l’époque qui est la nôtre un autre relief, une autre carte…
Dans une interview accordée à France Culture, Derrida expliquait : « Il y a dans l’interview quelque chose qui m’inquiète mais qui me séduit, il y a une interruption, quelque fois un art de l’interruption, quelque fois une violence de l’interruption, qui, dans le meilleur des cas, est une chance donnée à la parole, à l’improvisation, quelque fois non mais c’est chaque fois une expérience nouvelle. ». Cette rencontre entre confort et inconfort est-elle pour vous le lieu même de l’interview ? Retrouvez-vous ce paradoxe dans le métier d’enseignant ?
Disons que l’entretien se tient entre, justement, au milieu, dans une tenue qui n’est pas acquise supposant une forme d’altérité qui fait d’ailleurs le ressort de la pensée de Derrida dont l’expression est souvent liée à une question : une conférence, une intervention en situation, devant un public qui n’est pas nécessairement acquis à sa lecture des événements. Il s’agit donc en effet d’une chance donnée à la parole mais, en même temps, le problème réside dans l’acceptation du conflit. Je veux dire que le conflit n’est pas une insulte.
Il faudrait réapprendre à nos semblables – à commencer par nos enfants puisque vous évoquiez mon rôle d’enseignant – l’art de la contestation, de la disputatio comme un élément du discours qui fait la richesse même d’une démocratie.
Jean-Clet Martin
Ce n’est pas parce que vous discutez la thèse de quelqu’un que vous êtes nécessairement placé dans le registre de la provocation. On voit par exemple sur les réseaux sociaux que ne pas être d’emblée en accord avec une proposition est un acte de parole vécu selon l’injure, l’offense. Une déformation née de l’individualisme qui fait de chacun la vérité. Et il me semble qu’on ne peut accuser les postmodernes d’une telle vision des choses. En fait, la philosophie, depuis son origine, suppose une agora ou les idées se croisent sans que le conflit dégénère en un affrontement vécu comme un manque de respect. Je crois que la violence de l’interruption dont parle Derrida renvoie à l’interruption qui est commandée par la morale ou par la survalorisation de personnes sourdes à toute discussion.

La mort de Socrate n’est rien d’autre. Quand l’offense prend la place de la parole, nous sommes perdus. Il faudrait réapprendre à nos semblables -à commencer par nos enfants puisque vous évoquiez mon rôle d’enseignant- l’art de la contestation, de la disputatio comme un élément du discours qui fait la richesse même d’une démocratie. Donc, si on peut le dire ainsi, une critique bien posée n’est pas un scandale. Et s’il y a désaccord, il faut voir s’il s’agit simplement d’une stratégie rhétorique, d’une forme sophistique visant à mettre en difficulté celui qui parle ou, au contraire, si le dissensus reconduit aux conditions du problème, s’il permet de dégager exactement de quoi on parle. C’est une forme de pédagogie qu’on n’entend plus aujourd’hui lorsqu’on invoque la « pédagogie d’un gouvernement » qui n’a d’autre but que celui de forcer l’acceptation des choix retenus et des intérêts dominants.
Dans cet ouvrage, vous questionnez, entre autre, le statut du philosophe. Vous pointez du doigt « une philosophie de l’actualité immédiate ressemblant aux faits divers déguisés en esprit de sérieux » pour ainsi questionner le rapport du philosophe à son époque, et la nécessité d’échapper à son temps. Qu’est-ce qu’être philosophe aujourd’hui pour vous ?
Oui, et donc en effet, la pédagogie gouvernementale donne une idée tronquée de la vérité. Elle reconduit à ce qu’autour de Trump on a été conduit à dénoncer comme l’ère de la post-vérité qui serait imputable à la philosophie de Nietzsche, de Derrida, de Deleuze… Drôle de condamnation de ce qu’on appelle déconstruction… En fait, aux USA, la philosophie est cloisonnée définitivement autour du statut du langage, par la philosophie analytique d’une part et le pragmatisme ou l’utilitarisme qui font de la vérité un élément de communication et d’action. C’est pas du tout le cas de la philosophie continentale qui place la pensée dans le sillage de Hegel et Nietzsche pour une philosophie de l’esprit, de l’interprétation. L’esprit de sérieux est une manière de détruire l’esprit justement, de congédier l’interprétation par une démonstration, par un recours à la science ou à la force.
L’écrivain, ce n’est pas un autocrate qui se ferait le chien de garde des intérêts de la classe dominante mais quelqu’un qui retrouve le sens de la critique dans des formes qui n’ont rien à voir avec l’utilitarisme, ni avec des analyses rhétoriques relativement à des faux problèmes.
Jean-Clet Martin
Je trouve que sous ce rapport, on voit bien comment aujourd’hui on se réfère à une certaine idée de la « science » pour justifier des décisions quasi-militaires relativement à un virus. Comme si la vérité n’était que le paravent de l’esprit de sérieux. Mais l’esprit précisément, à la différence des sciences de la nature ne relève d’aucune démonstration. C’est le sens même du concept d’interprétation envisagé par Dilthey. Pour moi, dans une veine comparable, un philosophe est requis par une défiance devant l’autorité de la parole. Il n’est pas auteur d’autorité. Il n’y a pas d’autorité pour un auteur comme dans le cas de la littérature bourgeoise, celle des prix, des décorations politiques. L’écrivain, ce n’est pas un autocrate qui se ferait le chien de garde des intérêts de la classe dominante mais quelqu’un qui retrouve le sens de la critique dans des formes qui n’ont rien à voir avec l’utilitarisme, ni avec des analyses rhétoriques relativement à des faux problèmes. Nous sommes envahis de faux-problèmes dont la philosophie doit dénoncer la violence pour reconduire la pensée vers la condition réelle de ce qu’est une idée méritant d’être discutée. S’affronter aux faux-problèmes est un combat difficile que Kant dénonçait déjà en refusant les illusions de la métaphysique ou que Marx avait affronté au nom d’une critique de l’idéologie dominante, forme dévoyée des mêmes illusions métaphysiques.
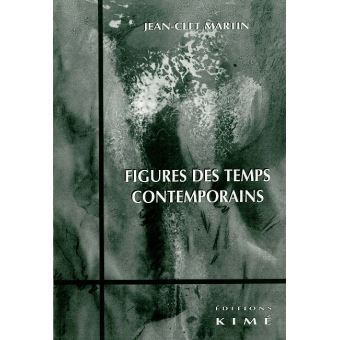
Le problème pour un contemporain est la difficulté de voir où se cache l’aliénation au moment même où on a l’impression qu’il n’y a plus de morale, plus d’interdits religieux, que tout est permis, etc… Il y a finalement un non-dit de l’inter/dit au moment où il s’impose et prend le pouvoir, des implicites qui se disent «entre » et vont finalement de soi, même durant une époque qui justement se croit libérée de toute contrainte. Par conséquent chercher l’aliénation dans les discours le plus libérateurs, c’est pour moi la tâche du philosophe.
On comprend bien, au titre de votre ouvrage, qu’il y a aujourd’hui comme un procès en sorcellerie des postmodernes, « responsables de tous les maux ». Vous isolez les gestes postmodernes (déconstruction chez Derrida, déterritorialisation chez Deleuze) du « tout se vaut » néolibéral. Et vous opposez création postmoderne et destruction nihiliste, rappelant Deleuze qui disait à la FEMIS : « La philosophie est une discipline qui consiste à créer des concepts ». La postmodernité serait-elle donc en réalité une résistance ?
En effet. Une forme de contre-pouvoir, un néocriticisme au sens où, comme toujours, ce qui apparaissait comme critique en un temps se voit rabattu sur la conformité et digéré par la tradition même qui était dénoncée. Ça finit régulièrement de cette façon quand la révolution dénonce la contre-révolution dans la manière comique de la Chine. C’est une difficulté que souligne Derrida comme Deleuze qui, à l’inverse de Badiou, ne croient pas trop au caractère « révolutionnaire » de la pensée. En s’opposant à un système, celui-ci au bout d’un moment va vivre de cette opposition, l’apprivoiser et s’en enrichir. Comment nier une force sans en même temps montrer les armes qui font la faiblesse de la négation, des armes qu’un système apprend à reprendre à son propre compte. L’ennemi fait souvent la force du pouvoir et entre finalement dans son jeu. C’est le destin de toute révolte. Le concept de résistance a donc son revers.

A l’occasion d’une maladie, la cellule cancéreuse par exemple va apprendre à résister au traitement qui devient inefficace. C’est cette réappropriation de la résistance qu’il convient de réfléchir. Jusqu’à quel point la critique ne sera-t-elle pas dévoyée finalement par ce qu’elle critique ? Le néocriticisme dont je parle serait au fond cette volonté de contourner la récupération qui lui est destinée par des institutions, des bourses d’études, des titres honorifiques, des formes éditoriales prestigieuses qui font de la littérature française non seulement une exception culturelle mais un désastre. Ce serait plutôt un côté expérimental, lié à la contre-culture, que j’invoquerais dans une espèce de manifeste cyberpunk qui explique les curieux titres que sont « Ossuaires », « Plurivers », « Enfer de la philosophie » ou « Philosophie du monstrueux »… Philosophie weird peut-être…
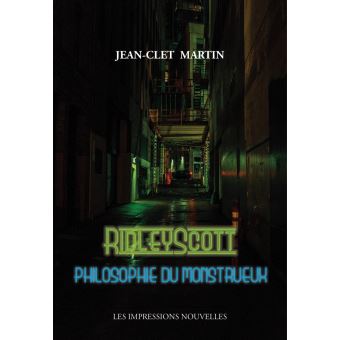
Votre rencontre avec Deleuze a été déterminante, autant sur le plan intellectuel qu’amical. Elle s’est inscrite dans un devenir deleuzien : il s’agissait de partir de la pensée de Deleuze, tout en en sortant pour finalement y revenir, reprenant ainsi les concepts de différence et de répétition. Il existe donc le Deleuze de Jean-Clet Martin. Et l’on se souvient du début de Mille Plateaux qui a constitué un des épisodes majeurs de la rencontre entre Deleuze et Guattari : « Nous avons été aidés, aspirés, multipliés. » Vous retrouvez-vous dans ces mots ? En quoi l’amitié est-elle nécessaire pour le philosophe ?
Les rencontres qu’on fait jeune sont décisives parce qu’elles trouvent le temps de se déployer. Dans une pensée, ce délai fait son chemin. Parce qu’on n’est jamais dans l’immédiat. C’est vrai aussi de ma rencontre avec Hegel à vingt-deux ans disons. Ce sont des personnages qui vous accompagnent, vous hantent et avec lesquels on peut se mettre en route. Et c’est peut-être vrai sans doute des lectures de jeunesse, autant pour la BD que la littérature. « L’insurgé » de Vallès m’a séduit même si à quinze ans la question politique, du camp politique ne se pose pas encore et qu’on le lit comme Zola sans voir qu’ils ne sont pas du même bord. Donc Deleuze, c’était pour moi la rencontre d’un philosophe qui avait déjà publié son œuvre, juste après Mille Plateaux.

La rencontre d’une œuvre, mais en même temps la rencontre du philosophe vivant. Je ne connais pas beaucoup de monde dans le champ de l’édition ou de la presse. Mais j’ai réellement rencontré des philosophes comme Deleuze, Derrida, Lyotard, Badiou, Rancière… On pourrait en ajouter d’autres en ce que la rencontre n’est pas seulement un rendez-vous, mais un carrefour sur lequel tout se met à bifurquer. Au point que je lis Hegel en même temps que la SF, Deleuze en même temps que Derrida, Ridley Scott qui a eu la gentillesse de répondre à mon livre sur lui et Philip K. Dick… Il s’agit donc comme vous dites d’un devenir dans le jeu de la différence et de la répétition. Que faire d’autre ? Je n’écris pas pour des recensions. Un texte réel entre plutôt dans quelque chose comme la bibliothèque à Babel pour rappeler Borges. Il se compose avec d’autres écrits. Deleuze reprend mon travail dans Qu’est-ce que la philosophie ? à deux endroits du livre et m’envoie des lettres.
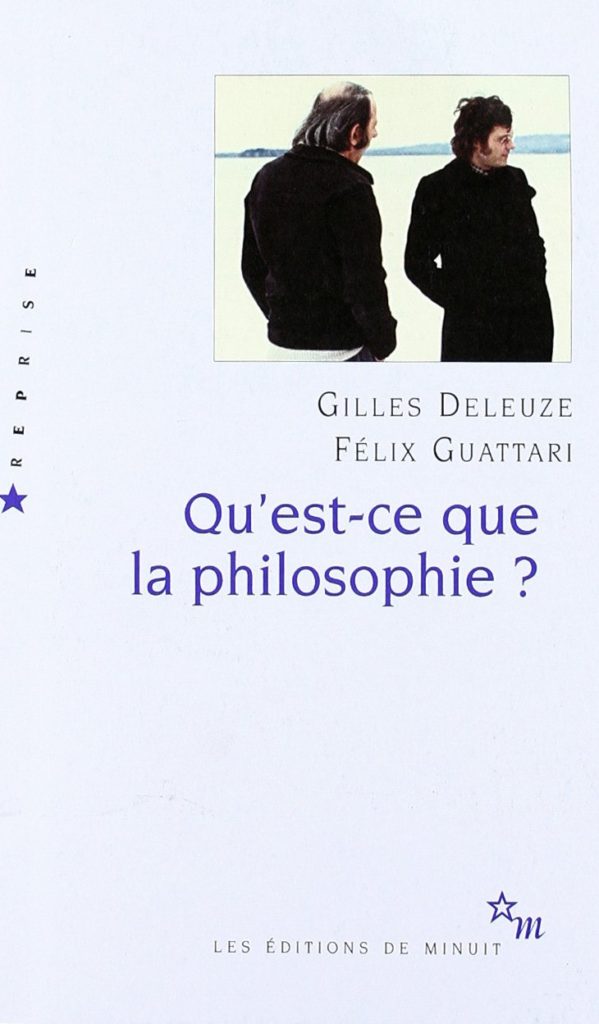
Il n’y a pas meilleures preuves d’amitié. Mais ce n’est pas une recension. Derrida consacre une séance de son séminaire sur La bête et le souverain à mon livre Ossuaires. Alors oui, il s’agit d’une ligne amicale, l’ami étant celui qui vous entraîne vers d’autres lieux, dans une espèce de « groupe de transformation » pour reprendre une idée mathématique, ou encore une multiplicité qui fonctionne comme autant de pistes de décollage. Est-ce que mes livres viennent multiplier ceux de Deleuze ou Derrida ? Je l’espère bien, sachant que la multiplication ne soustrait rien, ne se contente pas d’additionner, mais transforme, au sens de la retenue dans une opération. Chose que Hegel appelait Aufhebung. Donc oui, je me sens comme une retenue, une relève de cette époque plus qu’un simple représentant. On ne représente jamais rien, on ne peut que transformer et lancer un peu plus loin la flèche qu’on retient pour sa puissance de fendre l’espace.
Vous évoquez d’autres rencontres en dehors du champ de la philosophie : particulièrement en littérature (Borges, Dick) et cinéma (Ridley Scott). Et vous dressez le portrait d’un philosophe à la fois lecteur aguerri et cinéphile. Que doit la philosophie à la fiction ? Quels rapports philosophie et fiction entretiennent-ils ?
Oui, on s’imagine Ridley Scott comme un cinéaste commercial pris dans le seul souci de rentabilité. Que dire alors d’un auteur qui publie un livre chez Gallimard ou qui rêve de la Pléiade ? Ce n’est pas nécessairement un désastre au sens que j’évoquais tout à l’heure.
L’insurveillé, ce mot de Rilke, me convient bien mieux pour des œuvres accessibles à tous.
Jean-Clet Martin
Les grands auteurs trouvent une reconnaissance en raison d’une résistance réussie. Borges l’a eue en deux volumes, sa Pléiade. Et Dick vient d’être publié en Quarto. Etaient-ils des auteurs grand public ? Et pourquoi serait-ce un problème d’aller vers une culture populaire ou plutôt ce que j’appellerais un mouvement de contre-culture pour sortir du musée aseptisé par tant de gardiens, surveillé en l’occurrence par des caméras -ce qu’on comprend bien vue la valorisation du marché de l’art. L’insurveillé, ce mot de Rilke, me convient bien mieux pour des œuvres accessibles à tous. Blade Runner est un film qui n’a pas vraiment satisfait en termes de marché, à sa sortie.

Il prend sa revanche pas le biais de la vidéo, du DVD et connaît trois fins différentes. Il repose la question du « sujet », du « je » confronté à l’androïde, au réplicant en donnant au philosophe que je suis un concept d’humanité qui n’est pas seulement augmentée, ce qui serait le rêve du milliardaire pour rejouer son existence, mais qui correspond précisément au désir de sortir d’une vision cloisonnée de l’Homme, voire à la mort de l’Homme au sens donné à cette expression par Michel Foucault. C’est pas mal déjà me semble-t-il. C’est Nietzsche qui saisit que l’homme comme « maitre et possesseur de la nature », cette image de l’homme saisie comme seul ressentiment pour la Terre, cette croyance aux arrière-mondes, doivent être dépassées. Alors faut-il brûler les postmodernes ? cette question surgit au croisement de la philosophie et de la fiction, la SF aspirant à sortir de l’humanité vers des formes de vie, des modes d’existence qui explorent d’autres facultés que celles de la domination occidentale, loin de la programmation spatiale, des richesses données par l’appât d’un autre monde.
Ces auteurs et cinéastes vous permettent de créer des concepts. Vous parlez même de « personnage conceptuel » à propos du Malin Génie en lien avec Philip K Dick. Peut-on dire qu’il y a ici quelque chose de gnostique, le Malin Génie comme mauvais Démiurge ? N’y aurait-il pas là une volonté de chercher la limite de la pensée quitte à se perdre ?
Disons que le Malin Génie, ça commence avec les Méditations de Descartes. L’idée d’un Dieu trompeur, ou en tout cas d’une Dieu qui aurait lui-même pu se tromper. Ça c’est du reste quelque chose qu’on retrouve dans la correspondance de Van Gogh au sujet d’une Création ratée. Mais c’est également un motif récurrent chez Borges qui s’y connaissait en Malin Génie. Disons qu’avec Ridley Scott, on est bord du créateur malfaisant. David est issu de la volonté malade d’un créateur qui s’identifie à Dieu. Il confie à une machine la puissance de trouver pour lui son éternité. Et finalement ce que Ridley Scott nous fait comprendre, c’est que ce n’est pas la créature qui porte la responsabilité de ce ratage. Le pêché n’est pas imputable à la créature mais à son créateur. Dans Blade Runner, il est étranglé par sa créature et dans Prometheus David va également se retourner contre celui qui en était le concepteur.

C’est un peu la reprise du monstre de Frankenstein qui n’a pas demandé à vivre et qui fait porter le poids de son échec à celui qui, par désir de toute puissance, l’a si mal contraint à l’existence, le jetant au monde par un procédé immonde. On est passé dans l’univers d’un romantisme anéanti qui convient parfaitement à Ridley Scott, entre Byron et le couple Shelley qui se sont croisés en Suisse, au bord d’un lac pour penser la nuit à quelques monstres : Byron à Nosferatu dont il est l’initiateur, Mary à Frankenstein et son mari à Ozymandias. Les statues sont tombées, on est en plein dans l’ambiance de Prometheus…
Votre bibliographie est plutôt conséquente. Elle se montre comme une constellation d’étoiles philosophiques différentes à la vue du voyageur interstellaire. Peut-on dire que la bibliographie devient cartographie, et que le philosophe devient aventurier ?
Les étoiles sont une passion d’enfance. Notamment la constellation d’Orion qui conduit un peu vers la figure du gladiateur, celui qui pratique sans doute la philosophie à coups de marteau pour reprendre une formule de Nietzsche. Un art martial qui, cela dit, ne se suffit jamais seul. Toute constellation est à la fois le lieu d’une multiplicité, des éléments hétérogènes et schématiques qui se rassemblent, des fragments qui, à l’image de la ruine, se composent et reviennent cependant depuis l’aube de l’humanité dans le ciel hivernal. La ruine d’un ordre détruit, d’une explosion, d’un code qui refait surface comme autant de reliques célébrant sa survivance. C’est la figure mathématique de l’éternité, son image mobile. Donc sans doute que Biographie de l’éternité ou encore Bréviaire de l’éternité sont deux livres qui entrent dans cette multiplicité, un peu comme un coup de dés qui fait du hasard l’élément central.
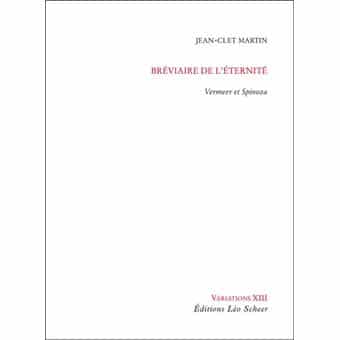
Mais c’est en même temps un coup de dés pour Igitur qui, depuis son escalier, entre dans la construction du monde, dans la loi de son éternel retour. Mallarmé en tout cas en tant que poète de la modernité se place très loin de la littérature bourgeoise autant que de la mort de l’art. C’est ce qui me plaît chez lui lorsque le bateau tangue et que se montre, ivre, une dernière constellation dont évidemment ma mort ne saurait ternir la puissance. Chose que le créateur de David, pris dans une fausse vision de l’éternité, la sienne, n’avait pas saisie dans Prometheus qui est décidemment un très bon film !
Pour finir, que vous évoque le terme de « Cultures Sauvages » ?
Ce serait sans doute ce que j’ai appelé « contre-culture » à l’instant. Quelque chose qui insiste dans les marges. Une ambiance, une atmosphère que Derrida me fait découvrir par son livre « Marges de la philosophie ». Être en marge, ce serait peut-être le destin de toute pensée réussie, le signe même d’une idée qui n’est pas issue du seul consensus devant les faits.