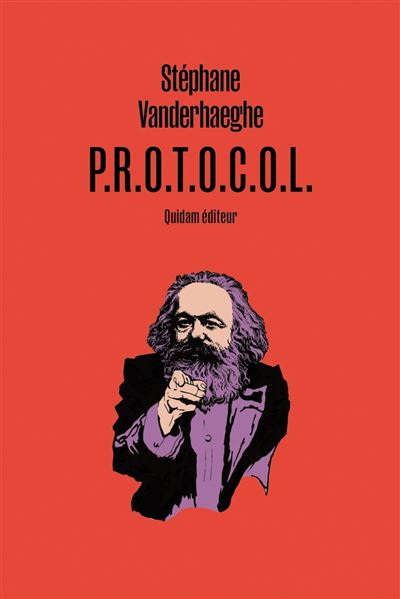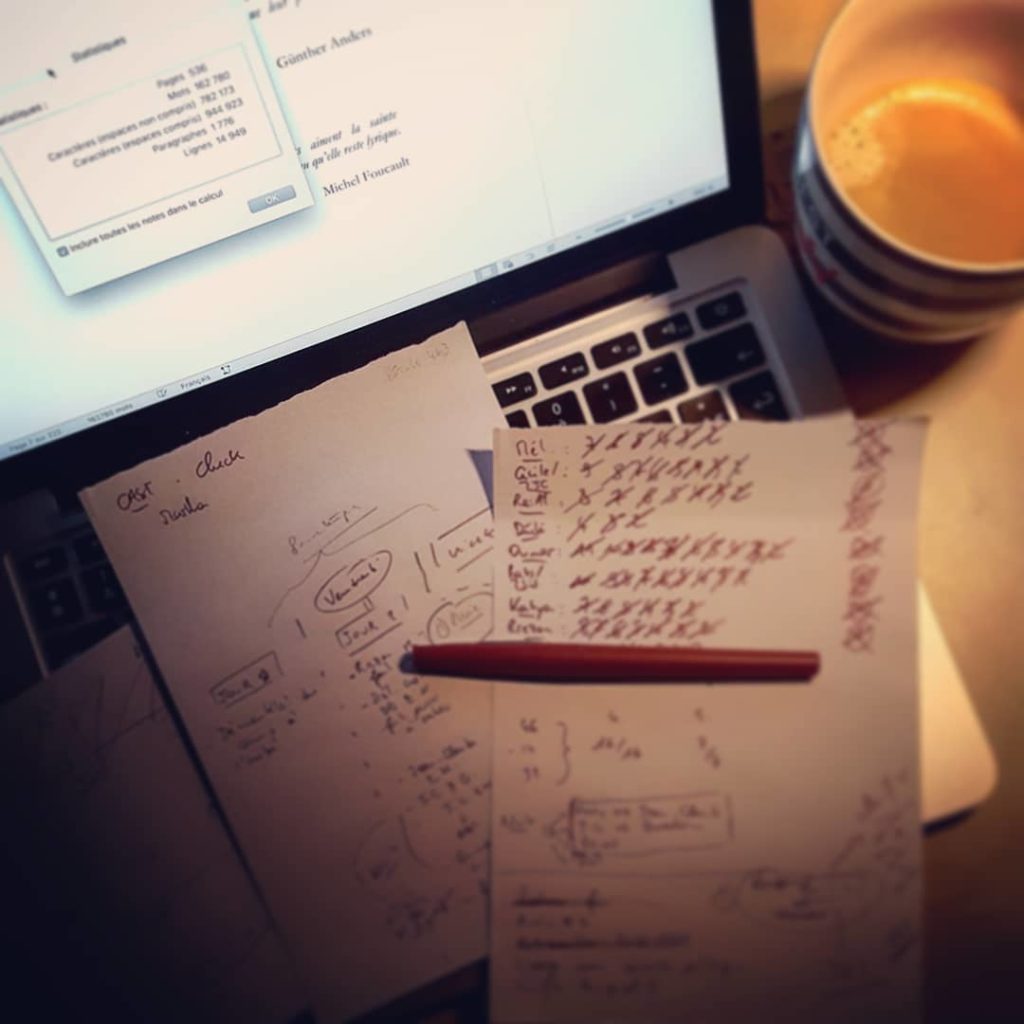
1.Dans tes trois romans, la langue et les mots occupent un rôle déterminant. Conçois-tu les mots comme un personnage à part entière ?
Non, pas vraiment. La langue est davantage un matériau à travailler, à façonner, sculpter, tailler, puis à agencer. J’essaie d’entretenir avec la langue un rapport matériel, ce qui peut se manifester par des découpages ou des textures plus ou moins visibles sur la page. Malgré le parti pris sans doute conceptuel de mes deux premiers romans, j’essaie de prêter attention à la chair du langage, au corps de la langue, en me plaçant à la surface du texte, sur le plan de la lettre en quelque sorte.
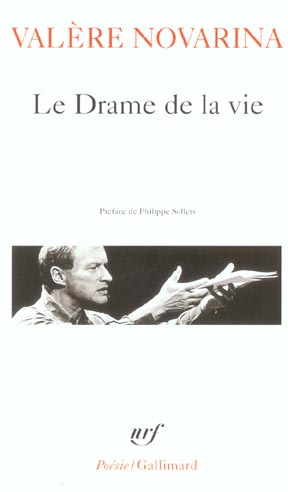
2. Dans Charøgnards, les mots tendent à s’effacer à la fin du roman. Dans Le drame de la vie, Valère Novarina voit la langue comme un déséquilibre : « Le langage est un édifice de déséquilibres et de souffles. C’est notre manière à nous les humains, de construire, d’édifier avec le vide. Et dans la manière il y a main. » L’érosion de la langue répond-elle chez toi à un rapport à l’indicible et au vertige de ce qui ne peut être dit ?
Non. Je n’ai pas l’impression, en écrivant, de graviter autour d’un manque ou d’une impossibilité. Il y a des béances et des creux, mais que je conçois sans doute différemment, de façon peut-être plus mécanique que métaphysique. Les absences sur lesquelles ont pu se construire mes textes sont précisément ce qui rend possible leur écriture, ce qui littéralement met l’écriture en mouvement. Deleuze dit des choses là-dessus, je ne sais plus où, peut-être dans Logique du sens ? Je ne sais plus. Mais il explique que l’absence – pas sûr d’ailleurs que ce soit le mot qui l’emploie –, que la case vide – oui, ça me revient, la case vide –, c’est justement ce qui introduit du jeu dans la mécanique. Et c’est davantage comme ça, il me semble, que les choses opèrent en ce qui me concerne. Il y a quelque part dans le texte un creux, une case vide, un silence, un mystère, une inconnue, que je ne cherche pas tant à approcher, à percer à jour, à tenter de dire ou de communiquer, qu’à circonscrire, qu’à parcourir, qu’à dessiner. J’y trempe la fiction, qui peut alors se déployer en tant que telle. Donc, oui, en un sens, c’est une entreprise de construction et d’édification avec le vide, comme le dit Novarina, et c’est quelque chose de très concret, car c’est quelque chose qu’on vient palper avec les mots, et des mots qu’on caresse du bout des doigts, qu’on sculpte avec la main.
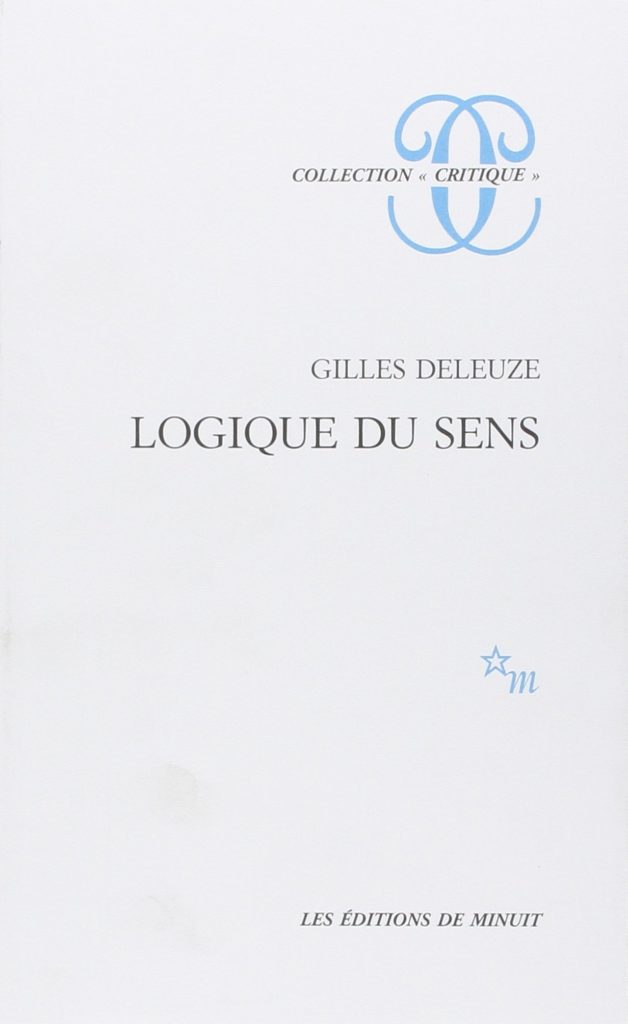
3. Quel rapport entretiens-tu avec l’orthographe des mots ? Est-ce autant un rapport écrit, que musical et plastique ?
Si je me souviens bien, pour Barthes, l’orthographe est quelque chose de très contraignant, de rigide – c’est la règle, le règlement, la loi ; il y a là-dedans quelque chose de prescriptif auquel on n’échappe pas et qui peut être un frein à l’imagination. Je suis pour ma part sensible à l’aspect visuel et plastique, davantage qu’à l’aspect musical du langage, dont la musique pour moi demeure silencieuse. Tout se passe sur la page, avec laquelle j’entretiens un rapport visuel.
Je suis pour ma part sensible à l’aspect visuel et plastique, davantage qu’à l’aspect musical du langage.
Stéphane Vanderhaeghe
C’est la raison pour laquelle j’introduis dans P.R.O.T.O.C.O.L. de façon très ponctuelle des graphies parfois alternatives, l’esperluette par exemple dans certaines sections du livre, ou des polices différentes, qui permettent de baliser le texte visuellement, de le dessiner en lui donnant une certaine épaisseur ou texture à même la page. Vu de l’extérieur, j’ai conscience que ça peut paraître anecdotique, ou relever de l’affèterie, mais c’est aussi l’affirmation de ce rapport tactile, matériel, visuel que j’ai avec le texte.
4. La page apparaît d’ailleurs comme un lieu d’expérimentation et de création au sens où tu la conçois comme lieu des possibles. Dans Charøgnards, le o est traversé d’un trait. Dans À tous les airs, on trouve des pages utilisant des pages manuscrites. Dans P.R.O.T.O.C.O.L., le titre lui-même semble par les lettres-mêmes du titre appeler d’autres mots, sachant que ce mot apparait sur les murs de la ville. En quoi l’écriture est-elle le lieu d’une liberté et d’une possibilité de tordre et de distordre l’orthographe ?
P.R.O.T.O.C.O.L. est un acronyme dont le sens est révélé à la fin du livre : derrière chaque lettre se cache un mot, ces mots pris ensemble pointant vers autre chose. Je dirais que l’écriture est avant tout le lieu ou l’espace d’une expérimentation et que cette expérimentation passe par la langue, qui lui donne corps – et inversement. La seule réalité à laquelle je suis confronté, à laquelle je me frotte quand j’écris, c’est celle de la langue. Le reste n’existe pas, ou alors sa réalité est elle-même forgée dans la langue. Le peintre travaille avec la peinture, les couleurs, les pigments, sa toile. Moi je travaille avec les mots, leur graphie, cette façon qu’ils ont de se coucher ou de se redresser sur la page, d’en sculpter la blancheur, de la scander, etc. Les mots, la langue : je les considère comme des objets que je dois agencer, mais ce ne sont pas des outils en vue d’une fin ; je veux dire qu’à travers les mots je ne vise pas autre chose, du sens ou une vérité, par exemple. La langue de l’écrivain – et je ne parle pas pour moi exclusivement mais de façon plus générale – n’est pas la langue-outil dont on se sert pour communiquer, pour renvoyer à des opérations de la vie de tous les jours.
Le livre tente d’inventer sa propre langue, en quelque sorte. C’est du moins l’idée que je me fais, avec d’autres, de l’écriture.
Stéphane Vanderhaeghe
C’est une langue pétrie, façonnée, rendue à sa propre matière et à ses effets. Si P.R.O.T.O.C.O.L., par exemple, paraît plus narratif que ses prédécesseurs, plus politique aussi, c’est, je pense, parce que sa langue dégage des effets de narration et d’enchaînement, crée du liant, cherche des rapprochements, des résonances, dessine des mouvements plus déterminés qu’ils ne pouvaient l’être dans les romans précédents – la langue d’À tous les airs était par exemple plus cyclique, circulaire, fondée sur le modèle de la ritournelle, du retour sur soi. La langue de P.R.O.T.O.C.O.L. – ou ses langues, car elles sont multiples, il me semble – vient se fondre dans des modèles rhétoriques plus facilement repérables et identifiables, vient imiter certains types de discours, etc. Et tout ceci fait l’objet d’un travail, et ce travail ne relève pas d’une sorte de conformisme ; je veux dire par là qu’il n’y a pas de modèle préexistant, normé, qu’il s’agirait de reproduire (l’ortho-graphe, en deux mots). Le livre tente d’inventer sa propre langue, en quelque sorte. C’est du moins l’idée que je me fais, avec d’autres, de l’écriture. Reste à savoir si P.R.O.T.O.C.O.L. a réussi à inventer sa langue ou s’il demeure pris au piège de logiques discursives, et de régimes de sens préexistants…
5. Ton travail de traducteur a-t-il transformé ta manière de construire une histoire et de l’exprimer avec des mots ?
Pas que je sache, non. La traduction me force parfois à aller piocher dans des régions inconnues de la langue, dont je ressors avec certaines choses – des mots spécifiques, des expressions qu’il a fallu forger, des métaphores, quelques trouvailles etc. –, et certaines de ces choses peuvent ensuite passer, un peu en contrebande, dans mes textes, mais c’est assez rare ; ou si ça ne l’est pas, ce n’est pas toujours conscient. Ça reste plutôt ponctuel, j’ai l’impression.
La traduction est un exercice de recréation, une sorte d’écriture à contraintes, quasi oulipienne ; l’autre est un travail d’invention, une « construction avec le vide » pour reprendre la citation de Novarina.
Stéphane Vanderhaeghe
La traduction ne me fera pas aborder mon écriture de manière radicalement différente. Pour la simple raison que ce sont deux régimes d’écriture distincts, que je n’opère pas de la même manière. La traduction est un exercice de recréation, une sorte d’écriture à contraintes, quasi oulipienne ; l’autre est un travail d’invention, une « construction avec le vide » pour reprendre la citation de Novarina que tu as utilisée. Les règles ne sont donc pas les mêmes. Ce qui, bien évidemment, n’empêche pas que les deux pratiques puissent communiquer à un certain niveau, mais sans que je sois en mesure de l’identifier avec précision, ni certitude.
P.R.O.T.O.C.O.L. de Stéphane Vanderhaeghe aux éditions Quidam, à paraitre le 3 février.