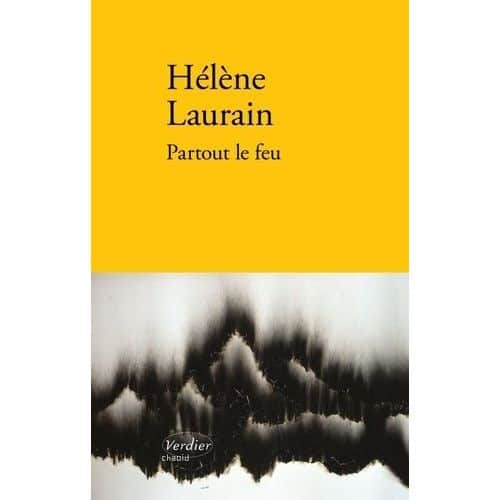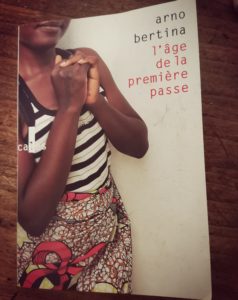Ce premier roman est une déflagration. Il vous parle directement. Chaque page semble battre, chaque phrase cherche à rendre électrique notre corps social et politique. La phrase est pareille à une respiration cardiaque et poétique. La page ou 120 mots par minute. Le personnage principal de Laetitia apparaît comme la figure bouleversante d’un rapport entier et premier au monde. A travers ses parents, sa sœurs jumelle, ses amis, on entend tout un monde battre. Dans Partout le feu aux éditions Verdier, Hélène Laurain orchestre un feu d’artifice poétique, musical et charnel de langue. Dans ce roman, partout le rythme, partout la révolte, partout le son, partout la frénésie des lettres.Entre la forme furieuse et syncopée d’Arno Schmidt et la langue volcanique et brûlante d’Anne Carson, Hélène Laurain propose avec ce premier roman une expérience électrique et habitée faisant résonner le devenir-femme avec un devenir-langue.

1. Ce premier roman interroge le genre du roman. Partout le feu tient autant du roman par la richesse des fictions qu’il déploie que de la poésie par sa forme et son rythme. L’espace littéraire auquel appartient votre roman est-il un espace poreux qui questionne les genres et les frontières ? Cette porosité est-elle une manière d’interroger l’espace politique, au sens où l’expression et la langue utilisés sont des espaces de liberté et d’identités multiples ?
En tous les cas je me suis accordé une grande liberté dès le départ de ce point de vue en ne me posant simplement pas la question de ce qu’était l’obet qui était en train de s’écrire. Le roman est de toute façon un genre-valise qui accueille des formes et des sujets a priori limites, on le voit par exemple avec l’auto-fiction ou la narrative non fiction qui ont profondément changé ce que pouvait désigner le roman dernièrement ; et je trouve que c’est effectivement particulièrement intéressant de venir se frotter aux frontières de ce qu’il est et de ce qu’il n’est pas, ce que nombres d’écrivain.e.s ont toujours fait. Ariane Jousse par exemple définit son texte La fabrique du rouge non pas comme roman, un poème, mais une forêt, que l’on traverse, dans laquelle on erre, voire s’exile.

L’enjeu pour moi était de trouver la forme juste pour parler de certaines expériences contemporaines, intégrer les formes graphiques qui imprègnent nos représentations en raison de notre fréquentation assidue des textes numériques, ces bandes ou fragments sans ponctuation, et qui peuvent mimer la poésie, les paroles de chanson, les flux en tous genres. Je voulais aussi qu’on entende à travers Laetitia et les autres personnages les langues d’aujourd’hui, teintées par exemple par certaines expressions que l’on entend dans le Grand Est. À travers Margaux, la sœur jumelle de Laetitia, on entend la langue chargée d’anglisicmes qu’on retrouve dans certains métiers, à travers Pépou, on entend la langue de la génération d’après-guerre. Et cette forme juste se trouve effectivement d’après moi dans le mélange, la polyphonie voire le chœur, ce qui s’inscrit dans la porosité que vous évoquez.
J’étais pétrie d’une préoccupation poétique forte au sens, disons, musical du terme : donner une attention maximale au rythme, au ton, à la mélodie, aux silences, à l’harmonie et aux dissonances que peuvent créer tous ces éléments assemblés.
Hélène Laurain
Mais il ne s’agissait effectivement pas seulement de procéder strictement par cut-up de morceaux de réel, comme nous invite à le faire Kenneth Goldsmith. J’étais pétrie d’une préoccupation poétique forte au sens, disons, musical du terme : donner une attention maximale au rythme, au ton, à la mélodie, aux silences, à l’harmonie et aux dissonances que peuvent créer tous ces éléments assemblés. Et dans cette radicalité multiple pouvaient se couler un contenu lui aussi radical et polyphonique, et le désir, la revendication d’écoute qu’expriment Laetitia et ses camarades.
2. Ce roman est autant le portrait de Laetitia, une jeune femme surdiplômée en quête de sens que d’un groupe d’activistes auquel elle appartient en quête d’utopie et de sociétés alternatives. Cet entremêlement du singulier et du collectif s’est-il imposé à vous dès le départ ?
La colonne vertébrale demeure pour moi le personnage de Laetitia, et le collectif apparaît en creux, à travers son absence, figurant le deuil de la communauté qui ne peut plus se former et agir en raison de la répression. C’est pourquoi les moments collectifs sont en réalité des flashbacks, des rêves : fantômatiques et révolus. Mais la trajectoire de Laetitia m’intéresse effectivement dans son artculation avec le collectif, ce qu’il a de flamboyant et de structurant : le livre commence par une action collective, inspirée par le feu d’artifice de militants de Greenpeace dans l’enceinte de la centrale de Cattenom, en Moselle, en 2017. Le procès des activistes se déroulait au début de l’écriture de Partout le feu.
La trajectoire de Laetitia m’intéresse effectivement dans son artculation avec le collectif, ce qu’il a de flamboyant et de structurant.
Hélène Laurain
J’ai voulu évoquer la joie de militer ensemble et le vide dans lequel l’interdiction de collectif fait plonger Laetitia. J’ai voulu toucher à cette perte de repères qu’elle entraîne : comme les gymnastes, à l’instar de la jeune prodige Simone Biles, qui connaissent une « perte de figure », c’est-à-dire une perte subite de repères spatiaux en pleine acrobatie. Celle-ci les menace de blessures graves, et Laetitia est dans ce moment dangereux (et parallèlement, nous), où elle risque de se faire très mal, à mois qu’elle ne parvienne – et n’accepte – de tout réapprendre.
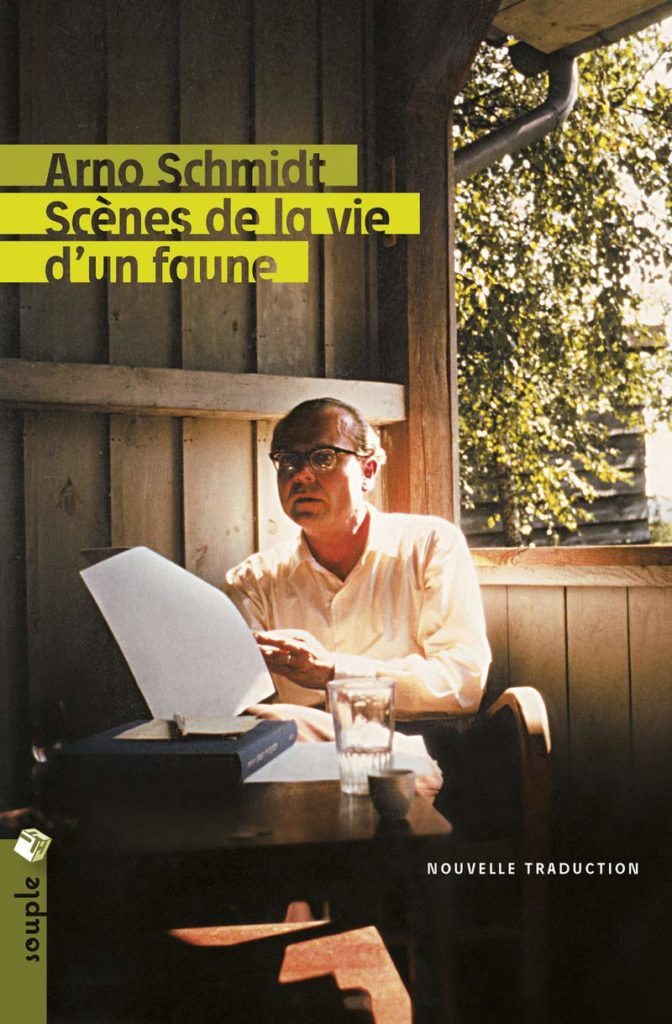
3. Partout le feu travaille avec force et intelligence sur la narration en la déconstruisant, sans faire suivre par exemple l’ordre chronologique de la vie de Laetita. On retrouve au fil du roman différents épisodes de sa vie mais de manière éclatée, un peu à la manière d’Arno Schmidt. Dans Scène de la vie d’un faune, le narrateur exprimait la vision suivante : « Ma vie ? ! ; n’est pas un continuum ! (pas seulement qu’elle se présente en segments blancs et noirs, fragmentés par l’alternance jour, nuit ! Car même de jour, chez moi, c’est pas le même qui va à la gare ; qui fait ses heures de bureau ; qui bouquine ; arpente la lande ; copule ; bavarde ; écrit ; polypenseur ; tiroirs qui dégringolent éparpillant leur contenu ; qui court ; fume ; défèque ; écoutelaradio ; qui dit « monsieur le Sous-préfet » : that’s me !) : un plein plateau de snapshots brillants.
Pas un continuum, pas un continuum ! : tel est le cours de ma vie, tel celui des souvenirs (de la façon qu’un spasmophile peut voir un orage la nuit) ». En quoi le roman permet-il d’exprimer cette non-continuité du vivant et de l’existence ?
Merci de citer Arno Schmidt qui constitue assurément l’une des références importantes de ce livre. Je ne sais pas si le roman en tant que tel permet cela, mais en tous cas le fait de le faire imploser avant de recoller ses morceaux permet, à mon sens, de mimer plus justement la façon dont notre conscience s’organise ou celle dont on traverse l’existence : hyperstimulée, avec une capacité de concentration souvent affaiblie ou en tous cas en permanence dérangée, baignant dans une coexistence du présent, du passé (souvenirs/flashbacks) et de l’avenir (projections/angoisses), de l’ici et de l’ailleurs. Et comme vous le dites cette non-linéarité n’est pas propre à l’humain, puisque les animaux parfois hibernent, que les plantes ne croissent pas régulièrement, que les rivières gonflent et s’assèchent.
Il y a de si nombreuses formes autres que celles de la ligne que j’ai envie d’explorer littérairement.
Hélène Laurain
Il y a de si nombreuses formes autres que celles de la ligne que j’ai envie d’explorer littérairement : je pense spontanément aux segments blancs et noirs qu’évoque Arno Schmidt qui me rappellent la partition musicale, au cercle, à l’éllipse ou la spirale, ou encore à des formes beaucoup plus organiques, chaotiques et luxuriantes. je pense que la forme doit être réinventée à chaque texte. La ligne, dans ce qu’elle suppose d’un début et d’une fin à atteindre, d’une croissance ou d’une stagnation, d’une unidimensionnalité, paraît tellement limitante et incarne des schémas de pensée contre lesquels Laetitia et ses ami.e.s s’inscrivent. A l’inverse, le cycle, comme celui du compost dont il est question à la fin du livre à travers une citation du documentaire Wild Plants, donne du sens à la fin des choses, puisqu’elle ne fait que précéder une renaissance, et accessoirement ce cycle console, puisqu’il abolit justement les fins.
4. Le roman possède ainsi une forte charge littéraire, par l’emploi des nombreux surnoms donnés aux personnages. A quel moment ces surnoms sont-ils intervenus dans l’écriture ? En quoi sont-ils les révélateurs d’une vision poétique et transfigurée du monde ?
Les surnoms sont survenus tout de suite. Les personnages secondaires les plus importants (Fauteur, Pépou, Mémou, La Sœur, Mamipié, Dans-le-sens-où) sont désignés quasi-uniquement par leur surnom, ce qui marque déjà le fait que l’on voit tout à travers le regard de Laetitia, qu’on partage son intimité et sa représentation du monde.
Trouver des surnoms signifiants est un des grands plaisirs d’écriture pour moi : c’est léger, c’est rapide, ça m’amuse.
Hélène Laurain
De plus, le fait qu’elle seule quasiment soit nommée signale à mon sens son isolement : les autres apparaissent à travers leur surnom, soit à travers des souvenirs, des flashbacks, soit dans des discussions avortées, empêtrées dans le silence ou l’incommunicabilité. Il y a donc tout un feuilleté d’intermédiaires qui sépare Laetitia des autres, et les surnoms en font partie. Mais je dois dire aussi que tout simplement, trouver des surnoms signifiants, de même que des noms de lieux et de ville, est un des grands plaisirs d’écriture pour moi : c’est léger, c’est rapide, ça m’amuse.

5. Le titre Partout le feu comporte autant une part littéraire que politique. Le feu indique autant ce qui peut embraser la page et la forme du texte que sa forme politique dans l’idée de révolte et de destruction. Dans In girum imus nocte et consumimur igni, Guy Debord écrivait ceci : « Mais rien ne traduisait ce présent sans issue et sans repos comme l’ancienne phrase qui revient intégralement sur elle-même, étant construite lettre par lettre comme un labyrinthe dont on ne peut sortir, de sorte qu’elle accorde si parfaitement la forme et le contenu de la perdition : In girum imus nocte et consumimur igni. Nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes dévorés par le feu. » Le feu est-il pour vous autant un moyen de vous perdre que de trouver une porte de sortie ?
Le feu, dans toutes les dimensions qu’il me permettait d’explorer et d’invoquer du point de vue littéraire, a été effectivement un moyen de me perdre tout en gardant des repères ponctuels, des lumières dans la nuit, que m’offraient par exemple les occurrences du feu dans les chansons, ou encore les références aux œuvres portant sur le nucléaire. L’écriture a été relativement rapide (quelques mois), portée par une urgence, une énergie très intense, et je me suis laissée porter par ce geste, acceptant d’avancer dans le noir (sans tourner complètement en rond, je l’espère), et de découvrir au fur et à mesure ou cela allait m’emporter, éclairée par quelques foyers lointains.
Pour moi il était important que le feu de Laetitia ne soit pas celui de la folie (et encore moins, évidemment de l’hystérie) mais d’une certaine forme d’action politique.
Hélène Laurain
Le feu, cette fois-ci dans sa dimension plus politique, représente en tous les cas pour Laetitia et ses camarades une porte de sortie politique. Elle ne se contente pas de « brûler de douleur et faire avec », elle l’utilise, ainsi que ses comparses, à des fins politiques et de manière calculée et contrôlée, et s’inscrit dans une histoire politique et révolutionnaire du feu. Pour moi il était important que le feu de Laetitia ne soit pas celui de la folie (et encore moins, évidemment de l’hystérie) mais d’une certaine forme d’action politique.
6. A la lecture, on est donc impressionné par la musicalité de cette prose heurtée et liquide. On trouve de nombreuses références musicales à des chansons appartenant au répertoire rock, folk ou électro. Vous reproduisez d’ailleurs quelques extraits de ces chansons. Cela est-il le moyen de créer un effet d’identification du lecteur ou un effet d’étrangeté et du déjà vu ou déjà entendu ?
J’ai intégré ces morceaux à la fois pour leurs paroles, mais aussi parce qu’ils me permettaient de faire du roman une longue chanson : graphiquement, il en a la forme, et j’ai beaucoup travaillé les sonorités et le rythme. Il était donc pour moi évident de faire entrer des chansons dans cette forme plastique qui me le permettait. Par ailleurs, ce livre a été écrit en musique, ce que je ne faisais pas jusqu’à présent, et l’arrivée régulière des paroles de chanson vient le rappeler.
Il y avait donc effectivement l’idée d’emporter avec moi les lecteurs et lectrices dans l’énergie de chaque scène.
Hélène Laurain
Dans la scène de fête par exemple, il y a de nombreuses paroles de chansons qu’on est certainement beaucoup à reconnaître ou qu’on peut chercher, si on le souhaite, afin de se recréer une playlist de fête en l’écoutant. Il y avait donc effectivement l’idée d’emporter avec moi les lecteurs et lectrices dans l’énergie de chaque scène, en lui donnant la liberté d’enrichir l’expérience de lecture en l’écoutant en même temps.
7. Ces chansons fonctionnent un peu comme des ritournelles, avec notamment la référence régulière à Nick Cave. Pour Gilles Deleuze, la ritournelle exprime notre rapport au territoire, avec l’idée d’y rester, d’en sortir ou d’y revenir. Votre roman interroge aussi notre rapport au territoire, comment nous essayons de l’habiter et de lutter, notamment par les actions de ce groupe d’activistes. La musique, le cinéma avec notamment la référence au film Wild Plants de Nicolas Humbert ou encore les arts plastiques permettent-ils de sortir de notre territoire social pour proposer des lignes de fuite politique et artistique ?
Je pense que ces ritournelles, dans cette acception, peuvent fonctionner dans deux sens opposés : écouter les mêmes musiques, lire le même genre de livres et regarder toujours les mêmes films risque de nous enfermer dans un confort esthétique, un système clos qui peut tendre vers un appauvrissement, et par là-même un conformisme politique. J’ai pourtant un rapport obsessionnel aux musiques que j’aime et peux les écouter exclusivement pendant plusieurs années. Ca a été le cas pour la musique de Steve Reich qui m’a accompagnée pendant l’écriture. Il y a quelque chose de fascinant, quasi-magique, à découvrir toujours quelque chose de neuf dans ce que l’on connaît et à se retrouver aligné par les premières notes d’une chanson connue par cœur.
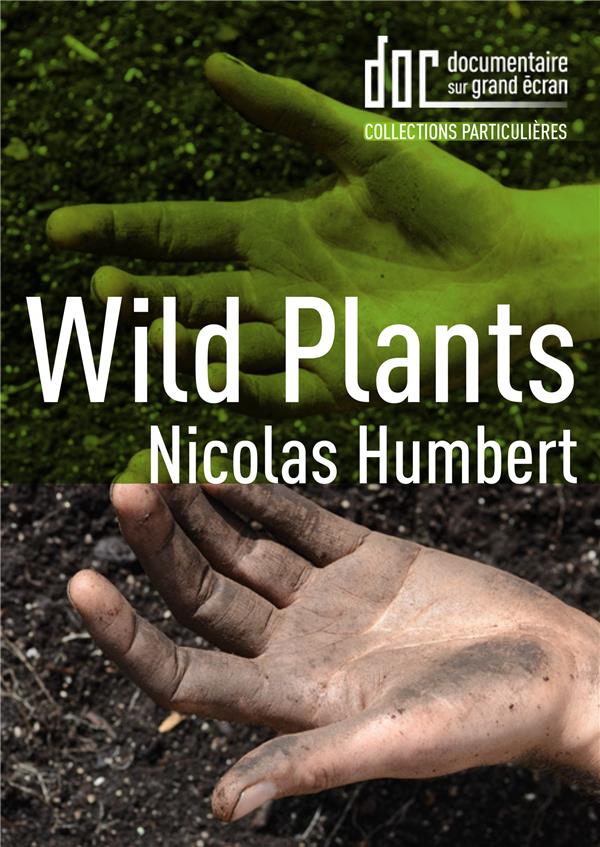
Mais s’il n’y a jamais rien pour venir creuser une brèche dans l’habitude et si le goût en vient à se calcifier, on se retrouve piégé dans la même histoire. À l’inverse, découvrir une œuvre, et souvent cela passe par les autres, qui va compter pour nous, nous déplacer, nous secouer, nous déplaire agréablement, contredire nos certitudes, ou simplement faire résonner en nous des choses que l’on ne soupçonne pas encore, nous extrait de ce confort esthétique et politique. C’est ce qui m’est arrivé par exemple avec Wild Plants, et ce genre d’étonnement, de choc est pour moi le déclic essentiel pour pouvoir me lancer dans un nouveau projet.
8. Vous êtes également traductrice. Sylvie Durastanti, autrice d’un premier roman intitulé Sans plus attendre chez Tristram, a consacré un essai à la traduction intitulé Éloge de la trahison dans lequel elle déclarait dès le début : « Traduire, c’est éprouver que les mots manquent. Continûment. Définitivement ». Avez-vous ressenti la même chose lors de l’écriture de Partout le feu ?
Je le ressens tous les jours, pas seulement dans l’écriture. Et heureusement que les mots manquent ! Si le sens était toujours plein à craquer, on serait piégé dans un discours clos sur lui-même, qui touche au délire. Et je vois l’écriture comme une tentative de trouver ces mots qui manquent (et la justesse peut se loger dans le sens, le son, le rythme, le graphisme, etc.) ; mais on se contente de tourner autour du sens, de le circonscrire le plus étroitement possible, sans jamais y parvenir, et tant mieux, sinon il ne faudrait plus écrire.
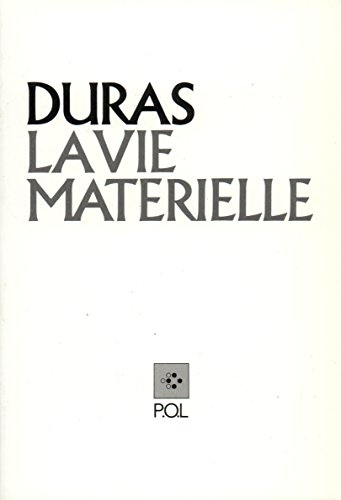
Si on pense la traduction comme, elle aussi, un travail d’écriture et de création, même si les enjeux sont différents, on peut alors reconnaître le même manque. Avec, en plus, la nécessité de faire passer la voix de l’auteur, en échouant à chaque mot à trouver la correspondance parfaite, qui évidemment n’existe pas. Je trouve cet essai continuel, assorti d’un échec continuel mais fertile, et l’humilité qu’ils imposent, très beaux. A ce sujet, je suis tombée aujourd’hui par hasard sur cette citation de Marguerite Duras (La Vie matérielle) : « Les tableaux, les écrits ne se font pas en toute clarté. Et toujours les mots manquent pour le dire, toujours. » J’écris comme j’avance dans le noir, et ça me plaît.
9. Dans Manifeste pour un parti du rythme, Henri Meschonnic faisait valoir le rapport entre le langage et la vie : « […] je dis qu’il y a un poème seulement si une forme de vie transforme une forme de langage et si réciproquement une forme de langage transforme une forme de vie […]. » Votre texte est nourri par cette interaction de la vie et du langage. Peut-on dire que votre roman est pareil à un poème d’après la phrase de Meschonnic ?
Oui, la vie imprime ses formes sur le langage et le plie, le déforme, le transforme. Et en tant qu’auteurs et autrices, nous tentons seulement de saisir et collecter ce changement déjà à l’œuvre, qui n’est pas de notre fait. Et à l’inverse, cette mise en forme change la vie, en tous les cas celle de celui ou celle qui écrit, car trouver cette forme c’est faire une pause dans le chaos, dans la cascade désordonnée de flux qui nous traversent.
La vie imprime ses formes sur le langage et le plie, le déforme, le transforme.
Hélène Laurain
J’ignore ce que cela change chez les lecteurs et lectrices, cela peut éventuellement déplacer le regard, l’ouvrir, cela peut être un changement très éphémère le temps de la lecture, et c’est déjà intéressant comme ça ; ou alors, accidentellement, cela peut changer une vie parce qu’une rencontre entre ce qui est cherché et ce qui est donné a lieu.

10. Dans Dédicaces et proverbes, Henri Meschonnic interrogeait aussi le geste même d’écrire :
« J’écris des poèmes,
et cela me fait réfléchir sur le langage.
En poète, pas en linguiste.
Ce que je sais et ce que je cherche se mêlent.
Et je traduis, surtout des textes bibliques.
Où il n’y a ni vers ni prose,
mais un primat généralisé du rythme, à mon écoute. »
Lors de l’écriture, est-ce que le rythme prime ? Ecoutez-vous la pulsation du texte ou est-ce à un moment donné la pulsation du texte qui vous entend ?
Je crois effectivement que le rythme guide mon écriture, en tous les cas dans Partout le feu. L’ayant écrit en écoutant de longues plages de musique au rythme égal, il me semble que cela se traduit en pulsation, et je vois le texte comme un tissu palpitant qui donne à voir ce rythme-là. Et l’écoute me semble effectivement primordiale, celle du texte qui s’écrit sous ma propre main, presque à mon corps défendant : une fois écrit je le dis et redis, le modifie, l’écoute à nouveau pour qu’il sonne. Et les rythmes et sonorités ne doivent pas être les mêmes au long du livre : parfois il faut que ça accélère, parfois l’inverse, que ça ronronne, que ça berce et parfois il faut trancher, faire buter, répéter pour réveiller, voire contrarier le lecteur, comme le font par exemple les mesures asymétriques (par exemple à 5 ou 7 temps) en musique. Et le tout doit former un équilibre, ou un déséquilibre qui a du sens. Parfois encore, il faut que les sonorités soient scintillantes, d’autre fois plus ternes, et jouer avec ce matériau me passionne.
11. Dans Autobiographie du rouge, Anne Carson ausculte son rapport au langage : « Les noms nomment le monde. Les verbes activent les noms. Les adjectifs viennent d’ailleurs. Ces petits mécanismes importés ont pour fonction d’attacher toute chose dans le monde à sa place. Ils sont les verrous de l’être. » Votre travail littéraire vous permet-il de déverrouiller l’être des choses ?
Je dirais qu’il y a dans ce travail littéraire premièrement le mouvement inverse : celui de fixer la beauté de ce qui a été, le souvenir, dans un geste nostalgique, ce qu’on retrouve en fait dans le genre du livre de deuil. On le voit notamment avec les passages sur Mémou, la mère de Laetitia, qui a disparu : comment traduire son absence, ce scandale banal de la disparition d’un proche, qui se rejoue sans cesse dans ce qu’il ou elle laisse derrière lui, souvent des objets, qui ont justement cette fonction de stabilisation du monde, de fxation -étymologiquement ce qui est jeté devant nos yeux, avec toute la violence que cela peut contenir – et réactive le manque.
Je crois effectivement que le rythme guide mon écriture.
Hélène Laurain
Le fait que Laetitia note des bribes du monde sur ses post-its procède de la même démarche : fixer, retenir les choses un instant, alors que comme nous, elle est emportée dans un flux, un rythme fulgurant, une disparition constante, quelque chose de liquide et de profondément précaire. À l’inverse, se laisser emporter par ce torrent (que j’ai essayé de traduire dans la forme) comme le fait Laetitia, cette fugacité, a quelque chose de libérateur, de jouissif, de transgressif. Et le mouvement chaotique dans lequel nous sommes emportés permet l’accident, la brèche. C’est peut-être l’étonnement que cela peut provoquer et le changement de regard qu’il entraîne qui a cette fonction de déverrouiller les certitudes, le confort que l’on trouve dans les discours et les habitudes qui nous bercent.
Partout le feu d’Hélène Laurain aux éditions Verdier