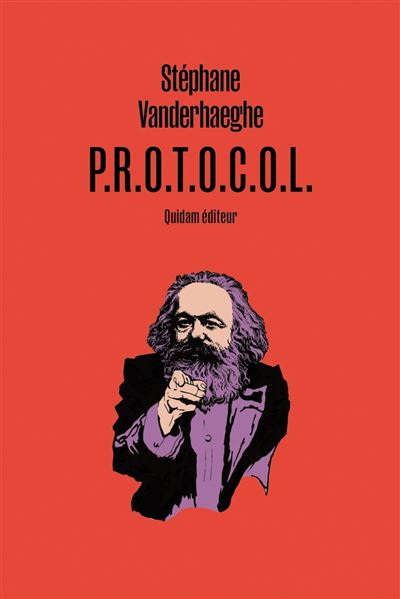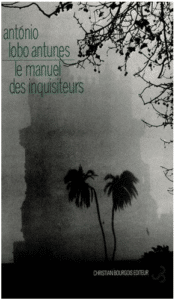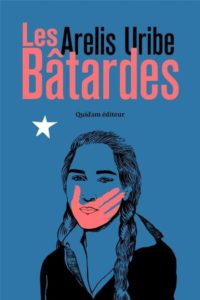1. A la lecture de ton dernier roman P.R.O.T.O.C.O.L., j’ai été frappé par l’ampleur romanesque et par la structure du texte. Comment s’est organisée la construction de ce roman ? Lorsque tu t’es lancé dans la rédaction de P.R.O.T.O.C.O.L., avais-tu une idée précise de l’architecture globale (avec un plan précis) ou construis-tu ton roman au fur et à mesure de l’écriture ?
Je ne travaille pas en fonction d’un plan ou d’une structure préétablie. Si pour les deux romans précédents la structure s’est imposée d’elle-même, pour P.R.O.T.O.C.O.L. c’était plus complexe, d’abord parce que le roman que j’avais initialement projeté d’écrire ne ressemble en rien à ce qu’il est devenu. Je visais quelque chose de plus court, plus monologique, que j’ai abandonné en cours de route pour élargir la perspective et laisser entrer dans le texte pas mal d’éléments que, jusque-là, je maintenais dans une sorte d’arrière-plan. Et pour la première, en prenant cette décision d’ouverture, je me suis retrouvé sans vraiment savoir où j’allais, ce qui n’avait pas été le cas avec les deux romans précédents, pour lesquels, très tôt, j’ai su dans quelle direction avancer, et comment procéder.
L’écriture, c’est peut-être avant toute chose un travail d’agencement des phrases entre elles, mais aussi des mots et des propositions au sein des phrases, des phrases elles-mêmes animées de mouvements qui peuvent concurrencer la ligne droite.
Là, j’étais un peu perdu. Dans la mesure où l’idée première n’était pas sans rapport, sur le plan de la conception, avec le théâtre, j’ai gardé dans le coin de mon esprit une métaphore théâtrale pour m’aider à conceptualiser formellement le roman, puis j’ai travaillé globalement personnage par personnage, à l’affût des points de contact, des croisements, des bifurcations, qui m’ont ensuite permis de tout agencer en faisant s’entrecroiser les parcours des uns et des autres.
2. Dans chacun de tes romans, tu travailles sur le temps en interrogeant son aspect cyclique et chronologique. Ainsi dans Charøgnards, ton premier roman, tu construis les chapitres en suivant un certain ordre chronologique (en suivant les jours de la semaine) pour ensuite créer un trouble temporel. L’occurrence temporel aujourd’hui est questionné par l’interrogative ( « aujourd’hui ? »). Le fait de se couler dans un axe chronologique, est-ce une manière de se couler dans une contrainte qui te permet de construire le roman ?
La chronologie, ou l’agencement linéaire des faits, leur succession, a ceci d’avantageux qu’elle crée de la narration. Il suffit de placer deux événements l’un à la suite de l’autre pour y lire une séquence, un mouvement orienté vers autre chose, l’appel d’un troisième événement qui découlerait des deux premiers, etc. Bref, on tient un fil et dans ce fil, le début d’une histoire… C’est comme ça que nous avons appris pour la plupart à faire l’expérience du temps : de manière séquentielle et consécutive. Or dans le roman il faut aussi composer avec autre chose, quelque chose de plus immédiat, qui est la phrase. Mais la phrase ne se coule pas forcément, ni facilement, dans une forme linéaire. On apprend très tôt le modèle sujet/verbe/complément, mais en réalité c’est beaucoup plus complexe que ça.
Dans le roman il faut aussi composer avec autre chose, quelque chose de plus immédiat, qui est la phrase. Mais la phrase ne se coule pas forcément, ni facilement, dans une forme linéaire.
L’écriture, c’est peut-être avant toute chose un travail d’agencement des phrases entre elles, mais aussi des mots et des propositions au sein des phrases, des phrases elles-mêmes animées de mouvements qui peuvent concurrencer la ligne droite. Je dirais que pour moi, le roman est une négociation constante entre ces divers mouvements et si j’ai appris quelque chose, entre À tous les airs, le premier roman que j’ai écrit – quoiqu’il ait été publié après Charøgnards – et P.R.O.T.O.C.O.L., c’est peut-être de préserver un élan narratif, un arc orienté vers une fin, même si cet agencement linéaire vient à se compliquer en cours de route. Mais disons que si la chronologie apparaît a priori comme la forme la plus immédiatement narrative, parce que linéaire, ce n’est pas celle qui me vient en premier, ne serait-ce que dans les phrases que j’écris, qui naturellement vont avoir tendance à se compliquer, bifurquer, se dédoubler, s’ouvrir, faire retour sur elles-mêmes, etc. ; et il faut parfois que je travaille, ne serait-ce que pour préserver un élan, à les « redresser »…
3. Dans ton deuxième roman, A tous les airs, tu joues encore davantage sur l’éclatement chronologique et temporel. Les jeux d’échos et d’allers-retours temporels sont nombreux. Avais-tu pour ce roman un plan précis ou as-tu reconstruit le tout à postériori ? La construction du roman est-elle aussi pour toi une manière d’interroger notre rapport au temps et à son caractère éclaté ?
À tous les airs ne se fond pas dans un schéma linéaire, en effet – ce que signalait l’ajout de la mention « Ritournelle » sur la page de titre, comme pour remplacer le traditionnel « Roman » qu’on y trouve souvent… Il y a dans ce texte quelque chose d’obsessionnel, qui littéralement fait « retour » et en ce sens résiste à un modèle de narration classique, linéaire et chronologique (avec un début, un milieu, une fin) ; mais d’une certaine manière, c’est un roman qui, s’il interroge le temps, le fait en tâchant peut-être de s’en affranchir.
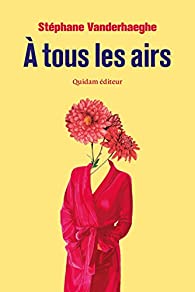
Ce qu’il y a de terrible dans la ligne droite, dans la linéarité et l’agencement chronologique, c’est précisément la fin qui aimante le texte, ce point final au-delà duquel il n’est plus possible de se propulser… À tous les airs, après tout, se déroulait dans un cimetière… C’est peut-être à cette finalité qu’on essaie, frauduleusement, voire fantasmatiquement, de s’affranchir dans l’écriture, en rejouant le moment de la fin et en tentant de le repousser, de le dissoudre dans autre chose.
4. En tant que lecteur, es-tu particulièrement sensible à la construction d’un roman ? Quels sont les romans qui t’ont laissé une forte impression quant à leurs architectures ?
Oui, bien sûr. C’est, je crois, surtout à ça que se mesure l’art du romancier, à la façon dont il ou elle fait tenir son histoire, une histoire qui dès lors devient inséparable de la forme qu’elle a prise. Je suis toujours plus sensible à la forme ou la construction du texte qu’à l’intrigue en tant que telle, ce qui fait que quelques semaines après avoir lu un texte, je suis souvent incapable de dire comment le roman se termine, sa conclusion, son dénouement, sa résolution me marquant souvent moins que son architecture – ce qui ne veut pas dire que cette fin m’a déçu, mais que pour moi, que ce soit en tant que lecteur ou écrivain, les éléments d’intrigue ne sont pas nécessairement, et sûrement pas principalement, ceux qui m’intéressent le plus. Des exemples, je pourrais en donner plein, mais l’architecture d’un roman comme La Femme de John de Robert Coover est assez exceptionnelle, ou même l’absence apparente et éminemment trompeuse d’un roman comme Gerald reçoit.
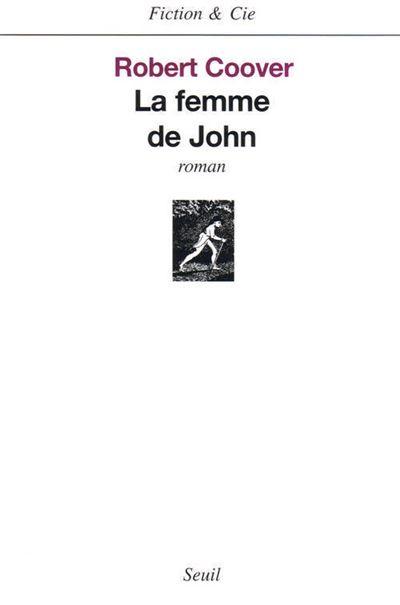
5. Conçois-tu un roman comme un architecte, au sens où tu organises un plan d’ensemble qui va former une unité ? A quoi comparerais-tu la construction d’un roman ? A une cathédrale ou à une robe, comme chez Proust ? Ou plutôt à un immeuble comme chez Perec ? Ou à un autre lieu et à un autre espace ?
Architecte, je ne sais pas ; sans doute pas. Un architecte se doit de travailler sur plan et de vérifier, avant construction, que le bâtiment tiendra. C’est très rationnel comme mode de fonctionnement ; ça l’est nettement moins chez moi. C’est beaucoup plus expérimental, au sens premier du terme, c’est-à-dire que je ne sais jamais d’avance si ça tiendra. Je ne fonctionne pas sur plan, je l’ai dit. De ce point de vue-là, je serais sans doute plus robe et couture que cathédrale, quoique la robe nécessite un patron… que je n’ai pas. Mais de manière plus générale, chaque roman imposant ses propres règles, il convient de changer de lieu à chaque fois et de trouver celui qui sera le plus fonctionnel. Pour Charøgnards, c’était la forme du journal et l’objet physique, l’espace de la page que, métaphoriquement, l’écriture devait tenter de percer, de déchiqueter, pour progressivement la retourner à sa blancheur.

Pour À tous les airs, la métaphore visuelle qui m’a permis d’agencer le texte était celle du cimetière, chaque parcelle de texte représentant une sorte de tombeau, l’ensemble dessinant un cimetière au sein duquel on avance et se perd. Pour P.R.O.T.O.C.O.L., c’était plus complexe et il m’a fallu plus de temps avant de comprendre comment souhaitait fonctionner ce texte, la difficulté étant que la forme même de l’objet-livre semble réclamer un agencement linéaire au gré des pages qui se suivent ; or dans son aspect choral, P.R.O.T.O.C.O.L. est un roman qui opère en fonction d’une certaine simultanéité. Cet étagement des voix, leur concomitance, est quelque chose qui m’a longtemps rendu perplexe. Le livre aplatit tout, rabat tout sur les deux dimensions de la page. J’avais besoin d’espace et de profondeur, d’une troisième dimension et je suis passé, du moins visuellement, par le théâtre et l’espace de la scène, en tâchant d’imaginer où placer chaque personnage sur la scène. Il y a donc ceux qui occupent le premier plan, l’arrière-plan, qui traversent la scène d’une extrémité à l’autre, qui restent en coulisses ou constituent le chœur…
P.R.O.T.O.C.O.L. de Stéphane Vanderhaeghe aux éditions Quidam