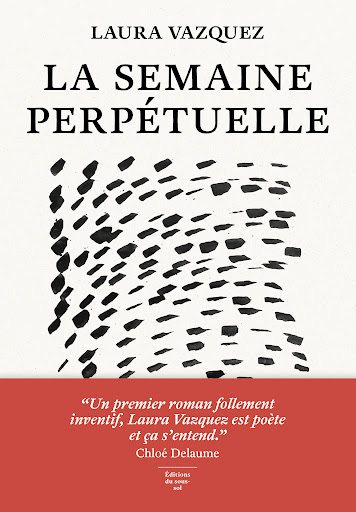Le premier roman de Laura Vazquez, La semaine perpétuelle, publié aux Editions du sous-sol, explore à travers le destin de cinq personnages dont Salim, sa soeur et leur père, les solitudes et les obsessions contemporaines. Le roman est cette galerie composée d’éclats réfléchis aux contours infinis et de rhapsodies terrestres et charnelles. Elle creuse dans la langue des langues organiques et sculpturales. Des langues pour donner forme à ses personnages, comme autant de géographies à arpenter et à explorer. Laura Vazquez orchestre de manière follement singulière le récit de nos langues, celles composées de musiques, de bruits, de sonorités et de silences liquides et souterrains.

1. Votre roman La semaine perpétuelle est le fruit de quatre ans de travail. Dans le recueil poétique L’obscur travaille d’Henri Meschonic, on trouve réflexion sur l’obscurité et la lumière:
l’obscur
travaille ma lumière
des formes que je ne comprends pas
me traversent
et je me mets à lire
des lettres que je ne comprends pas
alors je commence
à voir clair.
La lumière
vient toujours
après le noir
chaque jour
chaque instant
refait le commencement
du monde
16 juilllet 2008 à Paul Brousse
La gestation du roman s’est-elle faite par l’idée que l’obscur a travaillé en vous et que c’est par et de cette obscurité que sont venus les chapitres et le rythme des phrases ?
Pas du tout, au contraire, tout s’est fait par la lumière. Et texte est venu simplement par le travail à partir de ce sentiment, c’est quelque chose de vaste, une impression lumineuse présente aussi chez les animaux et sans doute les plantes et tout le reste. Alors bien sûr, il y a de l’ombre et beaucoup d’ombres.
2. De quelle manière avez-vous façonné et sculpté vos personnages ? Au fur et à mesure de l’écriture, les personnages comme Salim, Sara ou leur père se sont-ils autant imposés par leurs voix et leurs manière de parler que par leurs particularités physiques et psychologiques ?
Je ne les ai pas façonnés. D’ailleurs, il a fallu immédiatement dé-façonner les idées que je pouvais avoir, car les idées sont une perte de temps quand elles arrivent avant le texte, c’est un classique piège de l’orgueil.
3. Ce premier roman interroge le statut même du genre. Vous écrivez de la poésie et appartenait à un groupe de musique. La semaine perpétuelle tient autant du roman par la multitude de ses récits et de ses fictions qu’il déploie que de la poésie par son écriture et son rythme. L’espace littéraire auquel appartient votre roman est-il un espace poreux qui inquiète les genres et les frontières ?
J’aurais pu aussi bien sculpter des figurines avec de la farine et de l’eau. C’était un sentiment que je voulais faire et c’est devenu un roman, parce que le mot roman a un côté pratique, comme un sac résistant dans lequel on peut ranger des objets pointus et d’autres très glissants ou très fins ou même invisibles et qui peuvent être des poèmes, des dialogues, des descriptions d’arbres, de vidéos, de visages, des commentaires, etc.
4. Ce qui frappe à la lecture de La semaine perpétuelle, c’est cette incarnation physique du souffle, de la voix et de l’oreille, reliée à votre travail de poétesse. Y a -t-il un moment où le texte passe par l’oralité et est-ce le moment qui vous permet de vous prouver que c’est ce que vous recherchiez ?
Tout s’est passé dans l’écriture. On entend très bien sans dire.
5. Dans son Abécédaire, Gilles Deleuze parle du style et en propose la définition suivante : « Un style est composé de deux choses. On fait subir à la langue dans laquelle on parle et on écrit un certain traitement. On fait subir à la langue un traitement syntaxique, originale. Ça peut faire bégayer la lague. Ou faire balbutier la langue. Comme Péguy. Comme les grands artistes, c’est un fou complet. Ça fait partie des grands styles de la langue, c’est-à- dire des grandes créations de la langue française. Il fait croitre la langue par le milieu. Il fait proliférer la phrase par le milieu, par insertions. Un grand styliste est un créateur de syntaxe. Et je ne sors pas de la formule si belle de Proust : « Les chefs d’œuvres ont toujours écrits dans une sorte de langue étrangère. » Un styliste c’est quelqu’un qui crée dans sa langue une langue étrangère. Deuxièmement, on pousse tout le langage jusqu’ à une certaine limite, le bord qui le sépare de la musique. » Avez-vous cherché dans La semaine perpétuelle à créer des langues étrangères avec vos personnages ? S’agit-il ainsi de faire bégayer ou de faire balbutier la langue commune pour l’amener ailleurs ?
J’ai cherché à ne pas chercher. Donc bien sûr je me suis trompée beaucoup et longtemps avant de sincèrement laisser, pas seulement dans la pensée, mais dans l’acte, au moment de l’écriture.
Pour mon livre et l’écriture en général, j’ai voulu de l’exactitude, puis comme je vous disais j’ai cessé de vouloir, et c’est là que les choses ont commencé.
Laura Vazquez
J’ai laissé. Et quand on commence, c’est une expérience extraordinaire.
6. Dans La semaine perpétuelle, on trouve cet aspect musical de l’écriture par l’emploi de la répétition, comme une manière aussi de faire bégayer ou balbutier la langue. De créer un écart. Chez un auteur comme Thomas Bernhard, la répétition avait valeur d’imprécation et d’exorcisme, créant chez le lecteur une sorte de transe et de vertige. L’écriture romanesque et poétique est-elle pour vous le lieu de ce vertige ?
Je ne veux pas faire faire quoi que ce soit à la langue, je veux qu’elle fasse quelque chose presque sans moi. Plus jeune, j’ai lu Bernhard et ça s’entend peut-être, mais je n’ai pas eu de vertige en le lisant, j’ai eu parfois un sentiment de jubilation, c’est le souvenir que j’en garde, une sorte d’exultation.
Je veille surtout à ce que le texte ne soit pas déformé par moi.
Laura Vazquez
Pour mon livre et l’écriture en général, j’ai voulu de l’exactitude, puis comme je vous disais j’ai cessé de vouloir, et c’est là que les choses ont commencé.
7. Vous donnez régulièrement des lectures publiques de vos poèmes et proposez aussi des vidéos de lecture sur internet. En quoi la poésie, et de manière plus générale la littérature, doit-elle passer par sa forme orale, au sens où l’écrit dialogue avec l’oral pour conférer au texte toute son incarnation ?
Parfois en lecture il se passe quelque chose de particulier, c’est très rare, comme si la personne disparaissait. La personne qui lit a disparu. Ça arrive peut-être une ou deux fois par vie.
8. De quelle manière préparez-vous une lecture de vos textes ? Y’a-t-il un travail au préalable de relecture, à l’instar d’une comédienne. Est-ce une manière aussi, lors de ces lectures, d’entendre et de découvrir des nouvelles choses concernant vos écrits ?
Je sers. Donc je veille surtout à ce que le texte ne soit pas déformé par moi. Je mets de petites barres noires sur mes feuilles par exemple pour penser au silence, pour ne pas trahir un certain moment, pour ne pas insister sur un mot, des choses comme ça, rien de plus.
9. Votre roman interroge la place accordée à Internet et aux réseaux sociaux. Certains de vos personnages s’enferment dans leurs territoires, comme le personnage de Salim qui à la manière des hikikomori a décidé de vivre de manière virtuelle. Le texte construit ainsi des espaces et des territoires propres à chaque personnage. Internet est autant le lieu des possibles que celui de l’artifice. Votre geste d’écriture est-il autant une variation littéraire et poétique autour du virtuel et de ses mondes qu’une critique de ce monde virtuel ?
Ce personnage n’a pas décidé de vivre de manière virtuelle, il s’est retiré de la vie. Ce n’est pas une décision, c’est une chose irrémédiable. Alors, il a commencé à écrire parfois sur Internet, il s’est filmé, il a posté, il a vu des images, il a parlé sous ses images dans les commentaires, il a noté ses rêves et il les a publiés sans trop réfléchir, comme une chose naturelle. Ce livre n’est surtout pas une critique ou une manière de réfléchir à propos de tel ou tel thème actuel ou de telle ou telle pratique ou tel ou tel outil. Il s’est trouvé seulement que les personnages, quelquefois jeunes, passaient beaucoup de temps sur leurs téléphones.
Quand j’écris, je suis 100 % pour rien et contre rien.
Laura Vazquez
Mais ils auraient pu tout aussi bien écrire sur des parchemins et regarder défiler des paysages depuis leurs calèches. Au fond, ça n’aurait pas changé grand-chose. Bien sûr, cette sorte de système de croisements, comme les racines des arbres sous terre, dont on fait l’expérience avec Internet, bien sûr c’est une chose que je connais bien, que j’utilise chaque jour, et donc c’est une chose que je prends, car quand j’écris je prends tout.
10. L’écrivain Lucien Raphmaj vous a consacré un très bel article intitulé Poétique de l’idiotie sur le site Diacritik. Cette notion d’idiotie est très intéressante. Dans le documentaire consacré à Thomas Bernhard, le réalisateur Jean-Pierre Limosin évoquait le thème de l’idiotie : « « En réalité pour parler au mieux des grands artistes, de Thomas Bernhard en particulier, c’est leur idiote qu’il faut évoquer. C’est Clément Rosset qui en parle bien (en référence à son livre Le réel, Traité de l’idiotie) ». Ce dernier apparait alors et donne cette définition de l’idiotie : « En définissant l’idiotie comme je le fais, je reviens à l’ancien sens d’idios grec : simple, particulier, unique, sans duplication, sans double. Toute réalité est idiote et en même temps indéfinissable, sinon négativement. Rien ne peut la définir. Elle se définit par son caractère indéfinissable. Du fait même qu’on est singulier et comparable à rien, on est à la fois réel et indéfinissable. Il y a un mot d’un physicien autrichien qui comparait le monde, la réalité en général à quelque chose qui était définie par le fait de ne pas avoir de complément en miroir. Ce qui fait l’énigme du monde, c’est d’être seul. Le monde est seul comme un individu est seul. » Les personnages du roman semblent tout à la fois particuliers et comparables à personne. Ce roman permet-il l’exploration de cette idiotie du monde et des êtres, au sens où ils sont à la fois uniques et seuls, ce qui fait comme le dit Clément Rosset « l’énigme du monde » ?
Les choses sont idiotes de manière naturelle parce qu’elles sont vivantes, ce qui est idiot au sens premier. Espérons que l’écriture soie parfois miraculeusement purement idiote et qu’elle ne parade pas, qu’elle ne fasse pas l’intelligente car alors ce n’est plus elle mais nous, et nous sommes pauvres car nous sommes dans le besoin.
Dans un livre les passages communiquent les uns avec les autres, chaque lettre et chaque espace échangent comme des substances chimiques, et c’est très beau, c’est magnifique.
Laura Vazquez
Nous avons besoin d’air, d’aliments, d’eau, de croyances, de sens, d’avis, nous sommes très réduits dans notre forme actuelle. C’est Pouchkine je crois qui disait : la poésie doit être un peu bête. Et je suis d’accord, bête, mais bête comme un enfant et même comme un bébé, comme un fœtus, comme un animal est bête, comme un nuage, un acarien, une cellule, et comme nous. Mais nous sommes recouverts d’une bêtise beaucoup moins intéressante et pour commencer il faut retirer cette crasse.
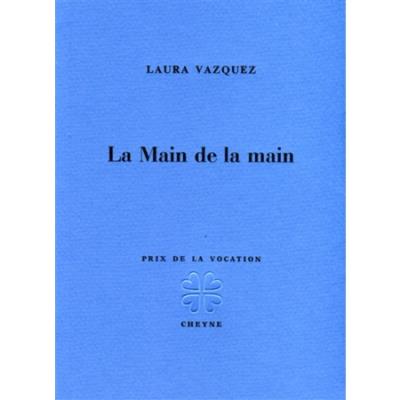
11. Vous êtes l’autrice de plusieurs recueils de poèmes, dont La main de la main publié au Cheyne. Au sujet de la poésie, Christian Prigent rappelait dans A quoi bon encore des poètes ? à quel point la poésie était une affaire de temps : « Pétrarque disait: « Je ne veux pas que mon lecteur comprenne sans effort ce que je n’ai pas sans effort écrit moi-même. » Sans doute ne faut-il pas voir dans cette phrase une affirmation d’élitisme ésotérique. Bien au contraire : cette phrase nous dit que « poésie » est le nom de la chance donnée à un lecteur, engagé dans la vertigineuse précipitation prosodique ou dans les empâtements de la polysémie, de poser son temps en travers du temps et de prendre momentanément, dans l’épaisseur ralentie du déchiffrement, l’initiative sur le temps. » En quoi l’écriture poétique, et de manière générale l’écriture elle-même, est-elle une manière de nous donner la chance de créer dans le temps d’autres espaces temporels ?
Oui, peut-être, l’écriture, mais aussi les mathématiques, le sprint, le cyclisme, le cinéma, l’exploration, l’escalade, peu importe s’il y a le sentiment juste. Je n’ai pas de considérations théoriques arrêtées sur l’écriture ou sur l’art en général, vous comprenez il me faut une liberté énorme, je ne peux pas tomber là-dedans. Quand j’écris, je suis 100 % pour rien et contre rien.
12. La semaine perpétuelle interroge également le rapport à la forme, autant dans sa forme sonore, visuelle, textuelle que poétique, à l’instar du travail de Thomas Braichet dont les créations se présentent comme des interfaces plastiques, typographiques, sonores et textuelles. Lors de l’écriture, y a-t-il un dialogue entre ces différentes formes ?
Oui, dans un livre les passages communiquent les uns avec les autres, chaque lettre et chaque espace échangent comme des substances chimiques, et c’est très beau, c’est magnifique.
Je ne cherche rien. Les mots sont beaux, parfois ils nous séduisent. Par exemple le mot « crème » est très beau, le mot « sombre », le mot « pieuvre » aussi. Un livre composé des mots « crème », « sombre », « pieuvre » sur des pages et des pages, imaginez, je trouve ça beau.
Laura Vazquez
J’ai une reconnaissance quand je le ressens, tout se touche si vous voulez. J’ai une reconnaissance dans le corps. Il m’arrive de prononcer le mot merci et parfois je tape des mains en riant de joie. Voilà ce que je fais, je n’ai même pas besoin de me droguer ou de voyager.
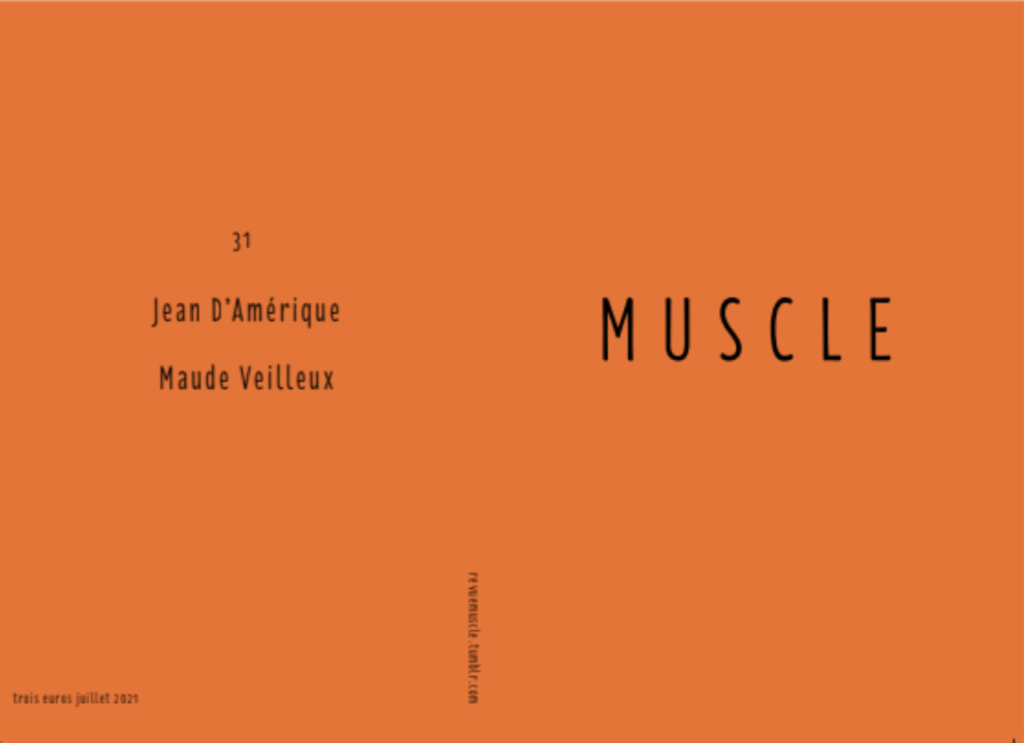
13. Vous co-dirigez également la revue littéraire Muscle, créé en 2014. C’e st une revue qu’on trouve dans quelques libraires mais aussi sur internet et qui a publié des auteur.e.s de Chine, Espagne, Etats-Unis, Mexique, Canada, Norvège, Angleterre, Suède, Islande, Belgique, Suisse. Est- ce une manière de vivre la poésie comme une aventure collective ?
Je m’occupe de cette revue avec Roxana Hashemi, on aime bien chercher des textes, trouver des traductions, envoyer ces petits objets colorés imprimés par la poste. C’est notre petit moment d’amusement, on met des textes côte-à-côte, on les imprime, on plie les feuilles, on les glisse dans les enveloppes et c’est une petite respiration tous les deux mois pour nous et peut-être pour d’autres.
14. Lors de l’avènement de la linguistique, Michel Foucault a proposé cette belle analyse qui fait écho à votre travail : « Il ne s’agit pas de retrouver une parole première qu’on aurait enfoui mais d’inquiéter les mots que nous parlons, de dénoncer le pli grammatical de nos idées, de dissiper les mythes qui animent nos mots, de rendre à nouveau bruyant et audible la part de silence que tout discours emporte avec soi lorsqu’il s’énonce ». Cherchez-vous, par votre travail sur la langue, à inquiéter les mots que nous parlons ?
Je ne cherche rien. Les mots sont beaux, parfois ils nous séduisent. Par exemple le mot « crème » est très beau, le mot « sombre », le mot « pieuvre » aussi. Un livre composé des mots « crème », « sombre », « pieuvre » sur des pages et des pages, imaginez, je trouve ça beau. Et même les mots agaçants, le mot « enjeu » par exemple qu’on entend partout en ce moment, le mot « bidouiller » par exemple que je n’aime pas beaucoup, ces mots aussi nous séduisent par la colère, par l’agacement. Vous voyez, je ne cherche pas, je ne décide pas, car je suis faible et je l’ai compris. C’est une libération, mais surtout c’est la grande aventure.
La semaine perpétuelle de Laura Vazquez aux Editions du sous-sol