Tout grand roman sur l’adolescence porte en lui une grâce fragile des origines. Il nous fait ressentir l’origine de nos corps hésitants et troublés, nos envies d’absolu et notre rapport complexe au réel. Avec son premier roman intitulé Grande couronne, publié chez Christian Bourgois, Salomé Kiner nous donne à entendre la voix d’une adolescente dans toute sa vérité, sa complexité, sa nudité. Ce roman parle autant du corps physique d’une adolescente que du corps social, géographique et symbolique qui gravite autour d’elle. Si Salomé Kiner fait le portait d’une époque, celle des années 90, elle explore avant tout la difficulté d’ être à soi à travers une langue qui strie le paysage littéraire comme des éclairs. Ce roman alterne éclaircies existentielles et orages adolescents à travers une langue pleine de relief et de grondements. Il met en voix la confrontation d’une adolescente à la réalité sociale et sexuelle qui l’entoure pour mieux faire entendre les battements irréguliers de nos vies adolescentes chaotiques et heurtées. Un grand roman sur l’adolescence porte en lui une métaphore de l’écriture : écrire pour dire son irréductible singularité afin comme dit Deleuze » libérer la vie que l’homme ne cesse d’emprisonner. » Grande couronne est ce roman qui porte en lui cette part d’irraisonné poétique et de sauvagerie existentielle propres à l’adolescence et à la littérature.

1. Dans ce premier roman, vous vous mettez dans la peau d’une adolescente dans les années 90. C’est une langue très directe, très brute qui engage tout le corps. On retrouve dans votre écriture la vision qu’en avait Marguerite Duras dans son texte Ecrire : « C’est ça l’écriture. C’est le train de l’écrit qui passe par votre corps. Le traverse. C’est de là qu’on part pour parler de ces émotions difficiles à dire, si étrangères et qui néanmoins, tout à coup, s’emparent de vous. » L’écriture s’est-elle emparée de vous lors de la composition de ce roman ?
Oui, il y a eu des moments semblables, quelques uns. Des moments où la voix de la narratrice se déversait de manière torrentielle, passait par et sur mon corps, et j’en ressortais sonnée, éberluée par ce que je venais de faire. Rares, parce que l’écriture, pour moi, est un artisanat. Je commence par poser une image, une scène, assez grossièrement. Ensuite je reviens dessus et je la travaille, je l’affine, je cherche à la faire sonner, je pèse chaque mot, je compte les syllabes, etc.
Et si je suis très assidue, alors de brèves épiphanies peuvent arriver, ces moments où l’écriture « s’empare de moi ». Mais pour y accéder, il faut un immense travail en amont, de concentration et de disponibilité. C’est l’urgence et la patience dont parle Jean-Philippe Toussaint dans son essai du même nom : « L’urgence est un état d’écriture qui ne s’obtient qu’au terme d’une infinie patience. »
2. Le roman se situe dans les années 90 et les marques sont omniprésentes dans l’univers de cette adolescence. De quoi sont-elles le révélateur ?
Grande couronne parle – à mes yeux – de la désirabilité sociale, du conformisme et de l’accès à la consommation comme outil d’intégration. J’avais envie de travailler les marques comme des mythologies, au sens défini par Roland Barthes. Parler, dans ce contexte, d’un ensemble Lacoste, de chaussettes Ralph Lauren ou de polos Eden Park, ce n’est pas qu’un placement de marque. C’est montrer comment la rue, la jeunesse des classes moyennes ou populaires convoite et s’approprie les codes et les marqueurs sociaux de la bourgeoisie, des loisirs bourgeois : le tennis, l’équitation.
Pour écrire Grande couronne, il m’a fallu braver ce sentiment d’illégitimité et trouver la langue juste qui me permette de valoriser, de transformer cette matière qui me semblait indigne de littérature.
Salomé Kiner
Cette obsession pour les objets et les produits de marque est un classique chez ceux qui n’y ont pas accès. Leur omniprésence était une manière pour moi d’insister sur la frustration de la narratrice, son sentiment d’exclusion, et les risques qu’elle est prête à prendre pour appartenir au groupe, pour entrer dans la norme, pour ne pas passer pour « une pauvre ». Par ailleurs, le roman se situe au seuil des années 2000, qui seront celles du bling-bling. Aujourd’hui, le luxe, c’est le minimalisme, le no-logo, le dépouillement et les séjours en « detox numérique ». Mais à l’époque, l’ostentatoire était encore la norme.
3.La vie devant soi de Romain Gary est un livre qui vous accompagne depuis longtemps. Ce dernier livrait sa vision de l’écriture lors de l’émission Radioscopie : « C’est une folie qu’il faut entretenir parce que c’est une folie qui tend à s’amenuiser et à disparaître. L’art et le goût de raconter des histoires est une forme de naïveté. C’est la survivance de l’enfant en nous quelque soit le vêtement intellectuel et philosophique qu’il porte. » Le besoin d’écrire des histoires convoque-t-il en vous cette « forme de naïveté » ?
Pas sûre. Peut-être que je suis encore trop jeune pour penser comme ça. Pour le moment, le besoin d’écrire des histoires correspond au contraire à une forme de sérieux, à l’idée qu’on ne parle vraiment que dans les livres. Ecrire, c’est me rassembler, c’est faire passer le grand magma des émotions et des expériences de ma vie dans l’entonnoir de la phrase, de la construction de l’histoire, pour en tirer une ligne claire et signifiante, donner du sens à ma vie et à mon parcours.

J’ai passé plusieurs années à vouloir écrire sans pouvoir le faire. J’avais l’impression de venir du médiocre, du vide, de cet espace intermédiaire qui n’avait rien à raconter, et je n’arrivais pas à inventer d’histoire qui soit tout à fait détachée de moi. Pour écrire Grande couronne, il m’a fallu braver ce sentiment d’illégitimité et trouver la langue juste qui me permette de valoriser, de transformer cette matière qui me semblait indigne de littérature. Donc plus qu’une forme de naïveté, je l’ai vécu comme une tentative personnelle d’affirmation, un effort salvateur pour trouver ma place dans le monde.
4. Vous êtes journaliste pour des médias suisses comme Le Temps, Couleur 3 ou Mouvement. Votre travail de journaliste a-t-il nourri votre travail de romancière ?
Beaucoup. Le travail de journaliste m’a appris à écouter les histoires des autres. Ecouter, ça ne veut pas seulement dire se taire et laisser l’autre parler. Ça veut dire entendre ce qui est raconté derrière l’anecdote livrée, derrière les détails et les couleurs qu’on retient, derrière les informations qu’on filtre ou qu’on choisit de donner.
Pour pénétrer certains mondes, il faut se dépouiller d’énormément de choses, de jugements personnels, de certaines idées morales.
Salomé Kiner
Apprendre à décortiquer la fabrique du récit de soi. Le journalisme m’a aussi donné accès à des univers très éloignés de moi. J’ai toujours été très curieuse des autres, plus attirée par l’altérité que la connaissance de soi. Mais pour pénétrer certains mondes, il faut se dépouiller d’énormément de choses, de jugements personnels, de certaines idées morales. Et je crois que cet état de « neutralité » m’a aidé à construire la voix et la vision de ma narratrice.
5. A travers ce roman, on saisit la réalité d’une adolescente qui doit affronter un monde structuré par des codes masculins dominants. Mona Chollet rappelait dans Beauté fatale cette difficulté de vivre au quotidien entouré d’impératifs et d’injonctions : « La peur de ne pas plaire, de ne pas correspondre aux attentes, la soumission aux jugements extérieurs, la certitude de ne jamais être assez bien pour mériter l’amour et l’attention des autres traduisent et amplifient tout à la fois une insécurité psychique et une auto dévalorisation qui étendent leurs effets à tous les domaines de la vie des femmes. » En quoi le regard d’une adolescente permet-il d’éclairer cela ?
J’ai l’impression que ce serait anachronique d’appliquer l’analyse de Mona Chollet à la réalité d’une adolescente des années 1990. Par ailleurs je crois que l’auto dévalorisation dont elle parle intervient à peine plus tard dans la vie des femmes, peut-être plus en lien avec l’indépendance financière, qui nous permet de faire des choix qui vont justement dans le sens de ces injonctions, et qui du coup renforcent notre dépendance à ces jugements extérieurs.
Le regard d’une adolescente permet peut-être d’enregistrer les premiers impacts de ces injonctions.
Salomé Kiner
L’adolescence, et c’est ce qui m’intéressait, est un âge qui n’a pas encore intégré ces injonctions, qui n’a pas vraiment les moyens (économiques ou même pratiques – le manque d’occasions) d’en faire l’expérience, en tous cas à cette époque où l’accès aux images n’était pas aussi prégnant. L’influence du monde extérieur et l’image qu’il nous renvoie est très forte, certes, mais ses effets se répercutent ailleurs, dans un espace plus complexe, qui n’est pas dans l’ultra-féminité mais bien dans ce gouffre qui sépare l’enfance de l’âge adulte et que la puberté nous fait enjamber sans filets, nous propulsant d’un monde à l’autre au terme d’une transition ingrate. En ce sens, le regard d’une adolescente permet peut-être d’enregistrer les premiers impacts de ces injonctions.
6. A travers cette adolescente et ses différentes expériences, vous interrogez aussi le désir amoureux et sexuel. Dans son essai intitulé Jouir, Sarah Barmak montrait à quel point le plaisir féminin a été ignoré : « Que veulent les femmes ? Ça, personne ne le sait, pas même les femmes elles-mêmes ! Peut-être faut-il en fait aborder la sexualité féminine comme un domaine qui s’apprend, se cultive, et dans lequel on s’améliore grâce à nos connaissances – comme la cuisine ou le jardinage. Le plaisir féminin est-il vraiment beaucoup plus compliqué que le mode d’emploi de votre iPad ou votre déclaration d’impôts ? Le problème ne viendrait-il pas plutôt du fait que nous ayons ignoré la profusion de connaissances accumulées sur le corps des femmes au fil des siècles, pour pouvoir mieux prétendre ensuite, comme l’a fait Freud en son temps, que nous ne savons pas ce que veulent les femmes ? » En quoi la fiction, en dehors de l’essai, permet-elle d’appréhender différemment ce thème de la jouissance, sachant qu’il est vécu de manière tout à fait particulière pour cette adolescente ?
Grande couronne n’est pas un manuel d’éducation sexuelle, c’est plutôt l’illustration de son absence. L’enquête de Sarah Barmak n’a été possible que parce que le plaisir féminin est au cœur des débats depuis quelques années, et elle s’intéresse à des pratiques qui étaient encore extrêmement rares et isolées à la fin des années 1990.
Tant qu’on n’est pas capable de nommer une violence, elle n’existe pas.
Salomé Kiner
En dehors du changement d’époque, je me suis intéressée à l’adolescence justement parce qu’elle se situe juste en deça d’un certain seuil de conscience, et qu’à ce titre une forme de confusion est à l’œuvre, confusion qui se dissipe avec le temps, l’expérience, la maturité. Mais dans le cas de ma narratrice, c’est un premier contact, une confrontation immédiate avec la sexualité, sans outils d’évaluation, ni du plaisir ni de la violence. C’est ce qui la met en danger et à la fois ce qui la protège. Tant qu’on n’est pas capable de nommer une violence, elle n’existe pas. Ça ne l’empêche pas de se loger dans un coin de l’inconscient et d’infuser pendant des années jusqu’à refaire surface d’une manière ou d’une autre, quand on acquiert justement les outils pour traiter cette information.

7. Au corps physique et en mutation de votre adolescente répond le corps géographique, autant celui de la couronne parisienne et que celui de la capitale. Comment ces deux corps se répondent-ils ?
Ce sont des corps qui butent. La narratrice est dans le rejet de son propre corps, elle dit à plusieurs reprises qu’il l’encombre, l’humilie, lui déplait. Idem pour son environnement. Elle voudrait vivre dans un autre corps autant que dans un autre territoire. Elle se cogne constamment à l’altérité – des zguègues, de ses copines et de cet espace géographique dans lequel elle se sent limitée. L’ailleurs et l’autre sont pour elle des lieux de fantasme, d’apprentissage ou de confrontation.
C’est le rythme qui tient et qui guide mon écriture.
Salomé Kiner
Quant à la capitale, il s’agit de Paris, mais elle représente n’importe quel centre pour tous ceux qui vivent en périphérie. C’est le Graal inaccessible, et donc forcément désirable. C’est un corps un peu abstrait, un lieu qu’elle investit symboliquement, sans le connaître réellement. C’est une cristallisation, au sens stendhalien du terme, mais une cristallisation géographique et non pas amoureuse.
8. Dans ce roman, vous travaillez grâce à ce personnage d’adolescente sur l’oralité de la langue, son aspect très malléable. En tant que romancière, la langue est-elle pour vous un matériau musical, à l’image du musicien qui composerait une partition ?
Oui, c’est certain. Je peux renoncer à des pans entiers de l’histoire si je n’arrive pas à les faire sonner. C’est le rythme qui tient et qui guide mon écriture.
9. A la lecture, on a l’impression que l’écriture de Grande couronne se coule dans un tempo proche du hip-hop et du rap. Dans son livre intitulé Triksta, Nick Cohn montrait à quel point le rap a bousculé l’ordre établi : « La musique qui me touche ne se préoccupe pas de métaphysique de pacotille ; elle est dure et coriace, et elle est l’écho des lieux d’où elle vient, du bruit des rues. Le moment où quelque chose de nouveau surgit d’en bas en bouillonnant, plein de sexe et de fureur, juste avant que l’industrie de la musique l’enchaîne et en fasse une marchandise – de ça, je ne me suis jamais lassé. […] Tout ce qui faisait du rap une chose neuve et stimulante était considéré comme une menace. A l’écoute, le fait que le rap ait mis à la poubelle la forme pop classique – la chanson de trente-deux mesures définies par l’industrie du disque – était un immense progrès. Qu’y a-t-il de si merveilleux à régurgiter les mêmes suites d’accords et les mêmes progressions harmoniques jusqu’à plus soif ? » L’adolescence, n’est-ce pas ce « quelque chose de nouveau » qui « surgit d’en bas en bouillonnant plein de sexe et de fureur » ? Que dit le rap sur l’adolescence ?
Je suis vraiment très heureuse que vous citiez Triksta car c’est un livre qui a bouleversé mon approche du reportage et mon obsession pour les « personnages ». Je ne suis pas sûre que ce soit très lié au « rap », mais l’adolescence m’intéressait dans la mesure où oui, on est confronté à des désirs inédits, « au sexe et à la fureur ».
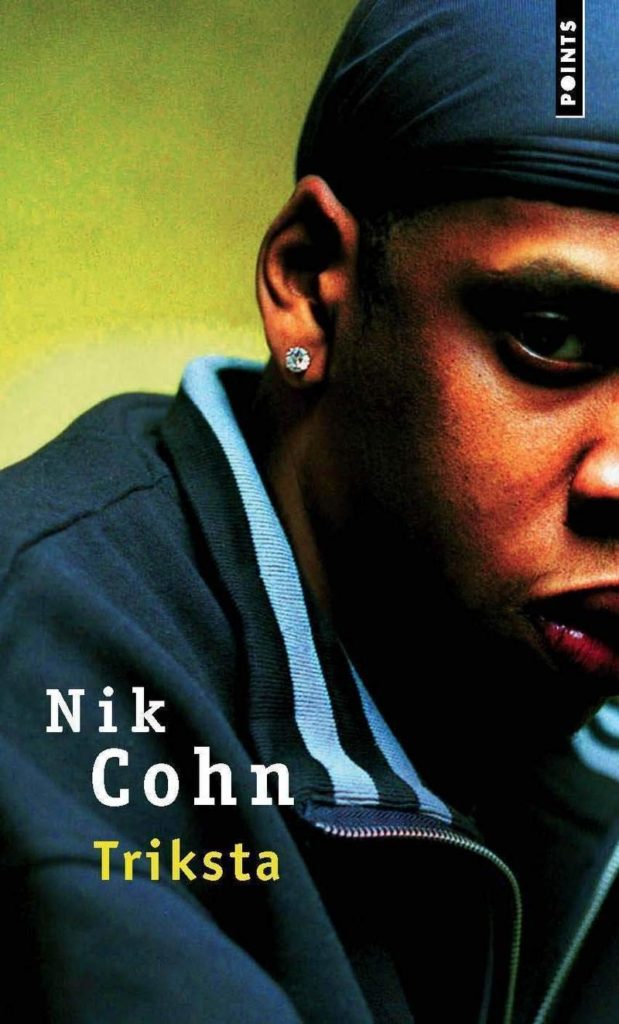
Cette sève nouvelle vient irriguer une pulsion de vie très forte mais souvent corsetée par un tas de contraintes extérieures (la scolarité obligatoire, les parents, le manque de moyens matériels, le statut légal du mineur, etc.). Ce double mouvement – le désir vs. l’interdit, l’impossible, l’inatteignable – créée une forme de friction, une ligne de faille dans laquelle j’ai essayé de me glisser.
10. Maggie Nelson livrait, lors d’un entretien donné à France Inter pour son texte Bleuets, construit autour de la couleur bleue, sa manière de le concevoir : « Chaque couleur a une histoire. Je collectionnais beaucoup de choses bleues, et je me suis mise à écrire l’histoire de ces choses bleues. Derrière tout ça, il y avait de la joie mais aussi de la tristesse ». Pourrait-on dire que chaque histoire a une couleur ? Quelle serait-elle pour Grande couronne ?
Le bigoût, comme les malabars, parce que toute médaille a son revers, et que chaque victoire cache d’immenses sacrifices.
11. Grande couronne par son sujet et le point de vue utilisé convoque de nombreux romans, à l’instar du roman de Camille Bordas, Isidore et les autres. Vous aviez consacré un article dans Le Temps à ce roman dont vous disiez la chose suivante : « L’infime et le crucial changent de hiérarchie et donnent au roman ses détours loufoques. Pour Isidore, une tache persistante sur le canapé du salon prend autant d’importance que la mort d’un proche. » On retrouve cette idée d’inversion des hiérarchies avec votre héroïne. En quoi cela est-il révélateur du monde des adolescents ?
Oui, c’est un point très important pour moi, que j’ai aussi retrouvé récemment dans Mangeterre, de l’autrice argentine Dolores Reyes, un roman époustouflant.

Cette inversion des hiérarchies, c’est un mécanisme de défense grâce auquel tous ces personnages encaissent des événements très durs. Je crois aussi que la coexistence entre les réalités d’adultes et les réactions d’enfants permettent de créer des situations dramatiques qui gardent une forte charge poétique.
Un beau livre, ou une belle page, c’est la sensation d’échapper, l’espace d’un moment, à ces violences extérieures. C’est consolatoire.
Salomé Kiner
12. Dans son livre Ardoise, Philipe Djian exprimait le choc joué par le livre de Salinger : « J’ai éprouvé le même genre d’émotion avec L’attrape cœur de Jérôme David Salinger lorsque j’avais dix-huit ans. Je sais de quoi un livre est capable. Je pense à une blessure. Je pense à une blessure qui aurait quelque chose d’amical, d’où le sang continuerait de couler avec douceur pour vous rappeler que vous êtes en vie et même bien en vie et capable d’éprouver une émotion qui vous honore et vous grandit. » Est-ce que la lecture et l’écriture sont pour vous pareilles à cette « blessure amicale » ?
Non, je ne suis pas assez masochiste pour voir les choses comme ça. Je ne cherche pas la souffrance dans l’écriture ou dans la lecture, aussi intenses soient-elles. Je cherche le baume. Les blessures viennent de partout ailleurs : des relations toxiques, de l’état du monde, de la peur de mourir.
L’écriture c’est à la fois l’ensauvagement du monde et sa domestication: la création d’un lieu dont je tiens les rênes, une manière de le rendre habitable et acceptable pour moi-même.
Salomé Kiner
Mais un beau livre, ou une belle page, c’est la sensation d’échapper, l’espace d’un moment, à ces violences extérieures. C’est consolatoire. C’est une expérience de la beauté et de la perfection qui donne tant d’intensité à l’instant qu’elle nous fait oublier notre propre mortalité.
13. Est-ce que l’adolescence peut être considérée comme une métaphore de l’écriture, au sens où l’adolescent pose un regard singulier et irréductible sur le monde, lequel n’obéit pas à un régime convenu ?
Oui, j’aime beaucoup cette idée. L’écriture c’est à la fois l’ensauvagement du monde et sa domestication: la création d’un lieu dont je tiens les rênes, une manière de le rendre habitable et acceptable pour moi-même.
Grande couronne de Salomé Kiner aux éditions Christian Bourgois.




