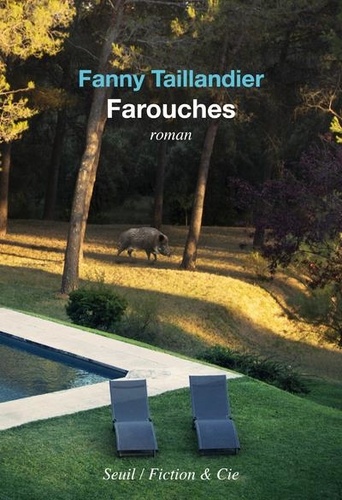Le roman déploie tout un éventail de cartes qui permettent au lecteur de poser des questions sur le monde qui l’entoure. Il cartographie nos territoires extérieurs et intérieurs pour mettre en relief la construction de nos désir et de nos craintes. Avec Farouches, deuxième tome de son entreprise intitulée Empires, Fanny Taillandier interroge notre rapport à l’autre comme lieu et espace où cohabitent la civilisation et la sauvagerie. A travers les personnages de Jean et Baya, l’autrice de Par les écrans du monde nous immerge dans un territoire minuscule, celui de leur propriété dans une Ligurie imaginaire. Ce couple fait face à différentes menaces : des sangliers qui saccagent la propriété, une mystérieuse voisine ou des règlements de compte entre les cités voisines. Ces nombreuses menaces sont autant de lignes d’inquiétudes. Farouches est un roman passionnant où le lecteur est partie prenante dans la narration qui s’offre à lui : il construit et cartographie le sens de cette « œuvre ouverte » qui se joue des codes et des genres romanesques pour mieux inquiéter le réel et notre rapport à l’espace et au territoire.

1. Avec Farouches, vous poursuivez l’entreprise romanesque intitulée Empires, dont Par les écrans du monde constituait le premier volet. On retrouve ce terme d’empires dans votre essai paru en 2016, Les états et empires du lotissement Grand Siècle mais aussi dans le roman Farouches avec des références autant historiques (en lien avec La Ligurie) que musicales (un album collectif d’un groupe de rap). Comment entendez-vous ce terme d’empires ? Est-ce une manière de redonner au geste romanesque toute sa force originelle et mythique, au sens où écrire, c’est imaginer ou bâtir des empires de mots et de personnages ?
Farouches est le volume II d’Empires, un cycle ouvert qui ne contiendra pas que des romans. Ce qui m’intéresse au contraire, c’est d’user de multiples formes d’écriture (fiction, documentaire…) pour creuser cette question : qu’est-ce qui fait, dans l’histoire humaine, que des puissances s’étendent, deviennent impérialistes, unifient un territoire, puis disparaissent ? Comment ce mécanisme, celui des empires, se traduit-il humainement ? Dans des crises, des confrontations, des soulèvements ; mais aussi plus simplement dans des façons d’habiter, des récits communs, des croyances. Par les écrans du monde réfléchissait à l’échelle du globe, avec comme point de départ la collision entre des récits divergents et des impérialismes concurrents, qui a eu lieu le 11 septembre 2001. C’est la grande histoire. Farouches propose une réflexion sur les empires comme lieux d’habitation, de juridiction.
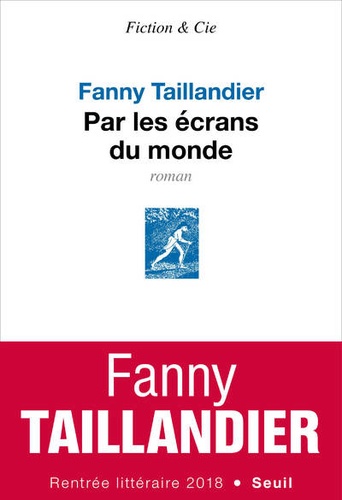
2. Vous situez l’action de Farouches dans une géographie toute particulière, celle de la Ligurie. C’est un espace de la frontière, qui par son histoire est un lieu de rencontres et de confrontation, à l’image aussi des deux citations liminaires qui voient se rencontrer Borges et Booba. Le roman est-il pour vous un lieu médian, un lieu de rencontres qui joue avec la porosité des frontières géographiques et référentielles ? Est-il pour vous le lieu de tous les possibles ?
Historiquement, la Ligurie est le nom donné à un espace qui va de Gênes au delta du Rhône, habité par une population non organisée en Etat, et que l’Empire romain a fini par conquérir. Dans le roman, légèrement uchronique, j’imagine que les Etats nations européens ont laissé place à une Union divisée en contrées locales, dont la Ligurie.
Les frontières, géographiques, mais aussi, en effet, référentielles sont toujours instaurées par une puissance au moment où elle est puissante.
Fanny Taillandier
Ce qui m’intéressait était en effet de dé-fixer les frontières que nous connaissons, d’en rappeler le caractère arbitraire et presque aléatoire. Dans la vallée de la Roya, où se situe le site préhistorique dont il est question dans Farouches, la source est en Italie, l’embouchure aussi, et la vallée est traversée deux fois par la frontière… Mais seulement depuis un peu moins d’un siècle : c’est une invention des états nations. Les frontières, géographiques, mais aussi, en effet, référentielles (les arts dits nobles ou populaires, les auteurs du Panthéon contre ceux de la variété…) sont toujours instaurées par une puissance au moment où elle est puissante. Montrer leur caractère flottant, c’est révéler aussi celui de la puissance…
3. Dans une nouvelle intitulée De la rigueur de la science, Borges imaginait un empire articulé autour de la cartographie : « En cet empire, l’Art de la Cartographie fut poussé à une telle Perfection que la Carte d’une seule Province occupait toute une Ville et la Carte de l’Empire toute une Province. Avec le temps, ces Cartes Démesurées cessèrent de donner satisfaction et les Collèges de Cartographes levèrent une Carte de l’Empire, qui avait le Format de l’Empire et qui coïncidait avec lui, point par point. Moins passionnées pour l’Étude de la Cartographie, les Générations Suivantes réfléchirent que cette Carte Dilatée était inutile et, non sans impiété, elles l’abandonnèrent à l’Inclémence du Soleil et des Hivers. Dans les Déserts de l’Ouest, subsistent des Ruines très abîmées de la Carte. Des Animaux et des Mendiants les habitent. Dans tout le Pays, il n’y a plus d’autre trace des Disciplines Géographiques ». La fiction est-elle l’expression des « Ruines très abimées de la Carte » ? Concevez-vous l’art romanesque comme une façon de cartographier nos territoires ?
C’est une très belle expression, et cette fable est une très belle image de l’Empire, qui veut toujours avoir une vision parfaite de tout ce qui se trame en lui, jusqu’à des fantasmes de surveillance démesurés comme on en voit souvent ces temps-ci. D’un point de vue artistique, oui, cartographier des ruines est un projet qui me parle, et que j’ai d’ailleurs développé tant dans Par les écrans du monde que dans Les états et empires du Lotissement Grand Siècle, où un narrateur collectif menait l’archéologie d’un lotissement pavillonnaire.

4. Votre roman semble vouloir interroger tous les possibles du romanesque, autant par son travail sur les genres que par les différents registres utilisés. Le roman s’ouvre d’ailleurs sur un article type Wikipedia autour de la Ligurie traitant autant de sa géographie que son histoire. Puis intervient le roman et ses différents possibles. Est-ce une façon de confronter le savoir qu’on peut avoir d’un objet à son exploration romanesque, redonnant à ce dernier toute sa richesse et son inquiétante étrangeté ?
L’article Wikipedia est inventé de toutes pièces, peut-être plus fictif encore que l’histoire romanesque qui suit ! Ce n’est pas toujours la réalité qui apporte la connaissance, c’est parfois la fiction qui nous offre son savoir humain. Il y a dans le roman, historiquement, une ambition de connaissance qui a pu être débordante, quand on pense par exemple au naturalisme qui prétendait en faire un outil de sciences humaines aussi rigoureux que l’expérience du chimiste. Cela m’amuse de jouer avec cette ambition, ce désir de vérité qui nourrit les romans et aussi leur lecture.
5. Par son titre Farouches, par celui des différentes parties du roman ainsi que par la présence constante des sangliers dans la propriété de Jean et Baya, le thème de l’animalité est présent, lequel dialogue avec la notion de territoire. Pour Gilles Deleuze, devenir animal, c’est partir loin hors de soi, sortir de chez soi, se « déterritorialiser ». L’animal renvoie à « l’être aux aguets », celui qui se cherche un territoire. L’artiste est-il pour vous pareil à l’animal, au sens où il possède cette faculté de capter des signes pour les interpréter et les traduire ?
Farouche est un mot issu d’une déformation celtique du mot latin forasticus, qui signifie extérieur à, en-dehors. Rien d’étonnant donc à ce que ce terme qualifie en premier lieu les bêtes sauvages, en dehors du pouvoir humain. Mais on pourrait dire aussi que farouche qualifie tout ce qui s’écarte de la norme, de la loi, de l’empire. Se déterritorialiser, oui, mais au sens de se remettre en mouvement, de sortir de la sédentarité qui n’existait pas pour les anciens Ligures comme pour d’autres peuples conquis par les Romains (les Berbères dont est issue Baya notamment), de quitter les notions de propriété, d’appartenance… Je ne sais ce qu’il en est de l’artiste en particulier mais je pense que devenir farouche est une aspiration humaine en général.
6. Le couple du roman Farouches subit la présence permanente de sangliers. Cette présence est perçue comme une menace constante, d’où un rapport de prédation. Ces derniers souhaitent les chasser et tentent de se procurer une arme. Ce rapport de prédation est éclairant quant à notre rapport entretenu à la nature et au concept même de Nature, notamment développé par Alessandro Pignocchi dans La Recomposition des Mondes : « Notre concept de Nature favorise cette relation de sujet à objet (qui se focalise sur l’utilisation) et occulte les riches relations de sujet à sujet (fondées sur la prise en compte empathique de l’autre) que nous pourrions nouer avec les non-humains. Au prisme de l’anthropologie, la protection de la nature apparaît comme le prolongement, indissociable, de l’exploitation. Dans un cas comme dans l’autre, on attribue aux plantes, aux animaux et aux écosystèmes des fonctions au service des hommes. » De quoi ce rapport aux sangliers est-il le nom ?
Jean et Baya n’ont pas le même rapport aux sangliers. Baya veut les repousser, elle souhaite que les lignes de partage soient claires, mais c’est justement en voulant s’en défendre qu’elle devient, d’une certaine manière, sauvage, puisqu’elle décide de quitter le domaine de la loi alors même qu’elle est juriste. Jean, lui, est plus ambivalent ; leur furtivité, leur liberté l’attirent, et il refuse de fermer le jardin. Lui, l’ancien délinquant, jamais à l’aise avec la police, défend la présence des bêtes sauvages.
Et si le sauvage n’était pas l’inverse du domestique, mais l’autre terme d’une même marge de progression ?
Fanny Taillandier
Ce qui m’intéressait dans la présence des sangliers, c’est qu’ils sont une forme très simple, banale, quotidienne, de nature dite sauvage, parce que nos modes d’habitation sont venus empiéter sur leur territoire. Ils ne sont pas agressifs, ni dangereux, mais ils ne sont pas non plus nobles comme les loups ou les ours. Du coup, ils restent globalement en dehors des débats actuels sur le vivant et nos manières humaines de nous y inscrire. C’était cela qui m’intéressait : et si on repartait, non de l’animal comme exotisme radical et rare, mais comme présence sous nos yeux, avec qui nous devons établir une diplomatie qui est celle du voisinage ? Et si, pour aller encore plus loin, le sauvage n’était pas l’inverse du domestique, mais l’autre terme d’une même marge de progression ?

7. Dans Farouches, on trouve des références au rap, dont notamment Booba et un album collectif de PNL. Vous avez récemment écrit avec Romain de Becdelièvre un article dans A.O.C. sur le dernier album de SCH : « On a toujours à moitié raison, ou à moitié tort, quand on compare l’écriture poétique et celle du rap, puisque ça revient souvent à dépoussiérer la première et à anoblir la seconde, en perdant beaucoup des deux dans l’opération. N’empêche, le sens de la concentration dans l’écriture, les phrases chargées comme la poudre de SCH laissent pantois. » A-t-on raison ou tort de penser que votre travail romanesque est influencé par le rap ?
Le rap est la musique que j’écoute le plus depuis mon adolescence. Le travail sur la langue y est primordial : les mots servent le rythme, et le sens de la formule compte énormément. En cela, c’est à mon sens aujourd’hui la forme la plus répandue, et la plus florissante, de poésie. Donc évidemment qu’en tant que littéraire, je m’y abreuve, et je suppose que cela doit influencer ma propre façon d’écrire. Mais plus simplement, je voulais aussi rendre hommage à certains artistes qui m’ont beaucoup accompagnée durant l’écriture du livre, dont des rappeurs mais aussi d’autres musiciens, Mondkopf notamment. Le rap est toujours considéré comme un art à part, tant du côté de la musique que celui de la littérature, alors qu’il fait partie intégrante de la création artistique contemporaine. Alors j’en parle parce que je l’admire beaucoup.
8. Votre roman Farouches travaille de manière profonde et souterraine sur le rapport aux lieux, aux territoires et à l’espace. En quoi votre sensibilité d’urbaniste nourrit-il votre travail romanesque ? Lors de la construction et l’écriture du roman, appréhendez-vous l’espace littéraire comme un espace urbain ?
C’est plutôt ma sensibilité romanesque qui a nourri mon travail d’urbaniste, et l’espace urbain qui m’apparaît comme littéraire ! J’ai une passion très ancienne pour le paysage, qui se lit, qui raconte des strates de l’histoire humaine, et qui cache toujours aussi des interstices où se glissent les histoires individuelles.
J’aimais assez l’idée que Farouches soit une histoire ouverte, que le lecteur ou la lectrice construit aussi, co-raconte.
Fanny Taillandier
Alors que Par les écrans du monde se déployait sur quatre continents, Farouches ne parcourt que quelques kilomètres carrés. Il y a la colline, le centre commercial, les rocades urbaines, les quartiers d’habitation, la plage. C’est un petit monde, mais qui est traversé par les ailleurs que portent en eux les protagonistes, et par l’ensemble des croyances, récits, souvenirs qui le parcourent. J’avais envie de plonger dans ce minuscule, et de voir tout ce qui l’irrigue.

9. Dans un ouvrage collectif intitulé Pas de toit sans toi : Réinventer l’habitat social dirigé par Patrick Bouchain, Sophie Ricard proposait la réflexion suivante : « Construire concerne tout le monde et tout le monde sait un peu construire : cela permet de se rencontrer autour du faire, d’agir concrètement ensemble. Ce qu’il faut généraliser, c’est précisément l’idée qu’il ne faut pas généraliser ! Chacun possède une manière d’habiter qui lui est propre et cela participe de sa singularité. En ce sens, l’architecture n’est peut-être par définition qu’une multitude de petites expérimentations. » Cet art de l’architecture n’est-il pas celui du roman ?
En effet ! SI j’aime la littérature, c’est parce qu’il y a autant de romans que de lecteurs, et même plus de romans que ce qu’on ne pourrait lire en une vie entière. J’essaie de prendre chaque livre comme l’occasion d’une nouvelle expérience, d’une nouvelle manière de se poser les questions, d’exprimer les choses, de créer une ambiance… Refuser la standardisation pour le dire en termes plus politiques. Travailler avec Sophie Ricard et Patrick Bouchain à la Preuve par 7 est le lieu d’une grande complicité intellectuelle et politique.
10. Plusieurs genres littéraires apparaissent par strates dans Farouches, dont le roman noir. Jean-Patrick Manchette en donnait la définition suivante : « Le roman noir est le roman de la crise. Pas étonnant qu’il reprenne du service ces derniers temps ». Quel rapport entretenez-vous avec la littérature dite de genre ? Constitue-t-elle pour vous une façon de traduire les moments de crise ?
Avant d’avoir l’idée de Farouches, j’ai lu durant un an presque exclusivement des romans de Simenon, et j’ai relu l’ensemble des romans de Manchette. Je me suis beaucoup interrogée sur ce qui fait la force du roman noir, peut-être son lien indéfectible avec la loi (morale ou non) qu’il vient toujours remettre en cause ; c’est en ce sens, je crois, qu’il s’apparente structurellement à une crise.
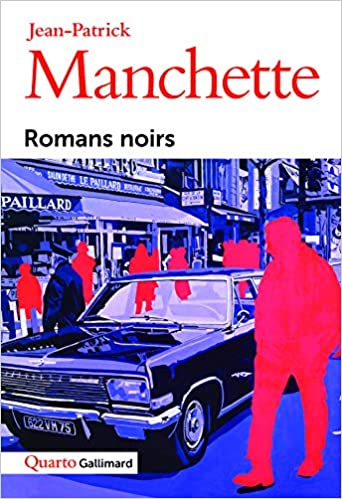
Paradoxalement, j’ai le sentiment que la littérature de genre en dit souvent plus que la littérature blanche sur les rapports entre l’individu et le collectif, alors qu’elle repose sur des intrigues extraordinaires. Au-delà de tout ça et peut-être plus simplement, le roman noir constitue une boite à outils narrative hors pair : suspense, effroi, mystère… J’avais envie de m’en servir.
11. Le roman travaille sur l’incertitude et fait planer de manière constante l’inquiétude, voire une inquiétante étrangeté. Les personnages de Farouches se trouvent face à des situations dont ils n’ont pas toujours forcément la réponse. Le roman emploie aussi un art de l’ellipse, laissant au lecteur des horizons ouverts et non clos. La littérature est-elle pour vous le lieu qui fait surgir les questions ?
Oui, complètement. J’aime dans la littérature ce qui interroge, pas ce qui affirme. Le roman est pour moi l’art de faire émerger simplement la complexité des choses. J’aimais assez l’idée que Farouches soit une histoire ouverte, que le lecteur ou la lectrice construit aussi, co-raconte. Peut-être comme les sangliers qui ouvrent des passages dans les haies, et donc suggèrent de nouveaux chemins…
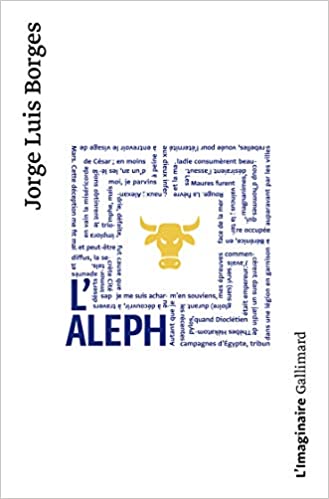
12. Le corps de votre roman incorpore par ailleurs le récit mythologique. Avec des références aux récits celtes ou à la figure du minotaure et du labyrinthe. Cette figure renvoie à la citation de Borges qui ouvre le roman extraite de La demeure d’Astérion : « Chaque endroit est un autre endroit « . Dans un article intitulé « Jorge Luis Borges et la dédalographie. », Manuel Bello Marcano interrogeait le rapport que l’on pouvait entretenir au labyrinthe : « Dans ce sens existent plusieurs caractéristiques qui conditionnent l’espace du labyrinthe. D’abord, le labyrinthe est un endroit facile d’accès mais d’où il est très difficile de sortir. On pourrait dire qu’il tient, en tant que source spatiale, tant du refuge que de la prison. En ce sens, il y a deux façons d’habiter un labyrinthe, deux formes depuis deux points de vue différents, une depuis l’intérieur (le dedans), et l’autre depuis l’extérieur (le dehors). » Construire un roman, est-ce construire d’une manière ou d’une autre un labyrinthe ? Empruntez-vous lors de l’écriture le point de vue de l’intérieur ou celui de l’extérieur ?
Le labyrinthe et ses monstres, dans la mythologie, sont au carrefour du fantastique et du métaphysique. C’est l’espace qui s’offre et se dérobe, c’est la rencontre avec l’animal qui permet de devenir humain. Le labyrinthe, c’est un plan de ville humaine qui contiendrait en lui l’énigme même de ce qui nous fait construire. En ce sens, oui, peut-être que construire un roman, c’est faire un labyrinthe : dessiner une forme parfaite où le sens interroge toujours.
Les romans, c’est l’endroit où l’on peut toujours sauter la clôture, faire le mur. C’est ce qui me plaît.
Fanny Taillandier
13. Le roman Farouches interroge aussi à travers la propriété de Jean et Baya ainsi qu’à travers la Ligurie le rapport à l’espace privé et public, rejoignant la réflexion de Michel Foucault sur le dehors et le dedans : « On doit échapper à l’alternative du dehors et du dedans : il faut être aux frontières. La critique, c’est l’analyse des limites et la réflexion sur elles. » Ces frontières et limites dont parle Michel Foucault peuvent-elles répondre aux frontières et aux limites du roman ?
Je vais laisser la parole à Jean, pour conclure : « Une barrière que l’on monte, c’est toujours un chemin que l’on ferme. » Les romans, c’est l’endroit où l’on peut toujours sauter la clôture, faire le mur. C’est ce qui me plaît.