L’écriture et la lecture ont ceci de commun qu’elles sont autant une quête qu’une enquête : elles sont ce miroir qui réfléchit aussi bien le monde que soi-même pour interroger l’humaine condition. Dans son sixième roman, Une vie cachée, qui a paru aux éditions de l’Olivier, Thierry Hesse poursuit tout à la fois une quête des autres et une enquête littéraire à travers la figure de son grand-père paternel. L’auteur de L’inconscience et du Roman impossible continue donc à déplier ce territoire de la filiation à travers un roman fascinant et nécessaire en retraçant l’existence de son grand-père dans un monde passé qui fait écho à celui dans lequel nous vivons. Dans Une vie cachée, la littérature est cette lumière fragile qui éclaire la part sombre et inconnu inhérentes à toute vie humaine et l’auteur est pareil à un mémorialiste des souterrains de nos images enfouies.

1. Dans un précédent roman intitulé L’inconscience, vous interrogiez notamment le thème de la filiation : « Les pères vivent dans un monde permanent de paroles, ils traitent leurs fils comme des oreilles ou des micros. Dès qu’ils sont pères, ils se reconnaissent à leur voix, un ou deux tons plus grave, et parfois plus rugueuse ; et les fils, dès qu’ils sont assez grands pour entendre cette voix, existent à travers les paroles de leur père. » Dans Une vie cachée, vous convoquez à nouveau ce thème à travers la figure du grand-père. Ce livre est-il autant une tentative de recomposer la voix perdue du grand-père que son image ?
Une vie cachée est mon sixième roman, et tous questionnent, à des degrés divers, le sujet, inépuisable, de la filiation. Paternelle, maternelle, culturelle, historique… Cette fois, en m’intéressant à la figure d’un grand-père paternel (qui ressemble au mien sans l’être tout à fait), j’ai cherché à savoir quel rôle précis, quelle signification, cette figure de grand-père pouvait avoir au sein d’une famille française enracinée dans un territoire, la Lorraine, marqué plus que d’autres par l’Histoire et la valse des frontières. Franz ou François, né en 1891 dans une Moselle « colonisée » par l’Empire allemand, est administrativement, juridiquement, de nationalité allemande, mais de sang français.
À ma façon, j’ai tenté de recomposer, non pas la voix ou les pensées de cet aïeul disparu, mais le trajet de son existence.
Thierry Hesse
Il arrive que ma compréhension du réel passe par des phrases ou des idées prélevées dans des livres. Il y a longtemps, j’ai été frappé par une formule de Thomas Bernhard : « les grands-pères sont les véritables philosophes de tout être humain », et j’ai eu envie de vérifier si cette formule pouvait s’appliquer à ce grand-père François qui n’était pourtant pas un « homme de lettres » (comme l’était le grand-père de Thomas Bernhard), qui n’avait rien d’un érudit, mais était un homme simple, ordinaire, d’une humilité touchante et à la parole rare. Est-il nécessaire de parler pour être « philosophe » ? À ma façon, j’ai tenté de recomposer, non pas la voix ou les pensées de cet aïeul disparu, mais le trajet de son existence — les drames qu’il a subis, les décisions qu’il a prises, ses peines et ses joies — dans un temps qui n’est certes plus le nôtre mais qui, comme le nôtre, était tourmenté par le problème des frontières, des nationalités, des identités. En quoi cette existence, que j’ai brièvement croisée dans mon enfance, a-t-elle pu m’enseigner une forme de savoir ? Et s’il se trouve qu’elle m’a peu appris, le roman qu’elle m’a inspiré projette sur ma propre histoire, en particulier sur ma relation avec l’Allemagne, une lumière nouvelle.
2. L’écriture de ce texte entremêle enquête littéraire, en convoquant aussi Kafka, Claude Simon que Kundera et Proust, et quête personnelle et familiale. En quoi la lecture et la relecture de ces grands récits répondent-elles à celles de votre propre récit ? Autrement dit, en quoi lire, c’est se lire soi-même ?
Si la littérature (les grands auteurs, les grands textes) relève de l’art, elle n’est pas non plus sans rapport avec la science (je pense notamment à la physique, à l’histoire, à la géographie…). Une photographie, un morceau de musique, un tableau de peinture peuvent, par leur expressivité, nous bouleverser, rendre merveilleusement présents personnes, sentiments et événements, mais ils ne « racontent » rien et n’expliquent rien. La littérature, au contraire, parce qu’elle est œuvre de langage, est un mode de connaissance du réel. Les « grands récits », comme vous dites, nous permettent de déchiffrer le monde dans lequel nous vivons. Lavoisier et Newton exploraient la réalité matérielle ; Kafka et Proust, la réalité humaine dans sa singularité et son ambiguïté.
Il faut lire pour (mieux) vivre.
Thierry Hesse
De sorte que, si nous lisons ce que la littérature nous offre de meilleur, nous découvrons que ces récits parfois étranges, parfois intimidants, écrits par des écrivains jamais rencontrés et si éloignés semble-t-il de notre présent actuel, parlent en vérité de nous, de notre condition, parfois même de notre propre vie. Il faut lire pour (mieux) vivre. Dans tous mes romans, ce n’est pas par hasard (ni par pédanterie) si des écrivains sont sollicités : je les vois comme des témoins de ce que j’essaie de découvrir ; des éclaireurs aussi. Quand Kundera raconte, dans L’insoutenable légèreté de l’être, l’invasion de Prague, à l’été 1968, par les troupes du Pacte de Varsovie, il m’en apprend au moins autant qu’un historien de l’Alsace et de la Moselle sur le sort de nos provinces annexées un siècle auparavant.
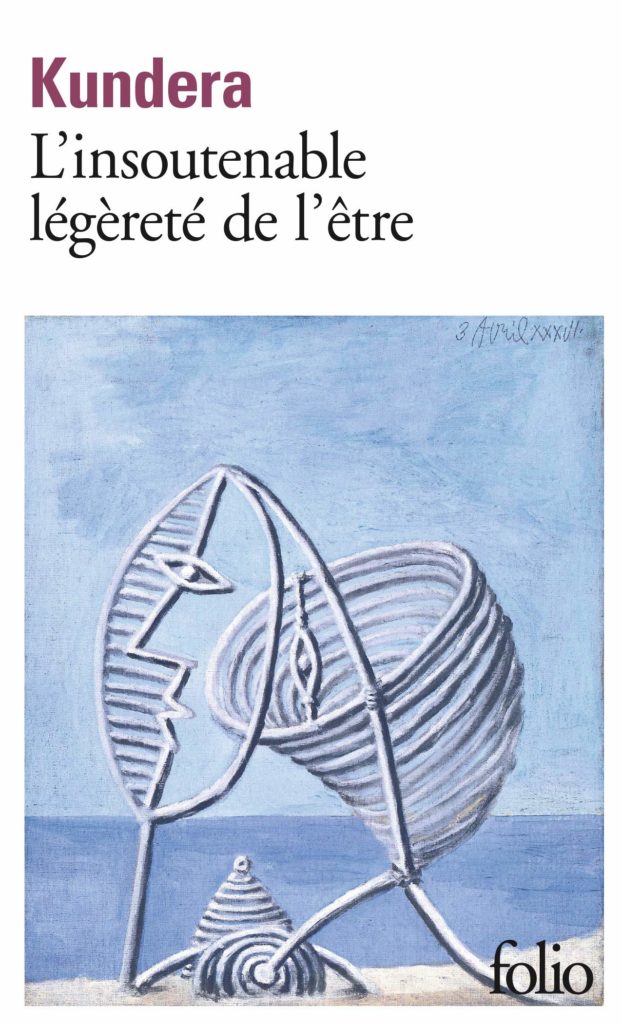
3. En exergue du Roman impossible, on trouvait cette citation extraite du Temps retrouvé de Proust : « C’est quelquefois au moment où tout semble perdu que l’avertissement arrive qui peut nous sauver ». Dans Une vie cachée, vous convoquez à nouveau Marcel Proust avec la figure de la grand-mère du narrateur en citant la phrase suivante : « La vie en se retirant venait d’emporter les désillusions de la vie ». Qu’avez-vous réussi à retrouver dans ce temps qui semblait perdu ?
La scène de la mort de la grand-mère du narrateur est l’une des plus poignantes de l’œuvre de Proust et j’y ai bien sûr pensé, pour les raisons que je viens d’évoquer, au moment d’écrire la mort de mon grand-père François — une mort à laquelle je n’ai pas assisté. Proust, que j’admire, n’est pourtant pas l’écrivain qui m’inspire le plus dans ce livre. La Recherche est tout entière traversée par les thèmes de la mémoire et du désir ; or Une vie cachée est d’abord un roman sur l’oubli et l’absence de désir.
Je pense que la littérature, quels que soient les formes et les sujets qu’elle se donne, tente toujours de répondre à une seule question : « Qu’est-ce que cela fait d’être humain ? »
Thierry Hesse
Mon projet était le suivant : comment restituer le passé d’un homme qui n’a guère laissé de traces ni de souvenirs, et me donne l’impression, chaque fois que je songe à lui, de ne pas avoir pleinement habité sa propre existence ? J’ai compris qu’un être humain, aussi secret soit-il, se révèle aussi à travers des lieux et des objets. C’est ainsi que s’est déployée mon enquête : en décrivant différents lieux (un quartier, un appartement, un champ de bataille…), en étudiant certains objets (une photographie de soldat, une sculpture animalière dans un parc, une drôle de canne…), je crois avoir retrouvé, malgré le manque d’archives, et par la force du langage, une partie du passé de François.
4. Certaines figures d’écrivains jouent dans ce texte un rôle central, à commencer par Franz Kafka, dont le prénom renvoie à celui de votre grand-père. On sait à quel point le nom chez Kafka répond à une quête ontologique et littéraire. Il s’agissait pour lui de réussir à dire et à nommer le père, avec sa Lettre au père, ou bien d’interroger le nom même de ses personnages dans Le procès ou Le château. La littérature est-elle pour vous une façon de nommer sa famille et de chercher à se nommer soi-même ?
Je pense que la littérature, quels que soient les formes et les sujets qu’elle se donne, tente toujours de répondre à une seule question : « Qu’est-ce que cela fait d’être humain ? » Et toutes les histoires qu’elle invente sont des interprétations possibles de cette question. Maintenant, pourquoi suis-je obnubilé par le thème de la famille ? Je remarque que je ne suis pas le seul. Dans la littérature contemporaine, Jonathan Franzen et Daniel Mendelsohn ont écrit des « romans familiaux » brillants et profonds ; et Claude Simon comme Kafka nous ont laissé sur le sujet des chefs-d’œuvre (La Métamorphose est avant tout pour moi une histoire de famille).
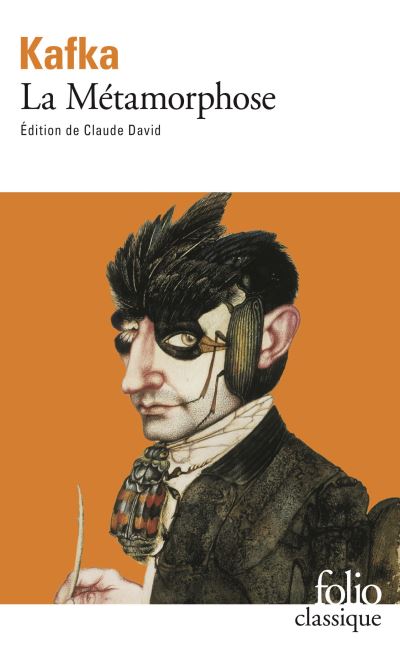
Je dirais qu’interroger la réalité familiale est une façon de s’interroger sur sa propre place. Si l’on se sentait tout à fait « à sa place », d’ailleurs, il est probable que l’on n’écrirait pas. Mon grand-père François était un être « déplacé ». En enquêtant sur lui, en tentant de cerner son identité, j’ai aussi cherché à savoir quelle pouvait être ma place, non pas seulement dans ma famille, mais aussi dans ma ville et mon époque. En y réfléchissant, je dirais que c’est peut-être ce qui, depuis toujours, me fascine chez Kafka : le problème non pas tellement du « nom » mais celui de la place. N’est-ce pas la question que pose Gregor Samsa dans La Métamorphose, et Kafka lui-même dans sa Lettre au père : quelle est ma véritable place ?

5. Le rythme de l’écriture dans Une vie cachée est particulièrement important, d’autant qu’il marque votre quête littéraire et personnelle. Le pas de l’écriture se mêle à celui du galop du cheval, en référence à Claude Simon. Dans son Discours de Stockholm, ce dernier mettait le mouvement de l’écriture au centre : « En fait, de même que la peinture lorsqu’elle prenait pour prétexte une scène biblique, mythologique ou historique (qui peut sérieusement croire à la « réalité » de telle Crucifixion, de telle Suzanne au bain ou de tel Enlèvement des Sabines ?), ce que l’écriture nous raconte, même chez le plus naturaliste des romanciers, c’est sa propre aventure et ses propres sortilèges. » Que nous raconte Une vie cachée sur l’aventure de l’écriture ?
Ce n’est pas vraiment à moi de répondre à cette question, c’est aux lecteurs et aux critiques. Je peux seulement dire que je partage, dans une large mesure, l’idée de Claude Simon : si tout roman nous raconte une histoire, il ne saurait se réduire à l’histoire qu’il raconte. Dans les textes les plus accomplis, il vient toujours un moment où la langue se retourne sur elle-même, où ce qui fait avancer le texte, ce qui lui donne vie, ce n’est pas l’intrigue ou d’improbables rebondissements mais le miracle de la phrase, la forme qu’elle révèle tout à coup sous nos yeux, le poids d’expérience qu’elle contient.

Écrire un roman, c’est donc trouver une forme pour l’histoire que l’on veut raconter. Vous avez sur la table tous les ingrédients indispensables à la fabrication d’une chose. Une chose qui vous tiendra lieu de guide ou de moyen de chauffage, ou bien qui sera décorative, peu importe… Ces ingrédients, c’est une masse confuse de perceptions, de souvenirs, d’impressions… Seulement ils ne vous serviront à rien si vous ne trouvez pas une forme. Cette forme, appelons-la un moule, un style, le travail de la prose, quoi qu’il en soit c’est à vous de la trouver, dans la cuisine de votre esprit. Ici commence l’aventure. Les écrivains dignes de ce nom conçoivent leur propre moule, il ne leur servira en général qu’une fois, et personne ne sera capable de le reproduire, ni de le décrire précisément.
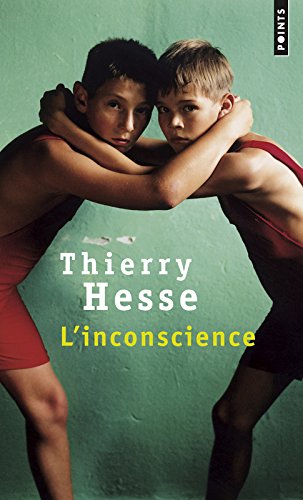
6. Dans votre roman L’inconscience, vous donniez cette définition de la vie : « Vivre est une expérience physique vibrante, capable de nous conduire aussi loin que possible, et même au-delà. » Peut-on dire la même chose de la lecture et de l’écriture ?
Je ne me rappelle plus le sens exact que je prêtais à cette phrase. Cette idée d’un « au-delà de la vie » est, du reste, assez énigmatique : que peut-il y avoir au-delà de la vie ? En revanche, je suis convaincu que l’écriture et, dans certaines conditions, la lecture produisent une intensification du réel, et donc probablement de la vie. Souvent, nous ne vivons pas ce que nous vivons. Nous en avons une impression fugace, partielle, chaotique, comme si nous n’éprouvions pas intimement, sauf en de rares exceptions, les expériences qui nous arrivent. C’est parce que, mus par nos besoins, nous agissons au-devant de nous-mêmes, dans l’anticipation et la visée d’un but ou d’une satisfaction.
Un livre est tout à fait capable « de nous conduire aussi loin que possible », au-delà de la vie ordinaire, en nous révélant qu’elle n’a rien d’ordinaire justement.
Écrire, ce n’est sûrement pas donner libre cours à ce flux confus de l’expérience ; c’est, au contraire, comme dit l’écrivaine anglaise Zadie Smith, contrôler l’expérience, résister à son flux. Lorsqu’on y parvient dans l’écriture d’une scène — celle, par exemple, dans mon roman, où le grand-père du narrateur emmène son petit-fils au jardin botanique et lui montre une sculpture qui les effraiera tous les deux —, il est permis de penser que « l’effet de réel » obtenu est bien plus intense, bien plus vivant et éclairant que le pauvre souvenir qu’on en a, s’il existe. En ce sens, un livre est tout à fait capable « de nous conduire aussi loin que possible », au-delà de la vie ordinaire, en nous révélant qu’elle n’a rien d’ordinaire justement.

7. Le roman comporte six photographies, représentant des lieux, des objets et des personnes. Il compose ainsi un dialogue avec ces photographies en convoquant tout d’abord la figure du passé. Dans La chambre claire, Roland Barthes interrogeait l’effet créé par la photo :« L’effet qu’elle produit sur moi n’est pas de restituer ce qui est aboli (par le temps, la distance), mais d’attester que cela que je vois, a bien été. » S’agissait-il pour vous, en intégrant ces photos, de rendre le passé présent ?
Barthes a raison d’affirmer que la légende de toute photographie est : « cela a eu lieu, cela a été ». D’où le possible avantage de la photographie sur la peinture. Je me souviens d’une remarque assez amusante de l’essayiste Susan Sontag. Si l’on demandait aux admirateurs de Shakespeare (dont on ne sait pas à quoi il ressemblait) de choisir entre un portrait de Shakespeare réalisé par le plus grand peintre de son temps et une photographie même floue, même médiocre (un photomaton raté, par exemple) de l’auteur de Hamlet, « la plupart des shakespearomanes, dit-elle, choisiraient la photo ». Elle serait une preuve de l’existence de Shakespeare.
8. L’écrivain allemand Sebald emploie également de nombreuses photos dans ses textes, à l’instar d’Austerlitz, lui permettant de convoquer la figure du spectre : « J’ai toujours la vague impression, explique-t-il dans un autre entretien, que, bien sûr, ces gens n’ont pas vraiment disparu, qu’ils sont toujours là quelque part à rôder autour de nous et qu’ils continuent à nous rendre de courtes visites. Et pour moi, les photographies sont une des incarnations des disparus, particulièrement les photographies les plus anciennes de ceux qui nous ont quittés. Quoi qu’il en soit, à travers ces images, ils ont véritablement pour moi une sorte de présence spectrale. » Quelle présence ont pour vous ces différentes photos ?
Si j’ai choisi d’insérer des photographies dans Une vie cachée, ce n’est pas exactement pour établir des « preuves » de l’histoire que je raconte, mais dans le but de fournir au lecteur quelques-uns des indices dont je disposais moi-même au début de mon enquête. Lui permettre ainsi de s’identifier au narrateur dans la quête qui est la sienne et de partager certaines de ses inquiétudes. Dans une première version du roman, il y avait une douzaine d’images. J’en ai conservé six, les seules qui n’avaient pas de fonction illustrative, mais une fonction dynamique ou interrogative — romanesque, si l’on veut.
En racontant l’histoire de François, il m’est revenue cette phrase de Sartre, que je cite de mémoire : « L’essentiel n’est pas ce qu’on a fait d’un homme, mais ce qu’il fait de ce qu’on a fait de lui. »
Thierry Hesse
J’ai une très vive admiration pour l’œuvre de Sebald et je comprends que vous l’évoquiez ; cependant, en dépit de la présence de photographies de disparus, mon roman n’a pas grand-chose de sebaldien. Les livres de Sebald sont tous hantés par le thème de la destruction (celle de la nature, de la civilisation, du monde humain), alors que la fin de mon roman imagine, si j’ose dire, un autre destin à l’humanité. La liberté des hommes, selon moi, n’est jamais détruite malgré les ravages de l’Histoire. En racontant l’histoire de François, il m’est revenue cette phrase de Sartre, que je cite de mémoire : « L’essentiel n’est pas ce qu’on a fait d’un homme, mais ce qu’il fait de ce qu’on a fait de lui. »
9. Une vie cachée interroge le geste même de la littérature, puisque vous aboutissez à l’idée que cette dernière est « la langue des morts » : « Si la littérature est un chant de vie, elle est aussi un immense champ de morts ». L’écriture est-elle pour vous une expérience des limites de la langue, limite entre le dicible et l’indicible, le visible et l’invisible, l’audible et l’inaudible ?
Il y a la littérature idéale et puis la littérature réelle : celle que l’on fait ou lit. J’aimerais que la littérature soit toujours, comme vous dites, « une expérience des limites de la langue », mais est-ce possible ?
10. Cette « langue des morts » interroge aussi la portée littéraire de toute œuvre. Dans L’espace littéraire, Maurice Blanchot convoquait les figures mythologiques d’Orphée et d’Eurydice pour chercher à saisir ce qui échappe à toute œuvre, ce qui est caché dans toute vie : « Quand Orphée descend vers Eurydice, l’art est la puissance par laquelle s’ouvre la nuit. La nuit, par la force de l’art, l’accueille, devient l’intimité accueillante, l’entente et l’accord de la première nuit. […] L’œuvre d’Orphée ne consiste pas cependant à en assurer l’approche en descendant vers la profondeur. Son œuvre, c’est de le ramener au jour et de lui donner, dans le jour, forme, figure et réalité. […] Le mythe grec dit : l’on ne peut faire œuvre que si l’expérience démesurée de la profondeur — expérience que les Grecs reconnaissent nécessaire à l’œuvre, expérience où l’œuvre est à l’épreuve de sa démesure — n’est pas poursuivie pour elle-même. La profondeur ne se livre pas en face, elle ne se révèle qu’en se dissimulant dans l’œuvre. » Écrire sur cette figure cachée du grand-père relève-t-il d’un seul dévoilement ou ne reste-t-il pas une part toujours dissimulée ?
J’ai une conception beaucoup plus commune et pratique de mon activité d’écrivain. J’écris un roman parce que je pense que j’ai à le faire. Je ne parle pas d’une « nécessité intérieure » (rien n’est vraiment nécessaire, je crois), je parle d’un travail à accomplir. Ce travail qui, pour chacun de mes livres, peut m’occuper deux, trois, cinq ans, n’a absolument rien d’héroïque, c’est seulement une tâche pour laquelle je crois avoir quelques compétences (je sais plus ou moins « faire »), qui me sont reconnues par ceux qui trouvent un certain intérêt à me lire, comme moi-même je trouve un certain intérêt à écrire. C’est une contribution plus ou moins utile au monde humain, comme d’autres fabriquent des armoires, soignent des enfants, calculent des bilans, prévoient le temps qu’il fera.
La force d’un roman, d’une image, est aussi dans ce qu’ils ne montrent pas.
Thierry Hesse
La seule différence notable qu’il y a entre faire une armoire et faire un roman, c’est que, dans le cas d’un roman, nous avons à faire avec la langue. On n’opère pas avec des planches, avec de la colle et des charnières, mais avec des mots et des phrases, on doit se débrouiller avec cela, et vient un moment où l’on découvre ce que le langage renferme de prodigieux : il permet de dire ce qui était tu, de rendre présent ce qui est absent, de faire parler les morts. Alors la littérature, c’est vrai, n’est plus seulement une activité pratique susceptible de procurer du plaisir à ceux qui s’y intéressent : elle réussit, comme par miracle, à réunir ce qui était séparé.

Mon grand-père François a disparu il y a presque cinquante ans et pourtant je sens bien qu’il n’a jamais été aussi vivant que lorsque que j’ai écrit ce roman, et, plus extraordinaire encore, que sa vie éteinte et finie va prendre aux yeux de certains lecteurs un éclat inattendu. C’est en ce sens que la littérature est un art incomparable. Faut-il dire pour autant qu’elle « dévoile » ce qui était caché ? Lever le voile ne signifie pas forcément montrer. Les livres qui prétendent « tout montrer », « tout dire », négligeant la valeur du mystère ou du secret, sont d’une grande platitude. Ils ont perdu toute profondeur. La force d’un roman, d’une image, est aussi dans ce qu’ils ne montrent pas. Rappelez-vous cette image de l’année 1963 : l’une des photographies les plus connues de Jackie Kennedy, après l’assassinat du président. Jackie en toque noire avec un voile comme accessoire de deuil. La veuve de JFK couvre son visage flétri et malheureux, elle le cache, et en même temps vous voyez la perte de Jackie Kennedy s’étaler partout, à la télé, dans les journaux, dans les livres d’histoire. Son voile destiné à cacher sa douleur est en fait, comme l’a écrit l’écrivain américain Rick Moody : « le rappel de la gravité de sa tragédie. »
11. Votre grand-père était tailleur. Ce métier convoque autant les contes de fées avec la figure du tailleur chez les frères Grimm que l’acte même de coudre et de confectionner un habit à partir de différents matériaux. Le livre est composé de différents tissus, aussi bien littéraires qu’autobiographiques. L’écrivain rejoint-il le tailleur par sa capacité à coudre différentes pièces des réalités qui l’entourent ?
Dans la dernière partie de mon roman, il y a cette phrase : « Je n’ai jamais pensé être tailleur. » C’est le narrateur qui s’exprime et aussi l’auteur que je suis. Une vie cachée est certainement un roman autobiographique. Est-ce à dire que tout y est vrai ? Il n’est pas moins justifié d’affirmer : nombre d’éléments ont été inventés (des noms, des lieux, des événements…). Les personnages du roman sont certes des personnes qui ont existé, des hommes et des femmes avec lesquels j’ai vécu, des membres de ma famille ; le roman est en outre basé sur mon enfance et mon adolescence ; et pourtant le monde qu’il fait apparaître est un monde « parallèle » au monde réel. Tout ce qui se déroule dans le roman n’a pas forcément eu lieu, tout ce que les personnages disent n’a pas forcément été prononcé…
Je me suis fait la promesse de comprendre au mieux l’histoire de mon grand-père grâce aux libertés que donne la forme romanesque mais en évitant si possible de le trahir.
Thierry Hesse
L’écrivaine Toni Morrison disait que toute personne est propriétaire de sa vie et qu’aucun auteur n’a le droit d’en faire un usage fictionnel. Il est difficile de contester ce principe moral. Cependant, quand une vie achevée se trouve livrée à l’oubli, au discrédit du temps, la littérature peut offrir, je crois, une forme de réhabilitation. Je me suis fait la promesse de comprendre au mieux l’histoire de mon grand-père grâce aux libertés que donne la forme romanesque mais en évitant si possible de le trahir. Pour y parvenir, peut-être ai-je ajusté mes phrases en me rappelant son travail de tailleur en train d’ajuster les pièces d’un vêtement : avec le plus grand soin, veillant à ce qu’il soit à la « bonne taille », que les coutures ne se voient pas. Je suis persuadé que notre identité (la « place » qui est la nôtre) dépend moins de la réalité de nos origines et des épreuves traversées par notre famille que de la manière toute personnelle que nous avons, chacune et chacun, de nous approprier ces origines et d’écrire, soit mentalement, soit dans un livre, l’histoire « authentique » de notre famille : la seule qui vaudra à nos yeux.
Une vie cachée de Thierry Hesse aux éditions de l’Olivier




