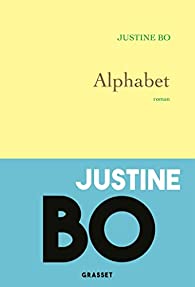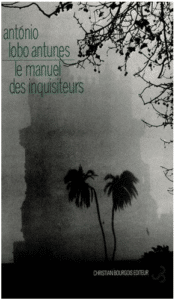Le roman de Justine Bo Alphabet, aux éditions Grasset, creuse le corps de l’écriture en cherchant à dire l’impossible qu’est l’inceste. Raconter et dire. c’est par ce geste double qu’elle fait entendre toute la violence silencieuse d’un tel évènement. Elle sculpte les lettres pour leur rendre tous leurs silences. Elle convoque dans les mots des incendies intérieurs. Ce roman porte en lui un labyrinthe mythologique où les mots sont tendus vers un ailleurs impossible.

1. L’écriture, par ce mouvement de tracer des lettres composant après coup un sens, renoue avec cette violence du geste premier : celui du signe. Henri Michaux avait tenté dans Saisir de tendre vers un langage universel, dont il serait l’auteur, et qui serait fait, non pas de mots à prononcer, mais de signes :« Qui n’a voulu saisir plus, saisir mieux, saisir autrement, et les êtres et les choses, pas avec des mots, ni avec des phonèmes, ni des onomatopées, mais avec des signes graphiques ? » L’alphabet dont vous parlez et que vous utilisez se situe-t-il, tel un lieu ou un espace, en amont ou en aval de ces signes ? En quoi l’emploi du singulier dans le titre exprime-t-il une singularité irréductible et violente ?
Toute l’œuvre de H. Michaux inonde mon travail. Si seul son poème “Alphabet” est cité dans le roman, son idée du “signe” en a empreint l’écriture. Au fond, ce texte n’est qu’une variation autour de la frontière entre “civilisation” et “barbarie”, mot qui signifie à l’origine “celui qui ne parle pas grec”. Il est formé des sons que les Grecs employaient pour imiter des langues étrangères. Or, l’ambition du texte était, par l’écriture, de parvenir au “langage d’avant le langage”. La recherche du geste violent de l’inceste guide le récit. Or, ce geste intervient dans l’enfance, à un moment où le langage, pas encore formé, n’est qu’un amas de signes.
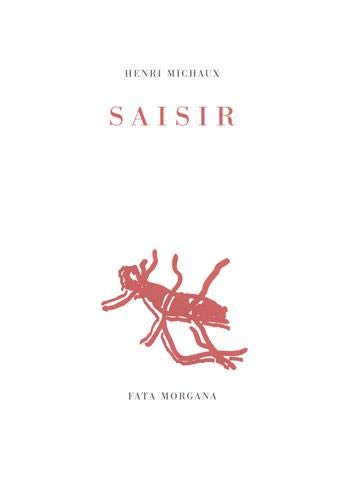
L’écriture de ce texte vient d’un sursaut vital. Je devais m’extirper du discours. Le discours sur la violence, en particulier la violence de l’inceste, poursuit cette violence. Ce sont les mots de la réparation, du pardon, de la faute, de l’intimité, de la justice. Ces mots-là s’inscrivent précisément dans le cadre qu’ils devraient détruire. On est du côté de la civilisation. Écrire ce texte a d’abord correspondu à un mouvement de destruction. Il fallait tout détruire. En détruisant, on décrit. On dissèque les murs, les cloisons, les rues, les territoires ; on dissèque les corps, leurs gestes, leurs accidents. Il y a une continuité très nette pour moi de la destruction à l’écriture, en passant par la description de ce qu’on est en train de détruire.
Pour écrire Alphabet, je devais revenir à ce geste. Revenir à l’essence, à la racine.
Justine Bo
C’est aussi pour cela que le livre s’appelle Alphabet : j’ai compris, pour la première fois, et c’est la première fois que j’ai voulu le comprendre, ce que signifie le verbe “écrire”, dont l’étymologie signifie “écorcher”. C’est-à-dire quelque chose de physique, un geste clair, dont l’intention est précise mais le résultat hasardeux. Une écorchure n’est pas une entaille ou une cicatrice. Une écorchure, c’est une surface qui ouvre sur des aspérités. On fait surgir une matière nouvelle en altérant la matière existante. L’écriture, marque de civilisation, intervient par un geste qui cherche, fouille. Un geste d’avant la civilisation. Pour écrire Alphabet, je devais revenir à ce geste. Revenir à l’essence, à la racine. L’alphabet, donc, mot formé des deux premières lettres grecques : alpha, le bœuf, animal dont Zeus prit la forme pour rapter Europe, et bêta, la maison. Ce qui est intéressant pour moi, c’est que la Grèce est à l’origine, c’est un pays familier, un pays de mon enfance, mais c’est à l’origine mon premier pays étranger, un pays que je n’ai jamais vu, dont je ne parle pas la langue.
Cet alphabet qui donne son titre au roman est au singulier parce qu’il est un alphabet nouveau, né de la friction des signes entre eux.
Justine Bo
Junon, la narratrice du roman, réalise en écoutant les enregistrements qu’elle a fait de sa visite à Yórgos qu’elle comprenait immédiatement tout ce qu’il disait, malgré son accent et sa recréation de la langue française. Elle comprend qu’elle est en permanence dans un écart de traduction. Au lieu de dire “je ne t’ai pas reconnue”, Yórgos dit : “je ne t’ai pas connue”, et au lieu de dire “souvenir”, il dit “venir”. L’alphabet dont je parle érode la langue qu’on m’a apprise — le français — et fouille celle qu’on ne m’a pas apprise — le grec. Quelque part dans le cinéma de J.L. Godard, tel qu’évoqué par G. Didi-Huberman, il y a cette idée que l’image absolue n’existe pas, mais que c’est la friction des images entre elles qui produit de l’absolu. Cet alphabet qui donne son titre au roman est au singulier parce qu’il est un alphabet nouveau, né de la friction des signes entre eux. L’essence de cet alphabet, c’est la matière. La matière architecturale, d’abord, soit la façon dont l’espace se présente aux corps qui le traversent : murs, portes, meubles, sols, plafonds, barrières. La matière brute : béton, métaux, pierres. La matière organique : peaux, muscles, os, tendons, nerfs. L’espace, ici, se mêle au temps. Décrire une maison, c’est procéder en archéologue. Décrire un corps, c’est excaver ses blessures. Mon alphabet est une seule matière à travers laquelle tous ces éléments s’entrechoquent.
2. Toute la force de ce roman provient de sa double articulation : raconter et dire. Raconter une chronologie et dire quelque chose de l’inceste. Ce double geste est-il pour vous inhérent à l’écriture d’Alphabet ?
En effet, il y a un double mouvement dans le texte. Mais si précisément il repose sur le “raconter” et le “dire”, c’est pour en dévoiler l’inanité, en faire naître autre chose. Montrer que dans l’entrechoquement du “raconter” et du “dire” peut surgir une autre voie, plus féconde, plus profonde, pour “traduire” notre rapport à la violence. D’ailleurs, dans une version antérieure du texte, il y avait dans les premières pages cette phrase, qui je crois retranscrit bien ce qu’est devenu le roman : “Ce texte est un écart de traduction”.
Pour moi, la littérature n’est ni du côté du récit, ni du côté de la parole. Elle existe contre.
Justine Bo
Ce double mouvement, qu’on peut identifier comme la tension entre celui du temps long, du récit, de la narration, et l’instantané de la violence tient selon moi à l’évidence qui a présidé l’écriture du texte : il existe d’un côté le système violent, de l’autre l’instant de l’acte violent. Or, ces deux pans de la violence en portent l’intensité, sans pouvoir à eux seuls la retranscrire tout entière. Il fallait que ces deux dimensions existent l’une à côté de l’autre, l’une par l’autre, l’une à travers l’autre, d’où ce “ressac” qui nous mène sans cesse de l’instant de la rencontre à des épisodes lointains du récit familial. Le texte est la lutte de l’un contre l’autre : l’éruption violente contre le récit violent. En cela, le texte est vraiment du côté de l’ “écrire” : il combat le “raconter” et le “dire” en écrivant. J’ai vraiment senti en composant Alphabet à quel point le raconter et le dire participent de la violence. Il devrait y avoir un récit et une parole. Pour moi, la littérature n’est ni du côté du récit, ni du côté de la parole. Elle existe contre.
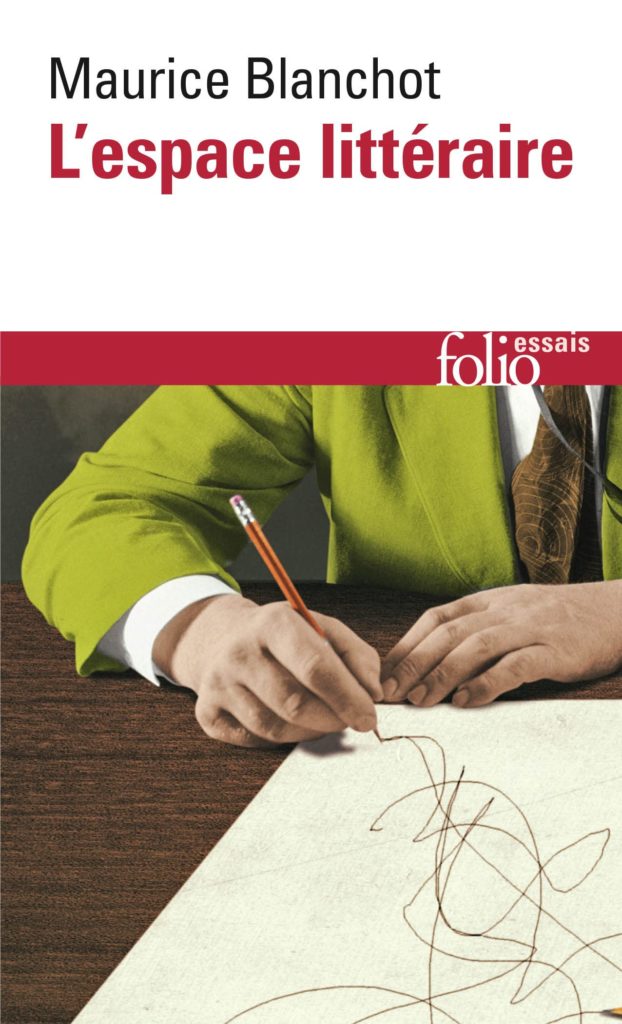
3. Le roman cherche à faire entendre toute la tension présente dans l’acte d’écrire sur l’inceste, pris entre le dire et le non-dire, l’audible et le non-audible. Junon évoque le silence comme pleine écriture. Maurice Blanchot auquel vous faites référence, creuse cette idée du silence dans L’espace littéraire : « Ecrire, c’est se faire l’écho de ce qui ne peut cesser de parler, – et, à cause de cela, pour en devenir l’écho, je dois d’une certaine manière lui imposer silence. J’apporte à cette parole incessante la décision, l’autorité de mon silence propre. Je rends sensible, par ma médiation silencieuse, l’affirmation ininterrompue, le murmure géant sur lequel le langage en s’ouvrant devient image, devient imaginaire, profondeur parlante, indistincte plénitude qui est vide. Ce silence a sa source dans l’effacement auquel celui qui écrit est invité. » En écrivant sur l’inceste, en quoi le silence s’impose-t-il, comme une sorte d’alphabet autant originel et archaïque que final et ultime ?
Cette citation de M. Blanchot est sublime. L’étymologie du mot “silence” l’apparente à situs, “placé, posé”. Le silence est affaire d’espace. Le silence est une rupture. Il est à la fois la destruction de la parole, et sa recréation. Quand un silence rompt une phrase, la phrase reprend dans un nouveau souffle : les mots qui suivent abritent une dimension nouvelle. Comme s’ils étaient prononcés par une autre voix.
Habiter le silence, c’est écouter les mots des autres en écho.
Justine Bo
Les silences s’apparentent aux hiatus de la matière dans une sculpture, par exemple. Je suis d’accord avec M. Blanchot quand il exprime cette idée d’habiter le silence. Je veux dire que c’est quelque chose que je vis au quotidien. J’habite le silence. Quelqu’un qui écrit n’est pas dans la parole. Nous n’avons pas de statut, pas de position sociale — si ce n’est à rebours de la société, en marge. Cette absence est précieuse. Habiter le silence, c’est écouter les mots des autres en écho. Les mots des autres, décuplés, nous parviennent avec plus de force. On ne fait pas que les entendre, on les dissèque. On écrit par les autres depuis notre silence.
Le silence est le plus beau défi littéraire. Il exige de creuser un langage dans le langage.
Justine Bo
En écrivant Alphabet, j’ai compris que le récit familial, et au fond tout récit, n’est qu’une exploration du manque. Un récit par le silence. Un récit par la négation, par suppression. D’où le caractère scandaleux, subversif, inacceptable de l’écriture : l’écrivain est le vandale de la famille, le saccageur, le destructeur, et il est à cette place a priori, il est honni a priori parce qu’on sent en lui la menace de destruction de ce récit silencieux. Par les mots, il va révéler l’édifice. Or ici, je devais à la fois écrire contre et par le silence. Le silence est le plus beau défi littéraire. Il exige de creuser un langage dans le langage. D’où ce recours aux signes, aux sonorités, aux perceptions. Écrire par le silence ne peut s’opérer que dans la poésie.

4. Lorsque le personnage de Junon tente de dire le réel, les violences subies de la part de Yorgos, elle ne semble pas entendue. Dire ne suffit donc pas. Toute la difficulté ne vient-elle donc pas d’être entendue ?
Absolument. Et c’est, je crois, pire que cela : les modalités de l’écoute n’existent pas. L’acte violent rend immédiatement impossible et l’écoute et la parole. Cette dernière ne peut être émise qu’à l’intérieur du cercle — pour ne pas dire “système” — qui a mis en place les conditions d’avènement de l’acte violent. Or, pourquoi s’ouvrir d’une douleur auprès de ses bourreaux ? La famille est à la racine de la société. Quand l’acte violent intervient au sein de la famille, on sait tout de suite que le reste de la société, qui repose sur les mêmes fondements, ne pourra entendre la parole qu’à la condition de maintenir intacts ces fondements. C’est mon expérience : la parole s’inscrit dans l’espace même qui a généré de la douleur. Exprimée, elle se condamne à l’échec, puisque ne pouvant être entendue que par des gens qui, par leur indifférence ou leur réaction, l’utiliseront pour maintenir l’ordre des choses. Le silence, lui, rompt ce cercle vicieux. Bien sûr, on peut le pervertir, le traiter avec suspicion, justifier par lui son ignorance. Mais seul le silence a le pouvoir de déstabiliser cet ordre des choses. Parler ne sert à rien. Écrire, si.
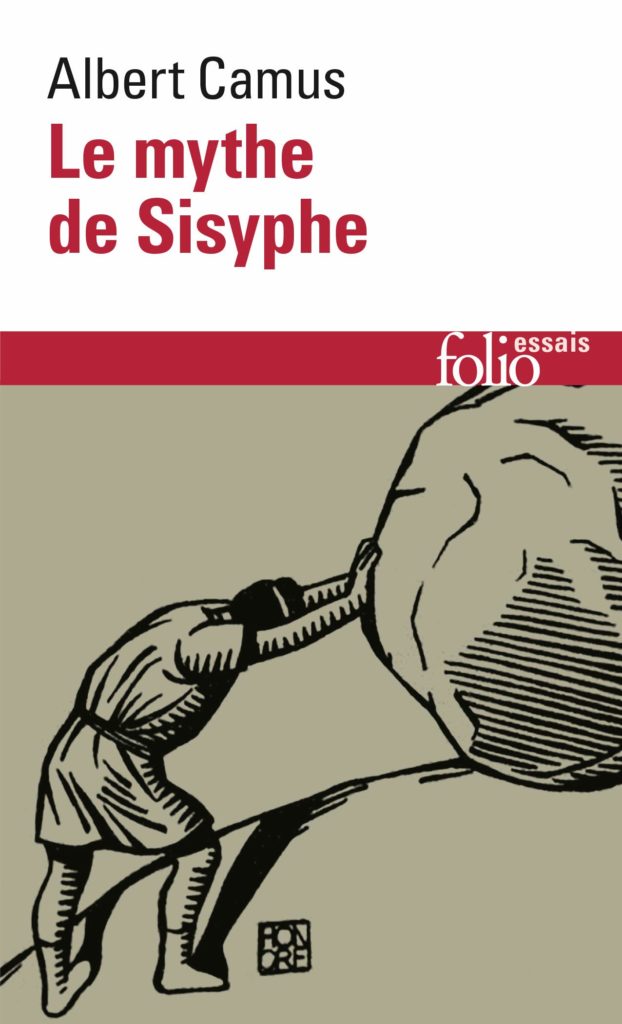
5. Vous faites référence au mythe de Sisyphe dans Alphabet, pour désigner le travail impossible de Junon. Dans Le mythe de Sisyphe, Albert Camus interrogeait le geste de Sisyphe : « On a compris déjà que Sisyphe est le héros absurde. Il l’est autant par ses passions que par son tourment. […] Tout au bout de ce long effort mesuré par l’espace sans ciel et le temps sans profondeur, le but est atteint. Sisyphe regarde alors la pierre dévaler en quelques instants vers ce monde inférieur d’où il faudra la remonter vers les sommets. Il redescend dans la plaine. C’est pendant ce retour, cette pause, que Sisyphe m’intéresse. […] Cette heure qui est comme une respiration et qui revient aussi sûrement que son malheur, cette heure est celle de la conscience. » Cherchez-vous aussi à saisir cet instant de la conscience, « cette heure qui est comme une respiration » ? L’écriture est-elle pareille à cette respiration à reconquérir perpétuellement ?
Une amie m’a confié récemment ses impressions de lecture quant à Alphabet, et je ne peux mieux répondre à cette question qu’en la citant — écrire, m’avait dit un autre ami, c’est se réfugier dans les mots des autres, et il me plaît d’appliquer cette maxime à l’infini dans cet entretien. “C’est un texte sur le fait d’être au monde, écrit depuis les limbes”, disait-elle. Alphabet est un voyage sans cesse recommencé depuis la mort vers le monde des vivants.
Quand on finit un texte, l’accomplissement se confond avec l’échec : tout reste encore à écrire.
Justine Bo
Il y avait, consciemment et inconsciemment, l’idée d’un écrit de l’inframonde. Je marchais tous les jours dans le cimetière du Père Lachaise, dont l’entrée est à quelques mètres de mon appartement. Je descendais la colline sur laquelle il est construit, et la gravissais dans l’autre sens pour rentrer chez moi. La référence à Sisyphe n’était pas seulement intellectuelle. Je l’éprouvais physiquement. Ce va et vient perpétuel, qui a donné sa forme au texte, résume le phénomène d’écriture : l’écriture ne cesse de revenir sur elle-même, elle se trahit, se réinvente. Quand on finit un texte, l’accomplissement se confond avec l’échec : tout reste encore à écrire.
6. Dans un documentaire consacré à Pascal Quignard, on voit ce dernier brûler ses manuscrits. Ce qu’il fait systématiquement. « Faire des choses pour pouvoir les détruire », dit-il. Il rappelle ensuite ce mot de l’évêque Rémi à Clovis : « Brûle ce que tu aimes ». On retrouve à plusieurs reprises dans votre roman cette thématique du feu : » Brûler le livre serait la seule voie » ou encore :
« J’ai donné la famille pour cesser de
me consumer »
L’écriture est-elle pour vous le terrain de l’incendie ?
C’est drôle, je ne connaissais pas cette image de P. Quignard brûlant ses manuscrits. Avant même de commencer à écrire, je me souviens avoir brûlé un livre dans le grenier de mes parents — je devais avoir seize ans. J’imagine que dans mon esprit, la littérature a toujours été le terrain de la destruction, mais de la destruction en train de se faire, un feu ininterrompu dont ne nous parviennent que les cendres. D’où le caractère dangereux, terrifiant, menaçant, subversif de l’écriture, dont on ne peut se saisir qu’en se brûlant les mains.
Écrire, c’est prendre feu.
Justine Bo
Écrire, c’est d’abord faire table rase, opérer à l’intérieur de soi une politique de la terre brûlée pour semer son propre langage. Écrire, c’est prendre feu. Ce n’est sans doute pas un hasard si le mode de destruction favori des ennemis du livre est l’autodafé. Il s’agit de retourner le pouvoir de la littérature contre elle.
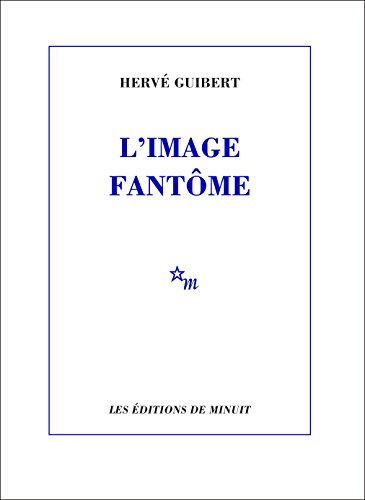
7. Il est question à plusieurs reprises de photographies, convoquant la figure fantomatique d’Hervé Guibert lequel écrivait dans L’image fantôme la chose suivante : « Donc ce texte n’aura pas d’illustration, qu’une amorce de pellicule vierge. Et le texte n’aurait pas été si l’image avait été prise. L’image serait là devant moi, probablement encadrée, parfaite et fausse, irréelle, plus encore qu’une photo de jeunesse : la preuve, le délit d’une pratique presque diabolique. Plus qu’un tour de passe-passe. Car ce texte est le désespoir de l’image, et pire qu’une image floue ou voilée : une image fantôme. » En quoi votre texte est-il habité par des spectres visuels ?
C’est drôle que vous ayez pensé à H. Guibert, que je ne connaissais qu’en surface jusque très récemment, et dont j’ai découvert le travail en écrivant ce livre. Enfant, je passais des heures, des jours entiers à ausculter les photographies de famille. Chaque fois que j’allais chez ma grand-mère, je sortais tous les cartons d’images des placards — je savais exactement où chaque boîte était rangée, à quelle période elle correspondait. La plupart du temps, je ne connaissais pas les visages. Les gens “immortalisés” avaient depuis longtemps disparu. Les lieux me paraissaient très lointains. Le lien ne venait pas pour moi de la famille, mais de la matière que je tenais entre mes mains. Je me noyais dans ce noir et blanc minéral. La texture m’hypnotisait.
Les images surgissent par le chaos du souvenir : les objets du passé s’invitent dans le présent, les sensations lointaines imprègnent le quotidien.
Justine Bo
J’aimais aussi observer les visages de mes parents enfants. J’ai mesuré très tôt à quel point ils avaient eu une vie avant moi, que ma vie n’était pas une continuation de la leur, parce que je détenais entre mes doigts la preuve matérielle de tous ces instants où je n’existais pas. Ils me paraissaient toujours plus jeunes que moi. Contempler les photographies, c’était renverser le temps. C’était instaurer à la fois de la proximité et de la distance. Apprendre l’altérité. Le texte est habité par cette initiation aux images, à partir d’une “image manquante”, pour reprendre le titre d’un ouvrage de R. Panh et C. Bataille. Les images surgissent par le chaos du souvenir : les objets du passé s’invitent dans le présent, les sensations lointaines imprègnent le quotidien.
Comme si c’était la photographie qui donnait son contenu à la vie, et non la vie qui emplissait par l’objectif de la caméra le petit carré de papier censé la condenser. Comme si, sans son reflet dans le miroir, un visage n’existait pas.
Justine Bo
Il existe un autre passage de H. Guibert au sujet de la photographie, qui m’a beaucoup marquée. Il explique qu’un jour, il avait pris en photo sa mère, dont il admirait les airs d’actrice. Mais le visage de sa mère n’est pas apparu. Il décrit cet instant comme celui d’un désespoir terrible. Une petite mort. Par non-apparition, non-révélation photographique. Comme si c’était la photographie qui donnait son contenu à la vie, et non la vie qui emplissait par l’objectif de la caméra le petit carré de papier censé la condenser. Comme si, sans son reflet dans le miroir, un visage n’existait pas. Il faut dire aussi que cette évocation résonne de façon concrète avec mon propre rapport à la photographie. J’aime beaucoup la photographie instantanée. Mais j’ai la peau très blanche. Souvent, quand on me prend en photo avec un Polaroïd, le vertige de l’attente qui sépare la capture de la révélation se charge de cette tristesse décrite par H. Guibert : mon visage n’apparaît pas. On distingue seulement un halo blanc avec, dans le meilleur des cas, deux entailles qui ressembleraient à des yeux : une créature vaguement humaine, probablement pas vivante. Bref, photographiquement, je suis un zombie. Je vous envoie quelques images qui attesteront de ma totale transparence dans la réponse à cette question.

8. À la lecture d’Alphabet, on est traversé par toute une mythologie propre aux noms de personnages et aux lieux invoqués dont forcément la Grèce qui apparait comme une sorte de lieu rêvé et purement fantasmé. Comme une sorte de fantasme mythologique de cinéma, un peu à la manière de deux films d’Alain Resnais centré tous deux sur la mémoire traumatique d’un lieu et d’un évènement : Hiroshima mon amour et L’année dernière à Marienbad. On y pense à l’occasion de ce passage quand Junon s’exprime sur la Grèce, une sorte de lieu entre Hiroshima et Marienbad : « J’ignore tout de la Grèce, elle est mon unique connaissance. Je n’ai jamais vu la Grèce mais je n’ai vécu que là-bas, je n’ai marché que dans ses ruines. Je ne sais rien de la Grèce, j’en sais tout, je ne sais que ça, une barbarie que je nourris avec fièvre depuis vingt-sept ans ». Puis elle termine un des chapitres par les mots suivants : sur les cartes, la Grèce s’anamorphose. On ne remarque plus que
son absence. »
Il n’y a rien qui m’intéresse plus au cinéma que le fantasme. C’est au-delà du souvenir : un instant dont on se souvient comme ayant pu exister, dont on garde une empreinte, mais qu’on ne peut partager avec personne. Le souvenir de ce qui n’existera jamais, n’aura jamais existé. Le cinéma de A. Resnais m’inspire beaucoup sur ce point. Ce passage, qui évoque une Grèce intérieure, mais une Grèce inconnue — recrée par le folklore et la mythologie — est très clairement guidé par la scansion “Tu n’as rien vu à Hiroshima”, issue du scénario de M. Duras pour A. Resnais. Ces évocations me rappellent aussi le travelling célèbre de M. Loridan marchant sur la Place de la Concorde, dans Chroniques d’un été. Elle s’adresse à son père disparu dans les camps : “Je suis revenue, tu es resté”. C’est cette sensation de la perte, inhérente au fantasme, qui a irrigué mon écriture. Le réel n’existait plus. Il fallait chercher ailleurs. Et songer aux Années d’A. Ernaux : “Toutes les images disparaîtront. (…) Ce sera le silence et aucun mot pour le dire”.

9. Le roman cherche à saisir le langage jusqu’à ses derniers retranchements travaillant autant sur l’ouverture que sur sa finalité. Chaque chapitre comporte un certain nombre de paragraphes, où les derniers mots du paragraphe sont écrits en italiques et sont placés en dessous à gauche. Cela vous permet-il, à la manière d’une musicienne ou d’une photographe, de voir et d’entendre la langue et de la saisir autrement, laissant ainsi une absence dans la phrase pour jouer sur les interstices ?
Curieusement, cette forme, qui place en exergue des mots ou des expressions à gauche ou à droite, est venue très tard dans la rédaction du texte. Pourtant, c’était son mouvement depuis le début. Un mouvement de chute. Un mouvement de poésie, selon ce procédé par lequel les poèmes en vers envoient à la ligne un mot essentiel. Je m’en rends compte a posteriori, c’est la structure même du poème de H. Michaux qui a dicté la structure du texte, que j’ai pourtant cherchée, sculptée, effacée, reprise. C’est-à-dire que j’ai voulu écrire par le mouvement, par le chaos : un peu comme quand on apprend à lire et à écrire, que les lettres ne sont encore que des signes et des sons dont le sens n’est pas dicté par la leçon mais par la sensation.
J’ai voulu écrire par le mouvement, par le chaos : un peu comme quand on apprend à lire et à écrire, que les lettres ne sont encore que des signes et des sons dont le sens n’est pas dicté par la leçon mais par la sensation.
Justine Bo
D’ailleurs, je relate au début du roman un rêve confié par un ami. Il avait rêvé que je lui donnais un texte à lire, mais que je ne savais pas lire, et que je déchiffrais ce texte devant lui comme un enfant qui apprend tout juste à lire. Il est très peu question de l’écriture en tant que telle dans le livre, mais il n’est question que de ça. La seule occurrence claire à mon travail d’écrivain est celle-ci : “écrire, c’est faire violence.” Se faire violence et faire violence à l’autre. “Une violence à côté de la violence.” C’est-à-dire une violence qui ne reproduit pas le langage de la violence, mais qui en crée un autre. Ces interstices traduisent le mouvement du texte. Son ressac.

10. Chaque chapitre (ils sont au nombre de vingt-trois) comprend un titre, tel que « le versant ouvert de la vie », « isthmes », « les métamorphoses », « le mythe d’Europe » ou encore « faire parler les morts ». Sont-ils autant des vecteurs de pensées, des termes poétiques et magiques que des points sur la carte d’un livre à la recherche de sa destination ? Sont-ils les longitudes et les latitudes pour dire l’exil d’un corps, celui de Junon ?
C’est intéressant que vous parliez de longitudes et de latitudes. À un moment de l’écriture, j’avais pensé structurer le texte uniquement à partir des espaces. Dans Si nous ne brûlons pas, l’un de mes ouvrages précédents, les coordonnées géographiques des lieux arpentés étaient d’ailleurs indiquées en tête de paragraphe, ainsi que des teintes, des heures, des ciels. À chaque nouveau texte, je crois que je cherche à la fois à m’inscrire dans et à combattre les espaces. L’exil est un mot très juste. On pourrait dire que l’écriture est une quête d’exil. Dans Alphabet, Junon sort en permanence de son propre corps, elle se sent en exil à l’intérieur de son propre corps. Elle est dédoublée, voire démultipliée. D’où, parfois, l’usage de la troisième personne pour se dire elle-même : on ne coïncide pas toujours avec son je — c’est le fameux “je est un autre” de A. Rimbaud.
11. Chacun de ces chapitres comprend aussi une date, créant de nombreux allers-retours dans une chronologie éclatée qui tend des origines mythologiques à nos jours, jouant ainsi sur différentes temporalités. « Je m’attelle à l’écriture du texte. Je tente d’établir une chronologie. Une chronologie de l’inceste. Non pas fragmentaire ou alternante mais relevant du chaos. » Ces dates permettent-elles d’inscrire ces évènements dans une chronologie du dire et du penser ?
Il fallait offrir de la clarté. Le texte, composé d’impressions, d’associations, d’échos, ne pouvait pas s’inscrire dans une chronologie stricte. Je voulais dépasser la forme du fragment sans adopter celle du récit. Il était impensable de verser dans le compte-rendu du type “quand j’avais cinq ans…” Le temps n’est ici qu’une modalité du souvenir : ce qui importe, c’est le surgissement du souvenir.
Personne ne peut remettre les choses dans l’ordre.
Justine Bo
En plaçant les années dans les titres des chapitres, il me semble que je les rends obsolètes, im-pertinentes : le temps n’est pas linéaire. D’ailleurs, les plages temporelles sont parfois très larges. Junon ne cesse de répéter “Je devais assurer la continuité du récit”. Cette litanie est devenue presque ironique pour moi. “Remettre les choses dans l’ordre” est un vœux pieux, un aveu d’impuissance. Personne ne peut remettre les choses dans l’ordre.

12. D’après ma lecture, votre roman convoque implicitement deux figures philosophiques de la french theory. Tout d’abord Derrida avec la notion de « pharmakos » qui renvoie à la notion de « pharmakon » cher au philosophe de La différance. Ce terme de « pharmakon » se traduit autant comme le poison et le remède. Teuth était accusé par le roi Thamous de faire passer l’écriture pour un remède alors qu’elle était selon lui un poison. Quand la traduction cherche à conférer à ce mot un seul sens, il dissimule son ambivalence et son être double. L’écriture pour vous est-elle donc le lieu de l’inquiétude et de l’ambivalence ?
L’écriture est le dialogue impossible de la vie et de la mort. Cette notion de pharmakós contient, comme vous le rappelez justement, cette ambivalence. Le pharmakós, c’était aussi l’individu sacrifié dans la Grèce antique, l’être qu’on mettait à mort au nom de l’harmonie sociale. Cette dimension fait écho pour moi à la dimension sacrificielle de l’écriture.
13. On trouve quelques pages plus loin la référence à un tableau, L’Extraction de la pierre de folie, que Junon décrit alors qu’elle visite le Prado à Madrid. Il est aussi question de la peinture Le jardin des délices de Bosch. Peut-on considérer L’Extraction de la pierre de folie comme un tableau incarnant une coupure entre le voir et le dire, appelant comme c’est dit dans le roman à « une image vide » ?
J’étais à Madrid dans un moment où je cherchais ce texte, dont l’écriture s’est apparentée à une longue déambulation, physique et psychique. Un jour, au musée du Prado, tandis que la foule admirait Le Jardin des délices de J. Bosch, j’ai remarqué cette petite toile que je ne connaissais pas. Ce qu’il y a de très saisissant dans ce tableau, ce sont les regards. C’est ce qu’on apprend à observer en premier lorsqu’on étudie la peinture : qui regarde qui, qui happe le regard en premier, avec cette idée que les yeux des modèles sur les portraits ne quittent jamais le visiteur d’un musée, où qu’il se déplace. Dans ce tableau, les yeux du fou nous fixent. Face à ce regard, j’ai été saisie d’un vertige. Il y a cette idée que la pierre de folie est comme un œil intérieur. La folie n’est pas un anéantissement du monde mais une révélation de sa démence.
J’ai compris, par ce tableau, que mon image manquante n’était pas un vide mais l’image du vide.
Justine Bo
Dans cette perspective, le fou n’est pas un parasite mais un voyant. Il signale quelque chose. Il n’est pas dans le dire des autres, il déplace leur parole. Au lieu de l’écouter, on lui enlève le voir dans l’espoir qu’il ne dise plus, ou qu’il dise à la manière des autres. Cette évidence résonnait avec mon état d’esprit à cette période. Je relisais les écrits d’A. Artaud, dont l’enfermement psychiatrique s’apparentait à de la persécution. J’avais l’impression, parlant de ce texte autour de moi, que la parole des autres s’inscrivait dans une volonté de m’extraire ma propre pierre de folie, ma vision. C’est pour cela aussi que j’écris au début du roman : “Si je filmais l’inceste, je ne filmerais pas le crime mais le silence des gens autour. Pas le champ mais le hors-champ.” J’ai compris, par ce tableau, que mon image manquante n’était pas un vide mais l’image du vide.
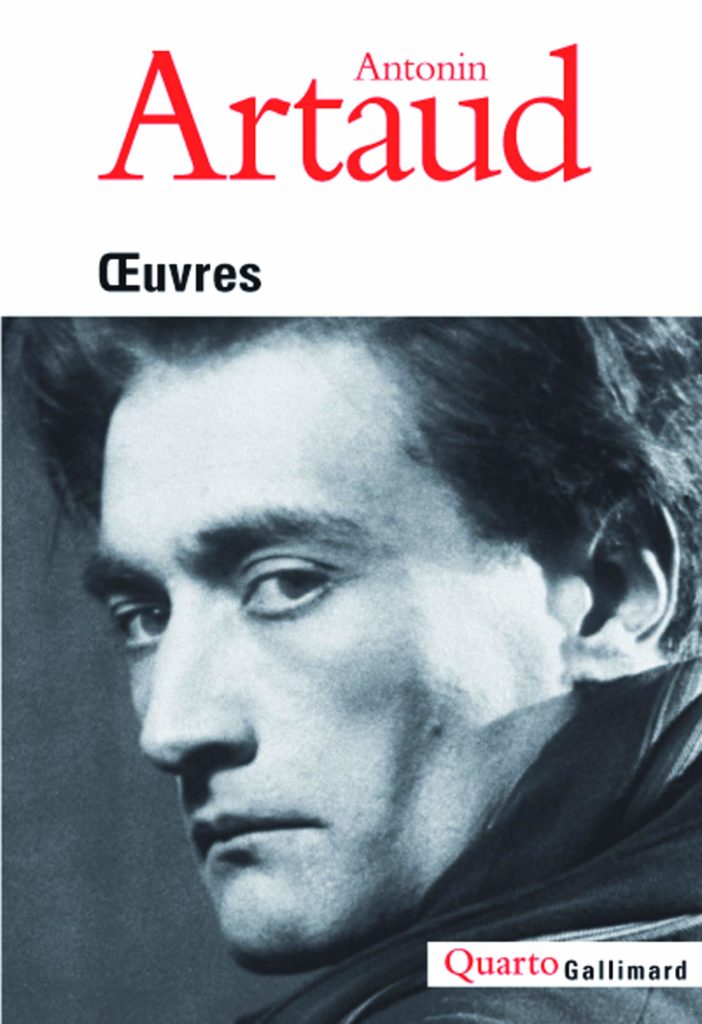
14. Ce roman explore la langue de manière viscérale comme une sorte de convulsion et de battement intérieur, tissant avec le langage un rapport fort et habité. Qu’est-ce qui écrit en vous quand vous écrivez ? Est-ce autant quand vous écrivez que quand vous n’écrivez pas ?
Je ne me disais jamais écrivain auparavant, j’ai commencé à le dire avec ce texte. J’ai compris qu’on ne pouvait plus m’enlever l’écriture — or, on a souvent essayé de le faire. Je n’ai aucune anecdote sur mes écrits d’enfance, aucun souvenir d’avoir jamais tenu un journal ou inventé des histoires — j’ai toujours plutôt méprisé ce genre d’exercice, pour une raison que j’ignore sincèrement. Mais je crois que j’ai dû commencer à écrire avant d’écrire. Écrire, pour moi, est une façon d’être au monde. Chaque sensation qui m’envahit inscrit quelque chose en moi. Tout écrit.
Je ne peux pas ne pas écrire.
Justine Bo
Dans Alphabet, je transmets une anecdote de mon enfance, que me racontait souvent ma grand-mère. J’avais quelques mois, je faisais la sieste. Mon grand-père s’est aperçu qu’il avait oublié de me laisser le livre qui ne me quittait jamais. Quand il est entré dans la chambre, j’avais cessé de respirer. C’est un cas de mort subite du nourrisson. Il m’a fait un massage cardiaque, et m’a donné mon livre. Je crois que cette histoire traduit assez bien mon rapport à l’écriture : je ne peux pas ne pas écrire.
Alphabet de Justine Bo aux éditions Grasset