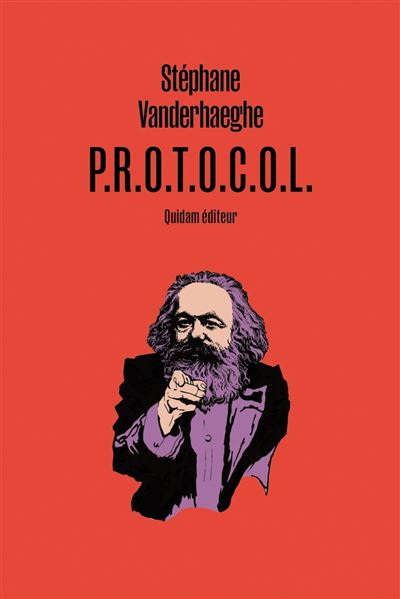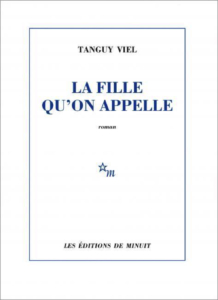Découvrez l’Abécédaire de Stéphane Vanderhaeghe, à l’occasion de la parution de son troisième roman, P.R.O.T.O.C.O.L, le 3 février aux éditions Quidam. Chaque lettre du titre de son roman P.R.O.T.O.C.O.L correspond à une entrée thématique. Commençons avec la lettre p comme politique.

1. Ton nouveau roman P.R.O.T.O.C.O.L. s’ouvre sur deux citations, l’une de Günther Anders, l’autre de Michel Foucault. Ces deux auteurs ont-ils joué un rôle dans le travail littéraire ? Sont-ils des penseurs qui t’accompagnent pour penser le politique ?
Ces deux citations disaient des choses, à un moment donné, de ce que représentait pour moi l’écriture de P.R.O.T.O.C.O.L., et elles paraissaient résumer la vision que je me faisais à la fois du roman et de mon travail d’écrivain en général. Elles disaient aussi des choses sur la rupture que ce texte et le travail qui l’accompagnait semblaient constituer avec mes textes précédents. La citation d’Anders, notamment, m’est apparue très tôt comme une façon nécessaire, ou impérative, non seulement de lancer le texte, mais de trouver une légitimation à le faire et à l’écrire ; celle de Foucault est arrivée plus tardivement, et m’a intéressé dans la mesure où elle résonnait avec un autre pan, ou une autre « politique » du texte. Prises ensemble, ces deux citations semblaient ainsi ouvrir un espace au sein duquel l’écriture pouvait se mouvoir, comme d’un pôle à un autre d’un même questionnement. Pour autant, ni Foucault ni Anders ne sont des auteurs que j’ai beaucoup fréquentés et leur influence, si elle existe – j’enseigne dans une université dont l’organisation des locaux n’est pas sans rappeler le panoptique… –, est sans doute marginale ou flottante.
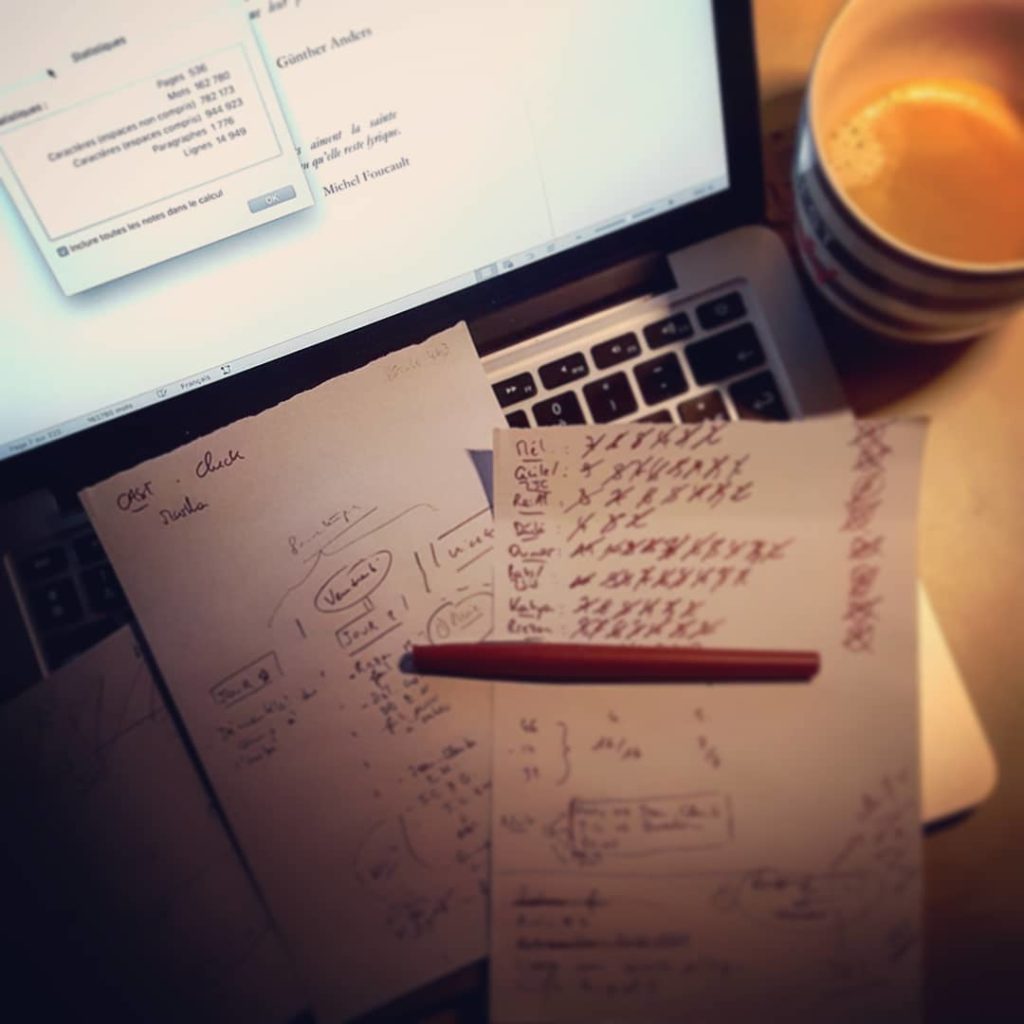
2. Ce roman P.R.O.T.O.C.O.L. met en scène une société qui implose et qui surveille. Dans un cours intitulé Qu’est-ce que l’acte de création?, Gilles Deleuze évoquait les sociétés de contrôle : « […] c’est vrai que nous entrons dans une société que l’on peut appeler une société de contrôle. Vous savez, un penseur comme Michel Foucault avait analysé deux types de société assez rapprochées de nous. Les unes qu’il appelait des sociétés de souverainetés, et puis les autres qu’il appelait des sociétés disciplinaires.[…] Bien sûr, il y a toutes sortes de restes de sociétés disciplinaires, et pour des années et des années, mais nous savons déjà que nous sommes dans des sociétés d’un autre type, qui sont, qu’il faudrait appeler, c’est Burroughs qui prononçait le mot, — et Foucault avait une très vive admiration pour Burroughs, — Burroughs proposait le nom de, le nom très simple [sociétés] de contrôle. Nous entrons dans des sociétés de contrôle qui se définissent très différemment des disciplines ». En quoi la société décrite dans ton roman s’apparente pleinement à cette société de contrôle ? Est-ce utopique de vouloir en sortir ?
Je commencerai par répondre à la deuxième question : est-ce utopique de vouloir en sortir ? Il se trouve que c’est précisément la question qui s’est posée, plus ou moins sous cette forme et dans ces termes, à l’origine du projet, et c’est elle qui a peu à peu aiguillé l’écriture du roman. L’utopie, par définition, est déjà en soi une sortie, littéralement un non-lieu, ou l’invention d’un ailleurs. Une fiction, en somme. Se demander, donc, si cette sortie du monde dans lequel nous vivons, si ce retrait en dehors d’une société de contrôle ou de surveillance comme celle décrite dans le roman, est utopique, revient d’emblée à dire que cette sortie est en soi impossible : on n’en sort pas, ou pour le dire autrement, la seule sortie envisageable serait dans et par l’utopie – un terme qui s’entend (et que j’entends, dans la question qui est ici posée) comme purement illusoire ; et là est sans doute le problème principal. En tirant sur la corde, on pourrait dire en fin de compte que la seule sortie ou le seul répit serait la fiction.
L’un des enjeux de ce roman, pour moi, sur le plan littéraire et générique, était précisément de refuser l’utopie – ou son envers, la dystopie.
Stéphane Vanderhaeghe
Le texte a été commencé véritablement en 2017, sur fond de campagne électorale et de brouhaha politique, où derrière les mots et les habillages rhétoriques, l’impression prévalait d’une éternelle redite. Et la question s’est posée – et se reposera encore cette année –, non pas de savoir comment, mais si on pouvait se sortir de ce système qui, en surface, n’a plus de politique que le nom. Les élections ne sont le plus souvent guère plus qu’une mascarade, au cours de laquelle on appelle au « vote utile », par exemple, ce qui constitue un déni de démocratie assez remarquable… Cela dit, l’un des enjeux de ce roman, pour moi, sur le plan littéraire et générique, était précisément de refuser l’utopie – ou son envers, la dystopie ; ce qui revient au même – pour décrire plutôt un monde qui, s’il n’est pas tout à fait le nôtre, n’est pas non plus tout à fait différent, comme une sorte de décalque, un léger décalage – mais pas un saut franc dans l’ailleurs ou l’autre. Quant à la première partie de la question, je laisse le soin aux lecteurs et lectrices d’y répondre, mais il est indéniable que les « marges » du monde décrit par le livre ont été grignotées une à une, et il y a là-dedans un aspect qui, s’il n’est pas totalitaire, se veut totalisant.

3. Tout grand roman est-il politique ? Peut-on dire que ton roman est politique ? comment comprends-tu ce terme de politique ?
Je me méfie des généralisations mais je crois que la littérature, aujourd’hui plus que jamais, est un geste politique, oui – et bien au-delà du seul roman. Mais c’est, au regard du monde qui nous entoure, une politique bien futile sans doute, car je ne crois pas qu’un roman ou qu’un recueil de poèmes puisse agir directement sur le monde. Un des personnages de P.R.O.T.O.C.O.L., d’ailleurs, propose en creux cette notion de futilité comme la raison d’être de toute pratique artistique. C’est une position que j’avais eu tendance à vouloir défendre moi-même, d’ailleurs, au sujet de mes deux premiers textes, comme pour tenter de justifier une esthétique plus ludique et nettement moins (voire pas du tout) en prise sur le réel immédiat. De ce point de vue, je ne crois pas que P.R.O.T.O.C.O.L. soit plus politique que les deux romans l’ayant précédé. Mais son contenu, son matériau, contrairement aux deux autres, est plus explicitement politique, c’est indéniable.
Je me méfie des généralisations mais je crois que la littérature, aujourd’hui plus que jamais, est un geste politique, oui – et bien au-delà du seul roman.
Stéphane Vanderhaeghe
Indépendamment du contenu ou du « sujet », l’écriture est en soi une prise de parole – timide chez certains, grandiloquente pour d’autres –, la tentative, à une échelle ridicule et inefficace, de faire entendre une voix, d’émettre un son dans le brouhaha ambiant, un chant, une musique. Dans une société comme la nôtre, qui prône le rendement, la vitesse, la rotation des stocks, j’ai tendance à entrevoir la littérature comme une sorte de contre-discours ; pas nécessairement un discours contre quelque chose, mais une façon de retourner les logiques discursives qui nous entourent, d’enrayer les discours, ou le discours de façon générale, c’est-à-dire une langue mise au service de, visant des fins, quelles qu’elles soient : politiques, commerciales, scientifiques, idéologiques… Le risque – et très honnêtement j’ignore si je suis parvenu à l’éloigner –, avec un sujet – au sens large, je serais bien en peine de le définir précisément –, le risque donc pour P.R.O.T.O.C.O.L., c’est que le matériau politique du texte le fasse retomber dans du discours, c’est-à-dire arrête et fige des positions, produise, involontairement, du sens qui soit réifié, se laisse rattraper par des logiques utilitaristes ou productivistes. Que le roman ignore, en somme, sa part de fiction. C’est-à-dire – je reviens à la question précédente –, non pas sa part, ou sa tentative de sortie à proprement parler, mais plutôt d’ouverture, de déverrouillage, de déplacement, de mise en mouvement, en fuite…
4. Le roman P.R.O.T.O.C.O.L. nous fait entendre différentes voix, chacune renvoyant à des parcours très différents. Par cette construction chorale où s’entremêlent toutes les voix de ces personnages, le roman se fait-il l’écho de la complexité et de la multiplicité des violences politiques ?
Initialement, le roman devait s’en tenir à une seule voix ; je l’imaginais porté par un seul souffle. Mais très vite cette option s’est révélée trop restrictive, elle laissait trop peu de place à d’autres problématiques qui venaient se greffer sur la ligne principale du récit. J’ai donc décidé après quelques mois d’écriture d’ouvrir le roman à d’autres voix, qui sont aussi et surtout d’autres perspectives, d’autres regards, d’autres façons d’appréhender le monde, d’autres langages tournant autour d’une seule et même question centrale. Dans la mesure où, contrairement aux romans qui l’ont précédé, P.R.O.T.O.C.O.L. venait se heurter frontalement au réel – ou à une certaine réalité disons –, il m’a paru souhaitable d’élargir au maximum l’angle de vue, pour mieux réfracter la complexité de ce réel, le segmenter afin de l’habiter diversement.
C’est, il me semble, quelque chose que la littérature, et le roman en particulier, peuvent et savent faire : saisir, incarner la complexité, refuser la simplification – ou l’alignement des points de vue, leur rattachement à une ligne, et une seule.
Stéphane Vanderhaeghe
C’est là que tous ces personnages se sont invités, chacun avec sa propre histoire, trouvant sa propre place au sein d’un système qu’ils ou elles exploitent ou cherchent à fuir, à enrayer. Ce qui a permis, il me semble, d’introduire de la dissonance et accessoirement de renvoyer le roman à ses origines polyphoniques, pour juxtaposer, ou faire se heurter, ou dialoguer les points de vue. Il en résulte un roman radicalement différent de celui que j’avais entrevu au départ, plus monologique, et s’il apparaît complexe, dans le brassage des points de vue qu’il implique, il l’est aussi parce que le réel auquel il se frotte l’est, en effet. Et c’est peut-être ce qui nous fait le plus défaut, ces temps-ci : l’acceptation de cette complexité, la prise en compte de la multiplicité des points de vue sans pour autant chercher à gommer le dissensus ou la dissonance. Et c’est, il me semble, quelque chose que la littérature, et le roman en particulier, peuvent et savent faire : saisir, incarner la complexité, refuser la simplification – ou l’alignement des points de vue, leur rattachement à une ligne, et une seule.
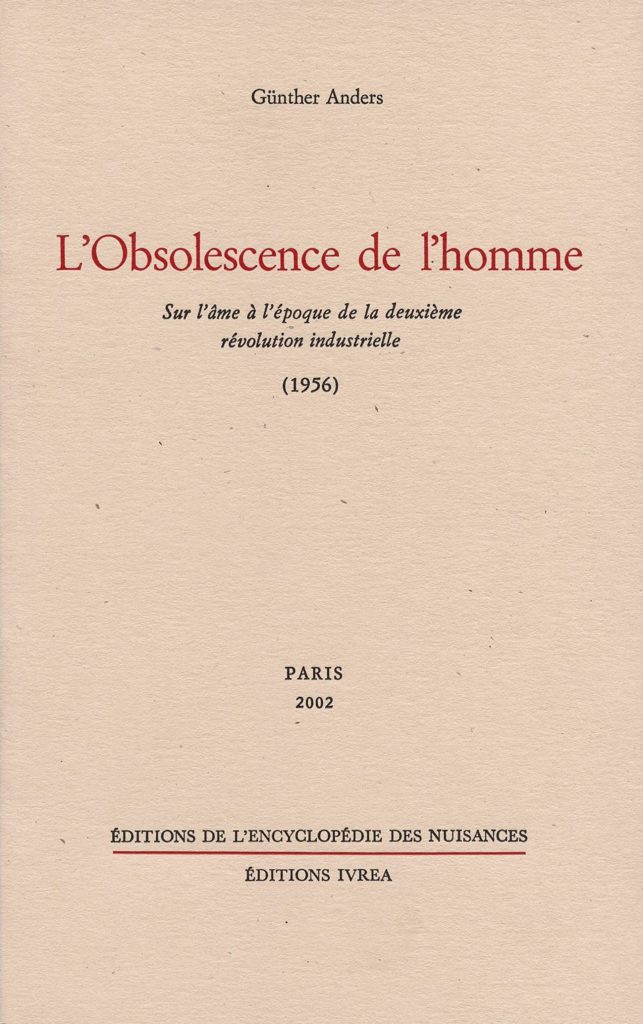
5. Dans L’obsolescence de l’homme, Günter Anders saisissait toute la problématique du monde contemporain : « Il ne suffit pas de changer le monde. Nous le changeons de toute façon. Il change même considérablement sans notre intervention. Nous devons aussi interpréter ce changement pour pouvoir le changer à son tour. Afin que le monde ne continue pas ainsi à changer sans nous. Et que nous ne nous retrouvions pas à la fin dans un monde sans hommes. […] Nous vivons dans un monde distancié, mais nous avons le sentiment, en tant que consommateurs de films, de radio ou de télévision (mais pas seulement en tant que tels), de nous trouver avec tout, absolument tout – les hommes, les régions, les situations, les événements, et surtout les étrangers -, sur un même pied d’intimité. » Tes personnages dans le roman P.R.O.T.O.C.O.L changent-ils le monde ou sont-ils changés par lui ?
Les personnages de P.R.O.T.O.C.O.L., comme je viens de le dire, incarnent des modes différents d’appréhension de la réalité qui les entoure : certains cherchent délibérément à changer le monde, en reconnaissant parfois la futilité de l’entreprise (c’est le cas de Re:Al, par exemple), là où d’autres sont contents de l’accepter tel qu’il est, et l’exploitent jusque dans ses plus intimes contradictions (je pense à un personnage comme Katya notamment).
Disons que P.R.O.T.O.C.O.L. chercherait, à sa façon, à soulever cette question du changement – de monde, ou de modèle, ou de paradigme – en partant du constat qu’il est impossible.
Stéphane Vanderhaeghe
Ma lecture de L’Obsolescence de l’homme est trop lointaine pour que je puisse commenter cette citation d’Anders. Ce que je peux tenter d’en dire, c’est qu’aujourd’hui cette citation me paraît bien optimiste : je ne suis pas sûr que nous soyons encore en mesure de « changer le monde » au sens où Anders l’entend. Le changement semble se faire dans un sens inéluctable, dorénavant, et ce qui fait défaut – mais je suis mal à l’aise pour parler de ça, car ça déborde largement le cadre de la littérature, au-delà duquel je n’ai aucune expertise. Mais disons que P.R.O.T.O.C.O.L. chercherait, à sa façon, à soulever cette question du changement – de monde, ou de modèle, ou de paradigme – en partant du constat qu’il est impossible ; que le « système » est à ce point totalisant qu’on ne peut plus en sortir ; ou qu’en sortir, c’est encore et toujours jouer le jeu du système. On en revient à la première question, donc. Preuve s’il en est qu’on tourne en rond, ou que je tourne en rond, en l’occurrence, dans ma façon d’aborder cette problématique…
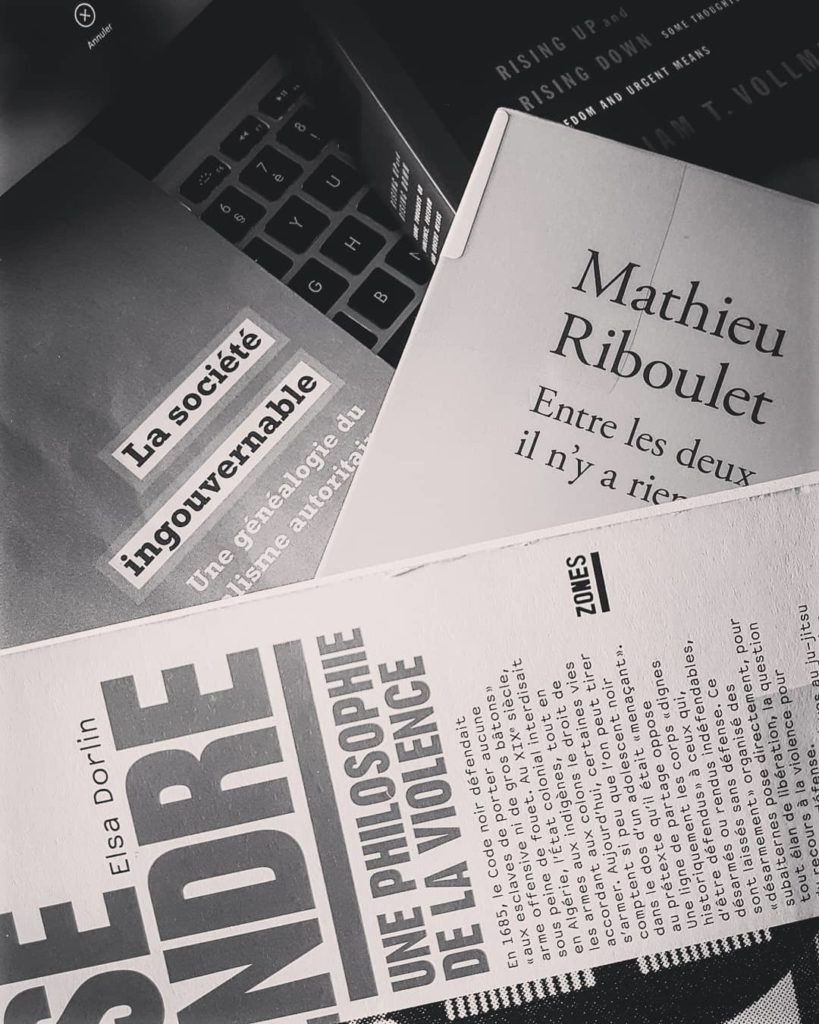
6. A la lecture de P.R.O.T.O.C.O.L., on pense aussi à des romans comme Les furtifs d’Alain Damasio ou Vernon Subutex de Virginie Despentes, qui cherchaient à radiographier les violences sociales et politiques. La littérature fonctionne-elle pour toi comme une sorte de contre-récit, creusant un sillon dans les marges et les langues mineures ?
J’ai sans doute déjà en partie répondu à cette question, mais j’avoue ne pas avoir lu ni Les Furtifs ni Vernon Subutex. Dans la cas de P.R.O.T.O.C.O.L., l’idée n’était pas à proprement parler de cartographier quoi que ce soit – du moins pas au départ, et sûrement pas consciemment –, mais de partir d’une problématique assez précise, quoique paradoxalement nébuleuse (je me comprends !), et de voir quel récit je pouvais en tirer, quelle forme littéraire lui donner, quel(s) langage(s) façonner. « Contre-récit » je ne sais pas ; contre-discours, oui, certainement.
La langue « majeure » n’est pas ou plus une langue dominante et impérialiste (comme l’allemand pour Kafka, ou l’anglais britannique pour les auteurs américains par exemple), mais plutôt, plus généralement, une logique discursive, une machine de guerre rhétorique qui ne dirait pas son nom.
Stéphane Vanderhaeghe
Et cette notion deleuzienne de langue mineure me parle tout particulièrement, même si le contexte dans lequel il théorise cette idée est très différent de celui dans lequel j’écris. La langue « majeure » n’est pas ou plus une langue dominante et impérialiste (comme l’allemand pour Kafka, ou l’anglais britannique pour les auteurs américains par exemple), mais plutôt, plus généralement, une logique discursive, une machine de guerre rhétorique qui ne dirait pas son nom.
P.R.O.T.O.C.O.L. de Stéphane Vanderhaeghe aux éditions Quidam, à paraitre le 3 février.