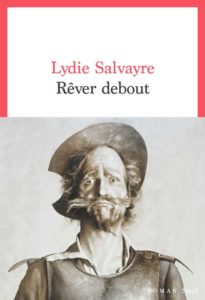Chaque nouveau livre de Lydie Salvayre est l’expression d’une voix singulière et brulante qui explore, tant par ses essais que par ses romans, des voies vers les autres. Son écriture est traversée par la folie des hommes et l’incandescence des artistes. Ses phrases sont emplies d’un cœur battant pour l’autre et en leurs complexités se nichent un feu ardent, celui des poétesses comme Marina Tsvetaieva, des romancières comme Emily Brontë ou des musiciens comme Jimi Hendrix. Dans ses livres se trouve l’humanité désaccordée des passions tristes et joyeuses. En cette rentrée littéraire, deux nouveaux romans paraissent. Le premier, Rêver debout, parait aux éditions du Seuil, réveille en tout lecteur et toute lectrice une joie sauvage et utopique de lire et de relire Cervantès. Le deuxième, Famille, parait aux éditions Tristram, rappelle à quel point l’écriture de Lydie Salvayre possède cette force de vie et de colère.

1. A la suite de livres tels que 7 femmes, Marcher jusqu’au soir ou Hymne, vous continuez de faire entendre votre admiration pour ces artistes qui disent leurs singularités irréductibles avec ce nouveau livre intitulé Rêver debout. A l’instar d’autres artistes qui comptent pour vous, les quinze lettres adressées à l’auteur du Don Quichotte traduisent un échange marqué aussi bien par des accords que par des désaccords. Lire un auteur implique-t-il une relation passionnée et vivante ?
Je l’ai souvent dit, j’aime admirer. C’est en effet mon admiration pour Bernanos qui m’amène à écrire Pas Pleurer. C’est mon admiration pour Blaise Pascal qui m’amène à écrire La Puissance des Mouches. Et c’est l’admiration infinie que je porte aux femmes qui eurent l’audace d’écrire à des époques où l’écriture était la seule propriété des hommes que j’ai écrit 7 Femmes.
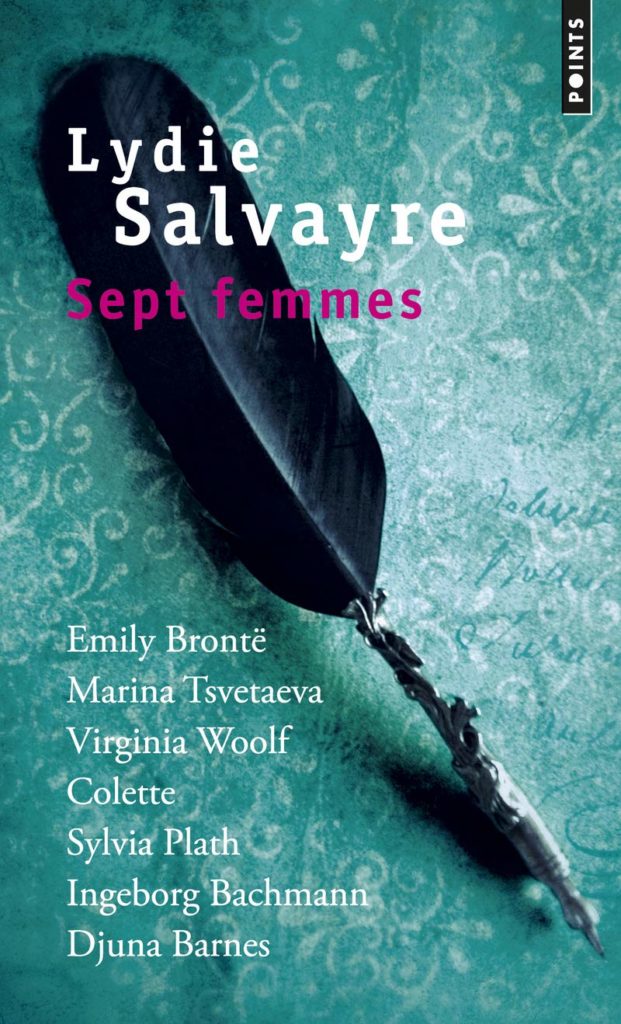
Du reste, je ne comprends bien que les œuvres que j’admire, je ne suis touchée que par elles, je ne suis questionnée que par elles, je n’ai envie de dialoguer qu’avec elles. Mais admirer ne signifie pas s’interdire de penser, de s’interroger, de critiquer. Au contraire. Admirer permet de débattre sans que vienne s’immiscer dans le lien le moindre ressentiment. Quant à ce qui concerne mes colères feintes contre Cervantes, mes désaccords avec lui, mes contestations, mes chicanes, il y a bien sûr une grande part de jeu. Comment imaginer sérieusement que je puisse avoir l’arrogance de disqualifier un écrivain aussi génial que Cervantès ? C’est pour rire, comme disent les enfants. Et peut-être aussi pour prendre le lecteur à revers. Pour l’inquiéter. Pour le secouer.
2. Quand avez-vous découvert l’œuvre de Cervantès ? Le choc a-t-il été immédiat ou l’œuvre a-t-elle sédimenté en vous ?
J’aime beaucoup cette idée de sédimentation, de choses qui se déposent en nous et lentement se transforment et nous transforment. J’ai dû lire pour la première fois L’ingénieux Don Quichotte de la Manche à vingt ans. Je faisais une licence de lettres modernes avec espagnol en option, mais je crois qu’alors, je l’ai lu sans le lire, sans me risquer à le lire vraiment. J’ai entrepris ensuite des études de médecine et de psychiatrie et la question de la folie, telle qu’elle était traitée dans le livre, et telle que le la rencontrais dans la vie, a commencé à me hanter. Le quichotte était-il fou ? Ou simplement incompris ? Parce que trop radical, trop entier, trop absolu, trop singulier, trop différent ? Qui décidait de sa folie ? Qui décidait de la folie des hommes ? Et pour quelles raisons ? Qui du reste était le plus fou : celui qui, à l’instar du Quichotte, libérait les prisonniers de leurs fers ? Ou celui qui inhumainement les enchaînait ? etc. etc. Puis, au moment où nous souffrions du confinement, je me suis souvenue que Le Quichotte, dans le roman de Cervantes, brisait le sien (confinement), s’arrachait à sa bibliothèque et aux romans de chevalerie qui le faisaient rêver, pour s’en aller habiter le monde. J’ai alors lu et relu le livre dans une sorte d’euphorie, et je me suis lancée dans l’écriture.
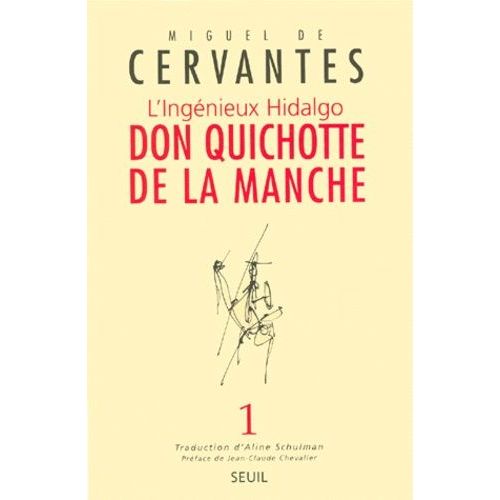
3. A la lecture de Rêver debout, à l’instar de l’ensemble de vos livres, on ressent un besoin impérieux d’écrire. Antonio Lobo Antunes, que vous aviez interviewé sur France Culture exprimait le mystère de la création : « Le livre arrive quand vous sentez que la couleur de l’air a changé, comme quand on tombe amoureux, et le monde commence à s’organiser d’une autre façon, qui n’a rien à voir avec la logique. On ne peut pas rationaliser la logique des émotions, on peut juste essayer de les décrire et d’en faire un livre. » La naissance d’un livre répond-elle à une part inexplicable de soi ?
Oui bien sûr, je vous ai donné là des éléments très raisonnables pour expliquer la genèse de « Rêver Debout ». Mais je crois vraiment que la lecture de L’ingénieux Don Quichotte de la Manche a réactivé, avec la question de la folie, la question du divorce entre nos pensées et nos actes, entre nos idéaux et nos pratiques, entre nos rêves et notre incapacité à les réaliser, qui est vraiment une question qui m’obsède depuis longtemps, et qui a mis, je crois, le feu au processus d’écriture.
Le désir d’utopie ne nous donnerait-il pas, justement, l’élan, le souffle, la force d’explorer des chemins inconnus qui nous manquent aujourd’hui ?
Lydie Salvayre
Il y a aussi, bien sûr, tout ce que j’écris et dont j’ignore le pourquoi. Toutes ces choses confuses en moi que je convertis en phrases, toutes ces choses sauvages que j’essaie d’appréhender et qui se révèlent au fur et à mesure que j’écris, et parfois bien après.
4. Vous conférez à l’œuvre de Cervantès une force politique de subversion. Alberto Manguel le rappelait dans un entretien : « Tout le monde ne comprend pas à quel point Don Quichotte est un texte subversif, une défense des droits fondamentaux de l’individu et un plaidoyer pour la désobéissance civile. Don Quichotte, c’est l’homme qui veut remettre la justice à sa place, en suivant les lois chevaleresques. Pour lui, il faut agir de façon juste dans une société injuste, quel qu’en soit le coût pour vous et pour les autres. Qui a ce courage aujourd’hui ? » Est-ce cela qui rend Cervantès diablement actuel ?
Don Quichotte est un esprit utopique. Il rêve d’un univers enchanté, d’un âge d’or, d’une Arcadie, d’un monde où l’injustice serait bannie, les déshérités protégés, le mépris de classe aboli, les femmes libres et indépendantes… Il rêve d’un monde plus généreux, plus hospitalier, plus musical, et il se bat avec la dernière énergie pour le faire advenir. Et qu’importe qu’il échoue une fois sur deux dans ses batailles pour rédimer le monde, l’expérience de la bataille aura été une richesse en elle-même.
Il me semble qu’il y a, en chacun de nous et à des degrés divers, un Quichotte rêveur et épris d’idéal, et un Sancho qui nous rappelle brutalement nos humaines limites.
Lydie Salvayre
Alors la question pour nous est celle-ci : une telle utopie est-elle aujourd’hui concevable ? Peut-on imaginer encore d’autres façons d’habiter le monde et d’instaurer de nouveaux liens avec le vivant ? Est-ce que, devant l’avenir de désastre qui s’annonce, devant la planète qui brûle, les inégalités qui se creusent, les espèces qui disparaissent, est-ce qu’il n’est pas urgent de faire revivre cet esprit utopique dont on avait annoncé la mort en même temps que la fin de l’Histoire ? Le désir d’utopie ne nous donnerait-il pas, justement, l’élan, le souffle, la force d’explorer des chemins inconnus qui nous manquent aujourd’hui ?

5. Cervantès fait émerger votre héritage espagnol, traduit admirablement dans Pas pleurer. Peut-on dire que ces lettres adressées à Cervantès le sont aussi à votre mère et à sa liberté ?
Cet éloge du Quichotte, est venue j’en suis sûre de cette part en moi d’Espagne héritée de ma mère. Mais ne l’oublions pas, toute la force du livre de Cervantès tient à la présence du duo Le Quichotte-Sancho. Au Quichotte : le courage, l’orgueil, le sens aigu de l’honneur, les grands rêves, la fougue, l’intempestivité, les colères grandioses, la grandeur d’âme et la démesure sur tous les plans. A Sancho : l’esprit terre-à-terre, le goût de la mesure, le respect des limites, le sens des réalités, le désir d’être conforme, la prudence peureuse et parfois même la lâcheté. Tout ce que j’appelle Espagne se trouve dans cette tension entre le désir du Quichotte d’attraper le ciel, de vouloir passionnément l’impossible, et celui de Sancho de dégriser son maître et de l’amener à garder les pieds sur la terre ferme. Mais cette dualité n’est pas qu’espagnole. Il me semble qu’il y a, en chacun de nous et à des degrés divers, un Quichotte rêveur et épris d’idéal, et un Sancho qui nous rappelle brutalement nos humaines limites. C’est la force de ce roman de nous en rendre conscients.
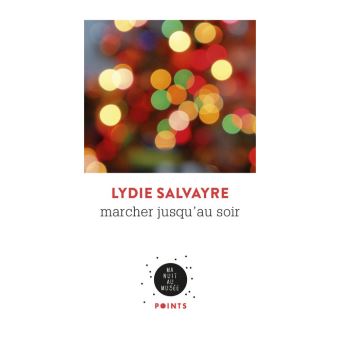
6. Dans Marcher jusqu’au soir, vous exprimiez votre admiration pour Giacometti : « Je nourrissais depuis longtemps une passion pour -L’Homme qui marche- de Giacometti. L’Homme qui marche, que je n’avais jamais vu que reproduit sur du papier glacé, me semblait constituer l’œuvre au monde qui disait le plus justement et de la façon la plus poignante ce qu’il en était de notre condition humaine : notre infinie solitude et notre infinie vulnérabilité, mais, en dépit de celles-ci, notre entêtement à persévérer contre toute raison dans le vivre. » L’art constitue-il pour vous une manière de vivre accompagnée, comme deux solitudes qui arriveraient à communiquer ?
J’avais oublié ce passage, et je découvre grâce à vous qu’il pourrait s’appliquer mot pour mot au Quichotte. Car le Quichotte est seul, infiniment seul, « exilé sur le sol au milieu des huées », et presque toujours en bute à l’incompréhension des autres, sinon à leur hostilité. En même temps : fragile, infiniment fragile, moqué, ridiculisé, bastonné, écharpé, roué de coups par tous ceux qu’il déroute parce que ses gestes échappent aux normes en vigueur. Mais cependant persévérant envers et contre tout dans son projet de mettre son rêve à l’épreuve de la réalité, de l’hybrider à la réalité.
7. Vous faites paraitre à la rentrée littéraire de septembre un autre livre, très court, intitulé Famille, chez Tristram, autour de la violence familiale. Dans le livre Contre, vous énonciez une vision forte de la littérature : « Ne céder pas un pouce à qui vous amenuise. Inventorier vos forces. […] Dites je contre, je contre. Je suis contre. Contre. » Le geste d’écriture trouve-t-il son origine dans le fait décrire contre ? Et contre quoi écrit-on ? Contre les faux semblants ? Contre la comédie familiale ?
Contre les faux semblants, contre la comédie familiale, contre les totalitarismes, contre toute domination… Mais pour le Quichotte, pour Tsvetaieva, pour Woolf, pour Thomas Bernhard, pour Matisse, pour les dingues, pour les arbres, pour les chiens, pour l’enfance des hommes, que sais-je…

Pour ou Contre. L’éloge ou l’injure. Le feu ou la glace. La critique de Cervantès mais pour mieux le grandir. Tout sauf la mollesse, tout sauf la moyenne, tout sauf les bain-marie, la tiédeur, la prudence peureuse, les précautions oratoires, la terreur de déplaire, le désir de ménager la chèvre et le chou.
7. Ce texte intitulé Famille est très bref. A quoi répond cette brièveté ? Le geste d’écriture, dans son exécution, est-il pareil à celui du peintre ou du sculpteur ?
J’aime les formes qui mordent, les coups de fouet. J’aime les formes brèves, éruptives, sans verbiage, sans sauce grasse, les formes écrites dans l’urgence, dans la nécessité, dans la ferveur, lesquelles confèrent à l’écriture ce vivant, cette intensité, cette émotion cueillie à vif sans lesquelles on s’endort. Mais difficile de garder cette ferveur, cette grâce, pour user d’un mot religieux, sur un temps long. Aussi, lorsque cette ferveur me quitte, lorsque mon exaltation s’éteins, lorsque le désir d’écrire ne me réveille plus à 5h du mat, lorsque je ne pense plus à mon roman à tous les instants du jour et jusque dans mes rêves, lorsque je cesse d’être sous son emprise et à sa botte, je me dépêche de terminer mon roman, même si la logique du récit en pâtit.

8. Dans 7 femmes, vous mettiez au centre la musicalité de l’écriture : « Un écrivain est une oreille. Rien d’autre. Un écrivain, comme le cœur et les marées, pour le dire autrement, un écrivain à son rythme intérieur. Et s’il n’entend pas son rythme intérieur, il n’est pas écrivain. C’est aussi simple, et aussi implacable. Le rythme est l’écrivain. » Comment se traduit chez vous ce rapport musical à la langue ?
Il faut que j’entende un rythme, un souffle, un chant, une « petite musique » comme disait Céline. Il m’est impossible de lire un texte si je n’entends pas sa petite musique. Impossible. Vraiment. L’idéal, c’est lorsque le rythme sert le sens et réciproquement, pour énoncer une platitude.
J’écris pour et à la place de ma mère.
Lydie Salvayre
Mais pour vous répondre plus précisément, il y a ces moments, lorsque j’écris, où la phrase se coule dans un rythme disons classique : l’alexandrin souvent pour sa beauté, tatata tatata… Et ces moments de brisures, de ruptures voulues, de dysharmonies, pour rompre le ronron : j’introduis par exemple un mot d’argot dans une phrase à l’imparfait du subjonctif, une injure bien sentie, un mot de fragnol, ou un mot dit grossier dans un discours nickel ; et fais en sorte que se mêlent sans hiérarchie le parfait bien-dire, le grand style et ses pompes, et les mots de la langue populaire qui est celle dans laquelle, enfant, j’ai baigné et à laquelle je reste très attachée.
9. Dans son Abécédaire, Gilles Deleuze faisait cette distinction précieuse : « Il faut dire aussi que l’écrivain, il écrit à l’intention des lecteurs, en ce sens, il écrit pour des lecteurs. Il faut dire aussi que l’écrivain, il écrit aussi pour des non-lecteurs, c’est-à-dire pas « à l’intention de », mais « à la place de ». Alors Artaud a écrit des pages que tout le monde connaît, « j’écris pour les analphabètes », « j’écris pour les idiots » ; Faulkner écrit pour les idiots. Ça ne veut pas dire pour que les idiots le lisent, ça ne veut pas dire pour que les analphabètes le lisent, ça veut dire à la place des analphabètes. Je peux dire : « j’écris à la place des sauvages », j’écris à la place des bêtes ». Lorsqu’on écrit, se sent-on responsable d’écrire pour ceux ou celles qui ne lisent pas ?
Absolument. J’écris pour et à la place de ma mère. J’ai vécu dans un milieu ouvrier, avec des parents qui parlaient un français de guingois, qui habitaient une HMM, qui n’avaient pas accès à « la grande culture », je veux dire à la culture bourgeoise, et qui regardaient la littérature et l’art en général comme un luxe dont ils se sentaient radicalement exclus, une chose réservée aux riches, un loisir pour gens éduqués. Ma colère vient de là, de cette injustice-là, de cette injustice que l’on ressent très bien et à mille détails lorsqu’on est enfant.
Cette colère d’enfance est restée en moi absolument intacte, et ma fidélité sauvage à ce milieu dont je suis issue.
Lydie Salvayre
Ma colère vient du sentiment qui m’animait que toutes ces choses-là, infiniment désirables, m’étaient interdites. Et bien que je sois devenue aujourd’hui ce qu’on appelle une transfuge, bien que je sois parvenue avec plus ou moins de bonheur à m’approprier la culture avec un grand C, je ne crois pas être passée à l’ennemi. Cette colère d’enfance est restée en moi absolument intacte, et ma fidélité sauvage à ce milieu dont je suis issue, « aux pauvres chiens, aux chiens crottés, ceux-là que chacun écarte, comme pestiférés et pouilleux, excepté le pauvre dont ils sont les associés, et le poète qui les regarde d’un œil fraternel », ma fidélité envers eux, est restée, je crois, tout aussi intacte.
10. Rêver Debout est-ce une définition de la lecture et de l’écriture ?
Je ne sais pas. Peut-être est-ce un modeste plaidoyer pour une littérature qui ne soit pas hors du monde, qui ne soit pas pur verbiage sans conséquence, tout en joliesses et en beaux sentiments.
Rêver debout de Lydie Salvayre aux éditions du Seuil
Famille de Lydie Salvayre aux éditions Tristram